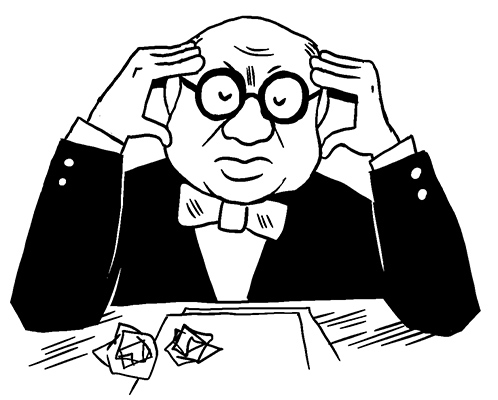« L’heure n’est plus aux bureaucrates ! »
Temps de lecture : 10 minutes
En 2017, vous avez publié un ouvrage au titre évocateur et provocateur : Faire l’Europe dans un monde de brutes (rééd. Pluriel, 2019). La tâche n’est-elle pas encore plus difficile à présent ?
Si, car les fossés à l’intérieur de l’Europe se sont creusés, et les brutes sont encore plus brutales que je l’imaginais. On pensait de Trump qu’il tiendrait six mois et le voilà en position d’être réélu. Son influence sur la politique intérieure européenne est incroyable. Il est le promoteur d’une tendance nationaliste qui est devenue Italie first, Pays-Bas first, France first. Il a dédouané – au sens de légitimer –, des propos et des idées qui étaient considérés comme absurdes. Il est devenu une référence politique dans de grands pays européens, dont la France et l’Italie. Si Trump reste, la politique occidentale va radicalement changer, l’écart entre l’Europe et les États-Unis va se renforcer. L’Europe se tournera vers la Chine et l’Asie, j’en suis convaincu.
Trump, mais aussi Poutine, Xi, Erdogan. Quelles sont les conséquences de cette omniprésence des « brutes » ?
Leur pouvoir devient un critère important pour notre façon de choisir les responsables européens. Nous devons cesser de faire ces choix en regardant seulement notre nombril.
Que voulez-vous dire ?
Entre juillet et octobre, l’Europe va devoir choisir les cinq visages qui doivent la représenter à la tête de ses principales institutions, comme le Parlement ou la Commission. Je suis opposé à ces choix a minima où on s’arrange toujours entre nous pour placer des gens qui ne dérangent pas les chancelleries. Ce serait mortel de poursuivre ainsi. Je m’oppose au principe du Spitzenkandidat, selon lequel le groupe arrivé en tête aux élections choisit la tête de l’exécutif européen. Ce monde de brutes qui nous entoure oblige à recourir à la méthode Draghi : celui-ci n’a pas été nommé à la tête de la BCE (Banque centrale européenne), parce qu’il était italien, mais parce que c’était le bon candidat pour le poste. Il faut choisir les bonnes personnes, celles qui sont capables de traiter avec les brutes et de leur résister. On va devoir parler avec la Chine de Xi, qui n’est pas celle d’il y a cinq ans, avec la Russie de Poutine, l’Amérique de Trump. Par exemple, pour la fonction de président du Conseil européen, je ne vois qu’une personnalité capable de parler sur un pied d’égalité avec Trump et de lui faire peur : Angela Merkel. La même méthode doit être appliquée pour la Commission, pour la Banque centrale. Il faut en finir avec cette absurde composition bruxelloise qui met en avant des personnalités faibles. L’heure n’est plus aux bureaucrates. Nous devons faire émerger des personnalités fortes. Nous devons aussi tenir compte du changement de boussole de l’Europe.
À quel changement pensez-vous ?
L’Europe a aujourd’hui le monde pour référence. Les conséquences de ce constat ne portent pas seulement sur le choix des personnalités, mais aussi sur celui des politiques à suivre : dans la prochaine Commission, il faudrait que la politique industrielle et de compétitivité soit au même niveau que la politique de la concurrence pour favoriser la naissance de champions européens. L’échec du rapprochement Alstom-Siemens démontre le manque de complémentarité entre les objectifs industriels et les règles de la concurrence. Airbus est le modèle. Mais on n’est pas compétitifs à l’échelle du monde, qu’il s’agisse des télécoms, du mobile, des hautes technologies, car on a fait 28 marchés au lieu d’en construire un seul mais puissant. On doit passer des fleuves aux océans, avoir une Europe qui regarde le monde entier.
Vous parlez parfois de « débruxelliser » l’Europe. Qu’entendez-vous par là ?
Il existe une bulle bruxelloise. Voyez la décision du Conseil européen d’accepter la participation des Britanniques aux prochaines élections. Quoi de plus absurde ! Dans un dossier du Brexit où l’Europe a fait un sans-faute grâce au travail de Michel Barnier, le Conseil crée les conditions pour que les Britanniques votent à nouveau et puissent changer les équilibres du Parlement européen, en donnant la possibilité à Nigel Farage d’entrer en force. En vingt-quatre heures, la bulle bruxelloise a décidé cela sans se poser la question des valeurs, mais en s’attachant à des questions techniques de règlement. C’est un manque de respect envers le Parlement.
Qu’en concluez-vous ?
J’avais été frappé par ces chiffres de la présidentielle américaine : à Washington, Clinton avait obtenu 93 % des voix, Trump 7 %. Cela illustrait le décalage complet de la capitale par rapport au pays. C’est le risque que court Bruxelles. Comme fidèle de Jacques Delors, j’ai toujours partagé sa vision : l’Europe comme une fédération d’États-nations. Je ne pense pas que l’Europe puisse effacer les États. Elle peut devenir un super-État. Cela nécessite le multicapitalisme – en termes de capitales, pas de système économique ! Je suis un défenseur de Strasbourg, de Luxembourg, de Francfort. Que tous les sommets se tiennent à Bruxelles n’est pas une bonne idée. Souvenez-vous, l’Acte unique a été signé à Luxembourg. Il y a eu Maastricht, Lisbonne, Amsterdam, Nice, Rome. L’Europe, ce sont des capitales européennes. Nous avons des histoires nationales qu’il faut connaître et respecter, sous peine de voir surgir des Le Pen et des Salvini.
Quelle est selon vous la plus grande menace pour l’Europe ?
La question migratoire vient pour moi en premier. Elle a totalement changé le panorama politique européen des cinq dernières années. Le Brexit a pour cause la crise migratoire. La mauvaise gestion de cette crise a accentué la fracture Est-Ouest. Elle a poussé l’Autriche dans les bras de la droite dure. Elle a aussi fait basculer l’Italie. Sans la crise migratoire, enfin, la percée de Marine Le Pen serait moindre. C’est ma préoccupation majeure.
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
Nous avons connu deux grandes crises depuis dix ans, la crise financière et la crise migratoire. On a tiré les leçons de la première, en termes de comportements, de règles, et de personnes chargées des dossiers : un désastre sous Barroso, une vraie amélioration avec Juncker et Moscovici, grâce, en particulier, à la création du Fonds de sauvetage des États. Une crise comparable à celle de 2008 ne pourrait pas se reproduire en Europe. Je n’en dirais pas autant d’une crise migratoire comparable à celle qui a éclaté en 2015 du fait de la guerre en Syrie. L’Europe aurait-elle de nouveaux outils adaptés ? Non. L’instabilité en Méditerranée, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a pourtant un impact énorme sur nos sociétés.
En quoi ?
On a créé une guerre permanente entre ultimi et penultimi, comme on dit en Italie, entre les marginaux et les plus marginaux encore, les migrants que l’on presse dans les banlieues où les gens vivent déjà difficilement. C’est le vrai grand sujet, mais il ne touche pas les couches aisées de la population. Je comprends la peur des gens. Cette question me préoccupe. On n’a pas fait évoluer nos règles.
Que faudrait-il faire ?
À 27 ou 28, aucune réforme interne importante ne peut être menée quand un veto peut tout bloquer. C’est impossible. Face à cette urgence, il faut appliquer la méthode employée face à la crise financière : sortir des traités et inventer d’autres traités. Schengen fut d’abord décidé hors des traités avant d’y être intégré. Pareil pour le Fonds de sauvetage des États en 2011-2012.
Comment l’Europe peut-elle protéger ses citoyens les plus faibles ?
D’abord en traitant la crise migratoire. L’éducation est ensuite le grand défi. Avec l’Institut Jacques-Delors, on a proposé de faire de l’Europe un moteur pour la partie en marge de nos sociétés : créer un Erasmus de trois mois pour les jeunes de 16 ans, un programme obligatoire pour tous, en particulier pour les jeunes dont les parents n’ont pas les moyens de payer des séjours à l’étranger. On touche ici à l’inégalité la plus profonde. La grande force de nos sociétés a longtemps été de permettre une convergence sociale. Les jeunes issus de familles pauvres ou riches étudiaient ensemble. Aujourd’hui, c’est le contraire : ceux des familles aisées ne rencontrent plus ceux des familles plus modestes, car ils vont étudier à l’étranger, suivent des parcours élitistes.
Comment remédier à la désaffection actuelle et faire aimer l’Europe ?
En regardant le futur. Ou bien on est ensemble, ou bien chacun de nos pays fait le choix de devenir une colonie américaine ou une colonie chinoise. Prenons deux sujets du futur, l’environnement et la technologie. Sur le premier, seule une Europe unie aura le leadership pour obliger ces deux puissances à accepter d’appliquer les accords de Paris. Quant aux technologies, nos mobiles sont tous coréens, chinois ou américains. L’Europe n’est plus là. Mais le mobile n’est pas un lave-vaisselle. C’est d’une certaine façon le dépositaire de notre identité, une sorte de deuxième nous-mêmes : nous y stockons tout ce que nous sommes. Si quelqu’un entre dans notre mobile, en exploite les données, il entre dans notre personne comme jamais dans l’histoire de l’humanité. C’est le pétrole du futur. Soit nous avons la force d’imposer des règles, soit ces technologies nous échappent, et nous devrons accepter une philosophie, américaine ou chinoise, toute différente de la nôtre. Je trouve ces perspectives intolérables. Dans l’esprit des Européens, les droits de la personne devraient être sanctuarisés : mon identité à travers mon mobile est inviolable, comme ma personne. On a une mission dans le monde. Seule l’Europe unie peut éviter qu’on se retrouve dépossédés de notre philosophie.
Quelle chance ces élections du 26 mai offrent-elles à l’Europe ?
À l’étranger on me demande : est-ce vrai que les populistes vont prendre le pouvoir en Europe ? Non, ça ne va pas se passer comme ça. La majorité sera gagnée par les quatre partis pro-européens : les socialistes, le PPE, avec en plus les libéraux et les verts. Je suis convaincu que cela va ouvrir une fenêtre avec une élection européenne plus européenne que d’habitude, moins marquée par les enjeux internes aux États.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
« L’heure n’est plus aux bureaucrates ! »
Enrico Letta
En 2017, vous avez publié un ouvrage au titre évocateur et provocateur : Faire l’Europe dans un monde de brutes (rééd. Pluriel, 2019). La tâche n’est-elle pas encore plus difficile à présen…
[Dépassement]
Robert Solé
Tous les ans désormais, deux organismes dédiés à la protection de l’environnement, WWF et Global Footprint Network, calculent « le jour du dépassement » : à savoir la date à partir de laquelle l’humanit&e…
Faire de l’Union un État
Matthieu Calame
Depuis un demi-siècle, les gouvernements sociaux-démocrates ou conservateurs ont ostensiblement professé un credo européen. Pourtant, au moment même où le besoin en devient criant, les Européens n’ont pas de politique soci…