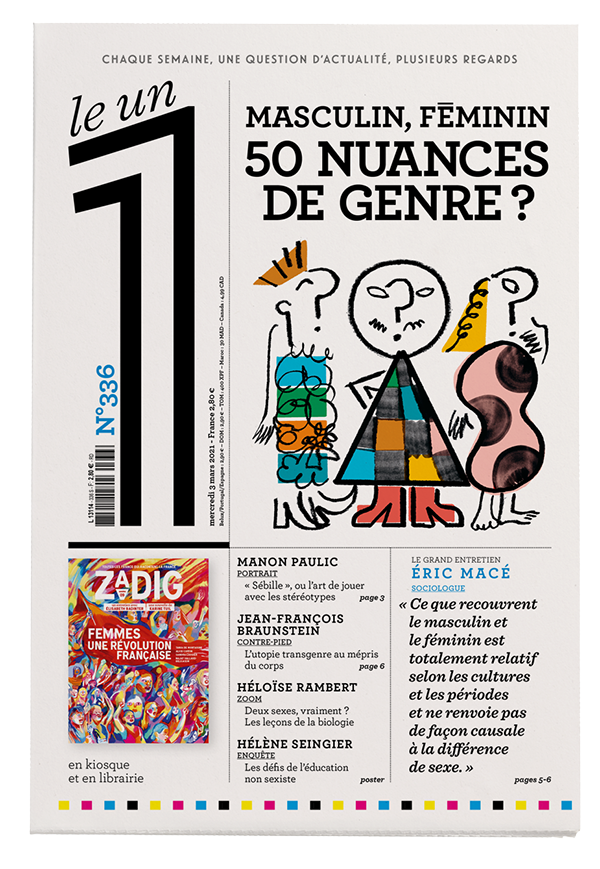Les mille subtilités du sexe biologique
Temps de lecture : 6 minutes
Sur le papier, les choses pourraient sembler sans équivoque. Dans la population humaine, il y a deux sexes. Le sexe féminin et le sexe masculin dont la caractéristique est que le premier produit des ovocytes et le second des spermatozoïdes. On l’apprend dès le collège : en fonction du chromosome – X ou Y – porté par le spermatozoïde qui féconde l’ovocyte de la mère – détenteur, lui, d’un chromosome X –, deux combinaisons génétiques sont possibles pour l’enfant à naître. Si c’est XX qui est présent dans l’œuf, au stade « une cellule », ce sera une fille ; XY, un garçon. La détermination chromosomique du sexe du fœtus entraîne ensuite la différenciation in utero des gonades – les testicules ou les ovaires – et des organes génitaux. Dans la très grande majorité des cas, c’est en effet de cette manière que les choses se passent. Mais la biologie ne connaît pas le simplisme, et une part non négligeable de la population, estimée entre 1 et 2 %, se trouve dans une situation d’intersexuation, consécutive à une différence du développement sexuel. Les personnes intersexuées présentent des caractéristiques physiques ou biologiques – formules chromosomiques, anatomie sexuelle, organes génitaux, fonctionnement hormonal – qui ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Ces caractéristiques peuvent se manifester dès la naissance ou plus tard dans la vie, souvent à la puberté. « Concernant le sexe biologique, les maîtres mots sont complexité et diversité », explique Joëlle Wiels, biologiste cellulaire, directrice de recherche émérite au CNRS et coautrice de l’ouvrage Mon corps a-t-il un sexe ? « Pour commencer, il n’y a pas que XX d’un côté et XY de l’autre. Il existe d’autres formules », assure la biologiste.
Les mécanismes biologiques de détermination du sexe sont, par nature, très complexes.
Qu’il soit porteur d’une paire de chromosomes XX ou XY, durant ses premières semaines de développement, l’embryon est bipotentiel : il commence à fabriquer à la fois des canaux féminins et masculins. Ce n’est que quand les gonades sont différenciées, qu’il se « débarrasse » des voies génitales préfigurées qui ne sont finalement pas utiles. En réalité, ce sont plus les gènes portés par les chromosomes que les chromosomes eux-mêmes qui sont déterminants. « Sur le chromosome Y, il y a un gène qui s’appelle “SRY” et qui détermine le sexe masculin, en organisant les testicules embryonnaires, qui vont eux produire les hormones androgènes, les hormones mâles, en majorité de la testostérone », détaille Francis Poulat de l’Institut de génétique humaine du CNRS, à Montpellier. « En cas de mutation sur ce gène, la détermination testiculaire et la production d’androgènes ne se font pas. Cette différence du développement sexuel donne des phénotypes féminins, c’est-à-dire une apparence féminine, malgré un caryotype – une “carte d’identité chromosomique” – XY. » Le passage du gène SRY sur un chromosome X peut conduire un embryon XX à développer un phénotype masculinisé, en dépit d’un caryotype féminin. Et même lorsque le sexe chromosomique et le sexe gonadique n’entrent pas en contradiction, de multiples autres mutations génétiques peuvent conduire à une intersexuation. « Par exemple, un organisme XY peut effectivement produire des hormones androgènes, mais y être résistant car les récepteurs à ces hormones ne fonctionnent pas. L’aspect physique sera aussi féminisé », continue le généticien.
De très nombreuses situations sont susceptibles de se produire et d’aboutir à des phénotypes très divers. Le Pr Blaise Meyrat, urologue, chirurgien pédiatrique et enseignant à la faculté de médecine de Lausanne, peut en témoigner. Il a vu en consultation tous les enfants nés intersexes en Suisse depuis plus de vingt ans. « Il est très rare de voir un enfant naître avec des organes masculins et féminins », constate le praticien, opposé aux opérations chirurgicales de ces enfants dès leur naissance pour les assigner à un sexe. « Nous voyons plutôt des situations très fines, sans vraies limites. Par exemple, des hypertrophies du clitoris avec des grandes lèvres qui pourraient ressembler à un scrotum, mais dans lequel on ne trouve pas de testicules. Que ce soit dans la problématique chromosomique, phénotypique ou endocrinologique, l’intersexuation est un vrai continuum. » Sur le plan endocrinologique, les athlètes féminines hyperandrogènes sont régulièrement évoquées pour leurs taux de testostérone jugés trop hauts. Les taux d’hormones sexuelles « hors normes » soulèvent des questions particulièrement délicates : les hommes comme les femmes produisent des œstrogènes et de la testostérone. Et les variations entre individus sont telles qu’elles peuvent aller jusqu’à un chevauchement des courbes masculines et féminines. Comprendre : les femmes les plus « testostéronées » le sont naturellement plus que les hommes qui le sont le moins.
Alors, sur quels critères scientifiques s’appuyer pour établir une frontière entre corps mâle et corps femelle ? Aucun. « Bien sûr, à l’échelle individuelle, on peut être un homme ou une femme et “cocher” toutes les cases. C’est le cas pour l’immense majorité des personnes, rappelle Joëlle Wiels. Mais à l’échelle d’une population, il n’y a aucun critère pertinent pour séparer les personnes en deux catégories étanches. Tous échouent à assurer cette classification binaire, qu’il s’agisse du contenu chromosomique, de la longueur du pénis ou du clitoris ou encore du taux de testostérone. Il y aura toujours des gens “au-dessus” et “en dessous”, et dans des gammes très variables. »
Et il ne faut pas non plus compter sur le cerveau pour se plier facilement à une catégorisation sexuelle. Les avancées des neurosciences ont fait voler en éclats la conception selon laquelle les cerveaux des hommes sont intrinsèquement différents de ceux des femmes, car « baignant » dans des hormones mâles d’un côté, femelles de l’autre. S’ils se distinguent par les zones profondes qui contrôlent les fonctions reproductrices, ils ne présentent aucune différence notable en ce qui concerne le cortex cérébral, siège des fonctions cognitives, qui représente 80 % du volume de nos cerveaux. « Désormais, nous disposons de banques de données de centaines de milliers d’images de cerveau. Elles ne permettent pas d’identifier de régions dans le cortex cérébral qui soient spécifiques d’un cerveau féminin ou masculin », explique Catherine Vidal, neurobiologiste, directrice de recherche à l’Institut Pasteur et membre du comité d’éthique de l’Inserm. « Pendant longtemps, il s’est dit que l’imprégnation des hormones sexuelles durant la vie in utero laissait une trace indélébile dans le cerveau des petites filles et des petits garçons et leur donnait telles ou telles inclinaisons et prédispositions. Cela a été complètement démenti », assure la neurobiologiste. Aucune influence hormonale, avant ou après la naissance, ne « fait le poids » face à la formidable plasticité qui caractérise notre cerveau tout au long de sa vie. Quel que soit notre sexe.
« La distinction masculin-féminin ne sert plus qu’à discriminer »
Éric Macé
« Nous restons héritiers d’un patriarcat moderne qui a saturé la totalité de nos représentations et de notre organisation sociale. » Le sociologue analyse comment en Occident le carcan du genre – la subordination des femmes et la disqualification culturelle du féminin qu’il induit – a longtemps s…
[Épicènes]
Robert Solé
EN FRANCE, depuis 1993, les parents peuvent choisir librement le prénom de leur enfant, dans certaines limites. L’administration n’a voulu ni de Nutella pour une fille ni de Jihad pour un garçon… Elle a dû accepter, en revanche, que deux coup…
Éducation moins genrée : mission impossible ?
Hélène Seingier
« C’est un âge où ils sont très perméables. Après les avoir exposés au sexisme pendant des années, il est temps de leur ouvrir les idées », explique Laurence Faron, créatrice de la maison d’édition Talen…