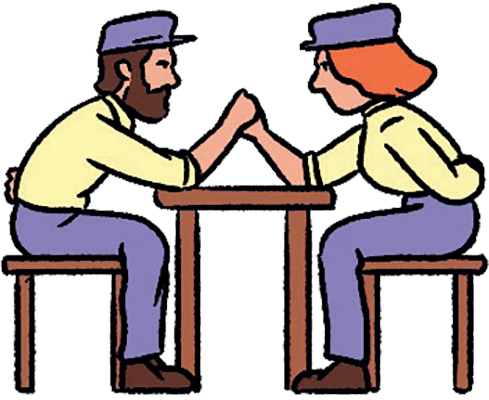« La distinction masculin-féminin ne sert plus qu’à discriminer »
Temps de lecture : 9 minutes
Quelle est la différence entre sexe et genre ?
C’est simple, le genre renvoie à la définition des notions de masculin et de féminin et de leurs relations ; c’est à 100 % un rapport social. La science biologique ne peut parler que de la sexuation, c’est-à-dire de la distinction mâle-femelle. Chez les humains, la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule fabrique un corps femelle standard dans 49 % des cas, un corps mâle standard dans la même proportion, mais dans 1 à 2 % des cas elle fabrique des intersexuations : des corps qui ont des attributs mâles et femelles. C’est le cas par exemple de l’athlète sud-africaine Caster Semenya, que ses adversaires accusaient de ne pas être une femme mais un homme. Elle a en réalité un corps intersexué, qui fabrique de la testostérone, avec un chromosome Y, tout en ayant des attributs féminins. La nature n’est donc pas binaire : il n’y a pas que deux sexes.
« Le genre est un universel anthropologique »
Concernant le genre, toutes les cultures humaines pensent la réalité du monde – et tout particulièrement la différence de sexe, la sexualité et les statuts sociaux – avec des définitions sociales et culturelles de ce que sont le féminin et le masculin. C’est un universel anthropologique. Mais ce que recouvrent ce masculin et ce féminin est totalement relatif selon les cultures et les périodes et ne renvoie pas de façon causale à la différence de sexe. Chez les Inuits, par exemple, on décide du genre de l’enfant selon le genre de l’ancêtre dont il est supposé être la réincarnation, et non selon son sexe.
D’où vient alors cette idée que le genre découle du sexe ?
Le monde occidental, et après lui le monde musulman, s’est essentiellement construit sur un quadruple héritage patriarcal : juif, grec, romain et chrétien. Ainsi, dans la Bible, Dieu crée Ève à partir d’une côte d’Adam. Et c’est elle, la femme, qui fait plonger le monde dans le chaos en croquant le fruit de la connaissance, la fameuse pomme. Dans ce monde patriarcal, le masculin et le féminin sont différents et hiérarchisés ; cela se traduit socialement par la subordination des femmes, et culturellement par la disqualification du féminin.
À partir du XVIe siècle émerge la modernité, cette définition occidentale d’un rapport au monde qui ne repose plus sur Dieu mais sur la rationalité scientifique. La lecture théologique du sexe et du genre laisse alors place à une lecture naturaliste, fondée sur la biologie. Des armées de médecins concluent que la vocation sociale naturelle des femmes, étant donné leur sexe, est la reproduction et le soin ; tandis que la vocation sociale naturelle des hommes, déchargés de ces tâches, est l’action, la production, la créativité.
« Le monde occidental, et après lui le monde musulman, s’est essentiellement construit sur un quadruple héritage patriarcal : juif, grec, romain et chrétien »
Cette modernité présume que le sexe biologique serait la cause du genre. Si j’ai un pénis et que je m’identifie avec ce qui fait un homme du point de vue de la société, tout va bien. Mais si je sors du schéma, en me sentant femme par exemple, je dois être pris en charge par la médecine. À l’époque, c’est perçu comme un danger pour la nation, la race, l’empire colonial… Les enjeux sont colossaux ! Alors qu’en réalité, la nature est un ensemble de mécanismes. Elle se fiche du masculin et du féminin. Affirmer que le genre relève de catégories naturelles revient à faire parler la nature à la façon d’un ventriloque faisant parler sa marionnette !
Mais il se trouve que le patriarcat a imposé sa vision de la différence homme-femme au reste du monde. En France, le Code civil napoléonien a encore accentué les choses, en faisant de la femme une mineure à vie.
Comment les choses ont-elles changé ?
Cette construction patriarcale moderne, très verrouillée, a fait l’objet d’une déconstruction conflictuelle depuis la fin du XVIIIe siècle. D’abord par les féministes, d’Olympe de Gouges à #MeToo, mais aussi par les mouvements gays, queer, trans… et jusque dans le domaine scientifique, qui reconnaît dorénavant ses propres « biais de genre », y compris dans les sciences dures.
Peu à peu, on a dénaturalisé le genre et la sexualité et montré qu’il s’agissait d’une construction idéologique et politique. La célèbre formule de Simone de Beauvoir le résume bien : « On ne naît pas femme, on le devient. » On ne naît pas femme, car on naît mâle, femelle ou intersexe ; on le devient, par l’apprentissage social et culturel d’une différence de genre binaire et hiérarchisée.
En parallèle de ces transformations culturelles profondes, le droit a lui aussi démantelé le binarisme. Trois bascules ont eu lieu. Tout d’abord, le principe de hiérarchie de genre a cédé la place à l’égalité de genre. En France, ça commence avec le droit de vote pour les femmes en 1944, puis l’égalité en droits dans la Constitution de 1946. Dans les années 1970, avec la légalisation de la contraception et de l’avortement, la loi ne décide plus de ce que les femmes font de leur corps. Ce sont des révolutions !
« On se conforme à des garde-robes, des postures et des gestuelles que l’on a intériorisées comme étant de notre genre, mais il n’y a aucune raison "objective" à cela »
Ensuite, il a été interdit de discriminer sur la base de l’identification de genre, du sexe ou de la sexualité. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme parce qu’elle exigeait une preuve de stérilisation aux personnes demandant à changer de genre à l’état civil. Tout cela a été dépassé par le droit. Désormais, pour cette démarche, le juge ne peut plus rien demander de médical. Il doit s’en tenir à la « performance de genre », pour parler comme Judith Butler – par exemple, des amis qui témoignent de la manière dont vous exprimez votre identité de genre.
Enfin, troisième bascule : pour définir la notion de parent, de famille, ou le fonctionnement de la procréation, le droit ne se réfère quasiment plus aux attributs de sexe, de genre ou de sexualité des individus. Cela a pris deux cents ans, mais le modèle a été totalement déconstruit.
En quoi la période actuelle est-elle particulière ?
En dépit de ces transformations profondes, nous ne nous situons pas « après » le patriarcat, comme s’il s’agissait d’une parenthèse historique qu’on aurait refermée. Nous sommes dans l’« après-patriarcat » comme on parle de l’« après-guerre ». Sur les plans scientifique, institutionnel, juridique, dans la répartition des tâches ou la définition des professions, la distinction masculin-féminin ne sert plus à rien, sinon à discriminer. Mais nous restons héritiers d’un patriarcat moderne qui a saturé la totalité de nos représentations et de notre organisation sociale. On donne encore une éducation différenciée aux garçons et aux filles, avec un implicite hétérosexuel. Comme le dit Judith Butler, nous sommes tous des travestis : on se conforme à des garde-robes, des postures et des gestuelles que l’on a intériorisées comme étant de notre genre, mais il n’y a aucune raison « objective » à cela.
La particularité du moment contemporain tient à cela : une mise sous tension permanente entre les normativités héritées de ce patriarcat et la créativité, le syncrétisme liés au fait qu’il n’est plus une institution. Les personnes qui remettent en cause la dichotomie de genre – par leurs vêtements, du maquillage ou encore des pratiques nouvelles – s’approprient dans leur identité subjective ces déplacements tectoniques.
Comment se manifeste ce « flou sur le genre » ?
Il faut voir l’identification de genre comme un ensemble de techniques mobilisables, avec des combinaisons infinies.
Certaines personnes se sentent à l’aise dans leur genre, sachant que le répertoire dévolu aux masculinités ou aux féminités s’est considérablement élargi. On voit ainsi combien les formes autrefois hégémoniques et valorisées de la masculinité peuvent aujourd’hui être présentées comme « toxiques ». Certaines personnes se définissent comme des « hommes féministes », en raison de leur attitude en couple, au travail ou dans leurs relations sexuelles – avec l’attention au consentement. Du côté des femmes, certaines se posent par exemple la question d’allaiter ou non, ou de partager leur congé parental avec un conjoint, car cela interroge la relation qu’elles souhaitent construire entre le bébé, le père et elles.
Au-delà de ces élargissements de répertoire, d’autres personnes ne reconnaissent pas l’attribution de genre qui leur a été faite ; elles se sentent mieux dans l’autre genre, ou dans une non-binarité, une fluidité. Cela rejoint l’éclectisme des goûts musicaux : chacun compose sa playlist selon ses goûts.
« L’identification de genre s’assimile à une carrière qui dure toute la vie »
Il y a vingt ans, les seules références en la matière étaient des images très stigmatisantes, comme celles de travestis. Aujourd’hui, tous ces éléments sont accessibles à travers les réseaux sociaux et à travers des stars qui investissent cet espace, à l’image de Bilal Hassani [chanteur queer qui a représenté la France à l’Eurovision, NDLR]. Même si les jeunes se trouvent isolés – dans des familles transphobes ou qui ne comprennent pas la non-binarité, par exemple –, ils peuvent se sentir suffisamment entourés pour penser que ce sont eux qui ont raison, et pas leurs parents. Pour utiliser une analogie du sociologue américain Howard Becker, l’identification de genre s’assimile à une carrière qui dure toute la vie. On voit des pères de famille qui, à 50 ans, préfèrent devenir femme. D’autres personnes font une rencontre et adoptent tout à coup des pratiques homosexuelles parce qu’ils sont amoureux de cette personne spécifique.
Quelles réactions tout cela entraîne-t-il ?
Cela produit nécessairement des postures réactionnaires. Au moment de la Manif pour tous, on a vu les catholiques intégristes mobiliser des anthropologues et des scientifiques pour venir au secours d’une conception à la fois théologique et naturaliste des choses.
C’est ce que l’on appelle une panique de genre – comme lorsqu’un parent s’affole que son petit garçon aille « vers le féminin », par peur de l’homosexualité. Mais en réalité, ces personnes qui paniquent sont en train de prendre très tardivement conscience d’évolutions entamées depuis deux siècles.
« Les questions de genre et de sexualité sont historiquement liées aux dimensions ethnonationalistes du patriarcat, comme on le voit en Pologne ou en Hongrie »
Le genre, comme beaucoup d’autres sujets, devient une affaire existentielle, un débat identitaire qui entraîne des crispations des deux côtés. Un « effet boomerang » réactionnaire n’est pas à exclure tant nous savons combien les questions de genre et de sexualité sont historiquement liées aux dimensions ethnonationalistes du patriarcat, comme on le voit en Pologne ou en Hongrie.
Est-il imaginable de sortir un jour de cette binarité du genre ?
Prenons un exemple pessimiste, celui de la race. Une fois qu’on a décrété l’égalité en droits, condamné le racisme, etc., est-on sorti d’un monde racialisé ? Non, mais le racisme est devenu un scandale démocratique.
Prenons maintenant un exemple optimiste : la différence entre gauchers et droitiers. Par le passé, être gaucher recouvrait une charge symbolique lourde, c’était vu comme une quasi-pathologie, on obligeait les gauchers à écrire de la main droite. Aujourd’hui, tout le monde s’en moque. L’utopie d’un monde post-genre serait de cet ordre-là : nous serions des individus différents par nos corps, nos identifications, nos pratiques sexuelles, au point qu’il n’existerait plus d’« hommes » ni de « femmes », mais une multitude de combinatoires. Et cela n’aurait pas de conséquences, ni positives ni négatives, sur nos trajectoires sociales ou nos compétences.
Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER
Illustrations SIMON BAILLY
« La distinction masculin-féminin ne sert plus qu’à discriminer »
Éric Macé
« Nous restons héritiers d’un patriarcat moderne qui a saturé la totalité de nos représentations et de notre organisation sociale. » Le sociologue analyse comment en Occident le carcan du genre – la subordination des femmes et la disqualification culturelle du féminin qu’il induit – a longtemps s…
[Épicènes]
Robert Solé
EN FRANCE, depuis 1993, les parents peuvent choisir librement le prénom de leur enfant, dans certaines limites. L’administration n’a voulu ni de Nutella pour une fille ni de Jihad pour un garçon… Elle a dû accepter, en revanche, que deux coup…
Éducation moins genrée : mission impossible ?
Hélène Seingier
« C’est un âge où ils sont très perméables. Après les avoir exposés au sexisme pendant des années, il est temps de leur ouvrir les idées », explique Laurence Faron, créatrice de la maison d’édition Talen…