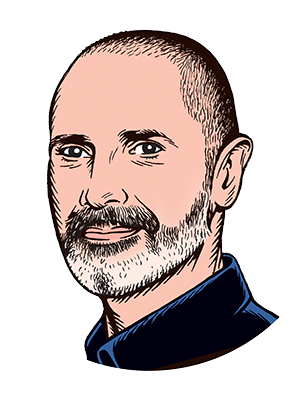Tout, tout de suite
Temps de lecture : 5 minutes
Ce pourrait être une définition de mots croisés : « Pléthore de virus et pénurie de traitements : pandémie. » Lors du premier confinement lié au Covid, en mars 2020, il y eut, de fait, des pénuries préoccupantes : masques, appareils de réanimation, certains médicaments… Et aussi des pénuries étonnantes, comme celle de papier toilette. Il ne s’agissait en réalité que d’une simili-pénurie, liée à des problèmes d’égarement (tout le monde se jetant sur le PQ) et d’acheminement (les chaînes d’approvisionnement étant, pour un temps, désorganisées). Mais cette pseudo-pénurie, dérisoire, était révélatrice, me semble-t-il, de trois affolements intéressants. D’abord, un affolement mimétique : l’instinct grégaire est très puissant chez l’animal social qu’est l’humain. Si je vois mes congénères se ruer sur un produit et le stocker, je suppose qu’ils ont des infos que j’ignore, j’anticipe qu’il pourrait venir à manquer, et je me mets moi aussi à stocker. De même qu’il existe des prophéties autoréalisées (persuadé que je vais échouer, je peux me mettre moi-même en échec), il existe des pénuries autoréalisées (je crée le manque par mon anticipation du manque). Puis, un affolement psychologique : toutes les études montrent que nous devenons plus matérialistes dès qu’on nous expose à des situations d’incertitude. Nous régulons alors nos inquiétudes par l’acquisition d’objets qui nous semblent à même de nous aider à traverser la crise. La peur du manque de papier toilette alerta ainsi nos esprits plus fortement et précocement que celles du manque de liberté ou de contacts sociaux. Enfin, un affolement sociologique : les craintes de pénurie, les impressions de pénurie, nous pèsent parfois autant que la réalité de la pénurie. Car nous sommes habitués à n’en plus souffrir. Cela ne s’applique qu’aux populations occidentales contemporaines, car de nombreux humains dans le monde souffrent bel et bien de pénuries réelles de biens fondamentaux (blé, riz, eau). En ce qui nous concerne, il s’agit davantage d’une aversion à la pénurie, d’une intolérance à la non-abondance.
Depuis les années 1950, la plupart des Occidentaux sont habitués à disposer de tous les biens, à tout moment, sur le modèle du omnia illico : « Tout, tout de suite. » Nous évoluons dans un quotidien de pléthores multiples : d’aliments, de vêtements, d’objets, de distractions, d’informations… Or, ces pléthores posent un difficile problème à nos vieux cerveaux : héritiers d’un très long passé de rareté des ressources, ils sont mieux équipés pour affronter le manque que l’abondance, car ils ne savent pas bien résister aux tentations. Lorsque, jadis, on tombait sur de la nourriture, il s’agissait de s’en gaver tout de suite, car la probabilité que l’occasion se représente dès le lendemain était faible. Mais, dans un environnement où règne une profusion d’accès facile, nos cerveaux ne savent pas se refréner et ont tendance à tout vouloir et à tout prendre ; puis à s’habituer très vite à la pléthore et à réagir très fort en cas de frustration. Car, en plus d’une offre de biens inédite, notre époque se caractérise aussi par une incitation constante à les consommer sans délai : ne plus attendre d’avoir l’argent pour acheter, mais utiliser un crédit à la consommation (taux exorbitant garanti) ; ne plus attendre une ou deux semaines un objet venant du bout du monde, mais l’avoir chez soi dès demain.
Des sociétés biberonnées à la pléthore et à l’immédiateté sont forcément des sociétés vulnérables à toute forme de manque, réel ou supposé, complet ou limité, et intolérantes à l’attente. Et comme de vraies pénuries sont à venir, même pour les Occidentaux, nous ferions bien de nous y préparer, socialement et mentalement ! Car nous sommes devenus des enfants gâtés du consumérisme, bien sûr, à l’image du narrateur dont Proust décrit les états d’âme dans le Temps retrouvé : « À cause de la pénurie d’essence, les rares taxis que je rencontrais ne prenaient même pas la peine de répondre à mes signes… » Eh oui, en pleine Première Guerre mondiale, la détresse du personnage, c’est de ne pouvoir rentrer confortablement chez lui en taxi. Ainsi va notre vie cérébrale. Et notre vie économique : car les solutions ne sont pas seulement à trouver du côté de nos progrès moraux et psychologiques, elles concernent aussi nos valeurs collectives.
Dans son ouvrage Les Ruines du ciel, le poète Christian Bobin constate : « Dieu tenait au XVIIe siècle la place qu’aujourd’hui tient l’argent. Les dégâts étaient moindres. » Il ne s’agit bien sûr pas d’en revenir au XVIIe siècle ni de nous retourner vers Dieu. Mais de commencer à réguler le principal facteur de toutes les pénuries, réelles ou redoutées : l’appât du gain. « Si un homme marche dans la forêt par amour pour elle pendant la moitié du jour, il risque fort d’être considéré comme un tire-au-flanc ; mais s’il passe toute sa journée à spéculer, à raser cette forêt et à rendre la terre chauve avant l’heure, on le tiendra pour un citoyen industrieux et entreprenant. » Le penseur américain Thoreau écrivait cela au XIXe siècle et on ne peut pas dire que les choses aient violemment changé. Allons, essayons quand même de positiver, et d’espérer que ces histoires de pénuries vont nous ouvrir les yeux ; histoire de ne pas succomber à la pire d’entre elles : la pénurie d’espérance, et de confiance dans nos capacités à changer le monde !
« Il y a pire que produire cher, c’est de ne pas produire du tout »
Isabelle Méjean
« Ce qui n’était pas attendu, c’est la survenue de chocs et de difficultés de production un peu partout en même temps. » La chercheuse, qui s’est vu décerner en 2020 le Prix du meilleur jeune économiste par Le Monde et le Cercle des économistes, revient sur les origines des pénuries qui …
[Manques]
Robert Solé
DE QUOI manquons-nous ? Les Anglais ont, paraît-il, beaucoup souffert pendant le confinement en raison de la pénurie de nains de jardin : ils avaient un mal fou à trouver dans le commerce ces petits lutins ventripotents à bonnet rouge et barbe blanche.
Des pénuries ? Profitons-en !
« En 2012, le Forum économique mondial – qui planchait déjà sur le thème de la résilience – faisait remarquer que les chocs systémiques étaient dus à “des chaînes d’approvisionnement efficaces qui ne laissaient pas de place à des évènements catastrophiques”. Or, des évènements catastrophiques,…