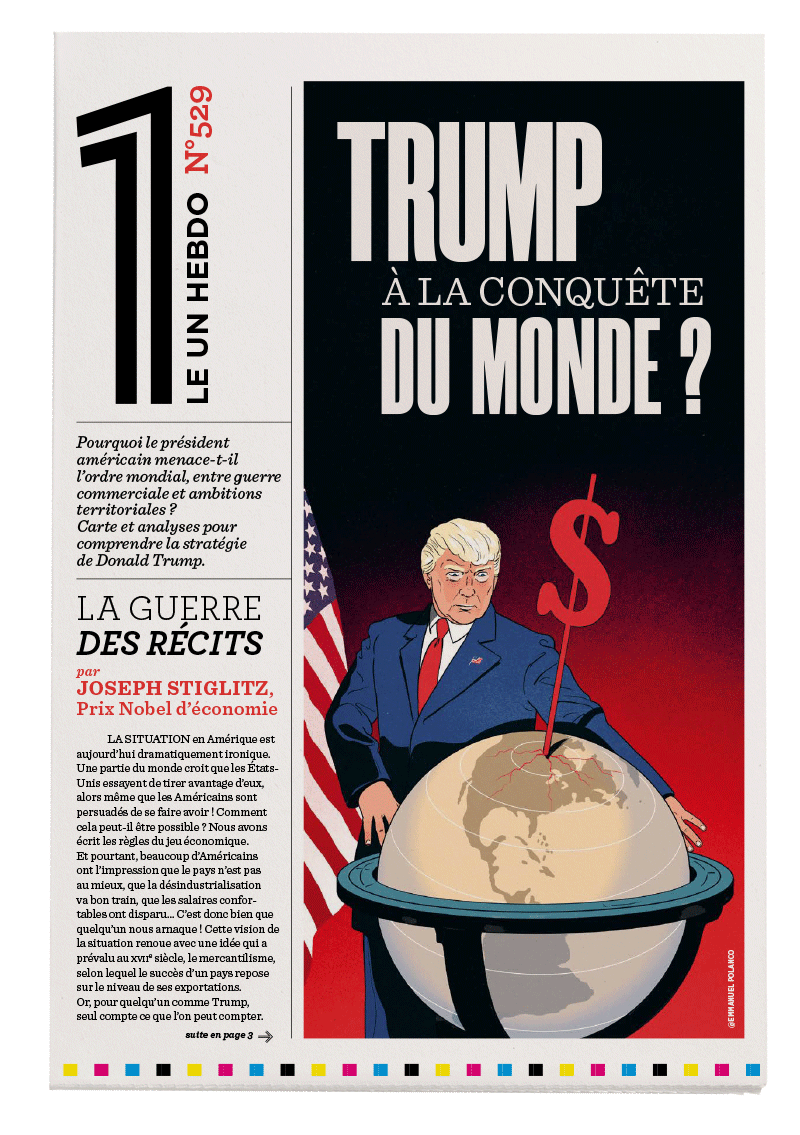Le filon décliniste
Temps de lecture : 6 minutes
« La France se meurt. […] Nos élites politiques, économiques, administratives, médiatiques, intellectuelles, artistiques, héritières de Mai 68, s’en félicitent. […] Elles crachent sur sa tombe et piétinent son cadavre fumant. […] Toutes observent, goguenardes et faussement affectées, la France qu’on abat ; et écrivent, d’un air las et dédaigneux, les dernières pages de l’Histoire de France. » Ces lignes, cela ne surprendra personne, sont d’Éric Zemmour, tirées du Suicide français, son best-seller paru en 2014 et vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. Déclin, décadence, déréliction, dégénérescence, corruption, les mots et les phrases chocs reviennent en boucle dans la prose du polémiste. Ils témoignent d’une vision crépusculaire, apocalyptique de la France contemporaine, mélange de nostalgie (« c’était mieux avant ») et d’invectives contre ceux qu’il accuse d’être responsables de la situation qu’il prétend décrire.
Face au phénomène Zemmour, les commentaires alternent entre fascination et fatalisme. Après tout, l’essayiste d’extrême droite n’est pas le seul à surfer sur la vague décliniste. Celle-ci est depuis près de deux décennies un filon éditorial florissant, exploité aussi bien par une panoplie d’intellectuels conservateurs – de Marcel Gauchet à Alain Finkielkraut, en passant par Michel Onfray, Luc Ferry, Jacques Julliard et toute la réacosphère médiatique qui navigue entre Le Point et Valeurs actuelles – que dans le domaine littéraire où Michel Houellebecq lui a redonné des lettres de noblesse. Quelques années auparavant, l’essayiste Nicolas Baverez se faisait déjà le greffier d’une France dans l’ornière, dans son livre à succès La France qui tombe, paru en 2003.
Cette tendance à l’avis de décès de la nation n’est pas nouvelle. Une histoire de la pensée décliniste est encore à écrire, et remonterait bien loin dans l’histoire européenne. L’historien Johann Chapoutot en a retrouvé des ferments dans la pensée romaine de l’Antiquité, obsédée par l’affaissement de l’Empire causé par le déclin des mœurs et par un matérialisme destructeur de la virtus qui avait fait sa gloire. En France, elle est le fruit d’une longue tradition d’autoflagellation, que l’on retrouve certes dans d’autres pays d’Europe – le philosophe allemand Oswald Spengler en a signé l’un des exemples les plus notables avec son Déclin de l’Occident, publié en 1918 –, mais dont notre pays s’est fait une spécialité.
À chaque époque ses motifs de lamentation. Au XVIIIe siècle, la Révolution, l’analyse de ses causes et de ses conséquences sont à l’origine du déclinisme moderne, né en réaction. Dès les années 1760, Simon-Nicolas-Henri Linguet, « anti-philosophe » dont la popularité était proportionnelle à l’énergie qu’il employait à mettre en pièces les penseurs des Lumières, connaissait une renommée considérable en dénonçant le déclin de la monarchie corrompue par le luxe des aristocrates, anticipant une révolution inexorable qui jetterait la France dans l’abîme. À l’orée du XIXe siècle, Chateaubriand se lamentait déjà : « Nous, l’État le plus mûr et le plus avancé, nous montrons de nombreux symptômes de décadence. » Quelques décennies plus tard, la Révolution industrielle, la crainte de voir triompher l’ennemi anglais et la modernité emporter les fondements de l’ordre chrétien qui avait dominé la France pendant des siècles ont nourri une littérature abondante, à tel point que Flaubert inclut la dénonciation du temps dans son Dictionnaire des idées reçues : « Époque (la nôtre) : Tonner contre elle – se plaindre de ce qu’elle n’est pas poétique – L’appeler époque de transition, de décadence. »
Au siècle dernier, les motifs de déploration sont nombreux. Qui se souvient de Robert Aron et Arnaud Dandieu, auteurs de La Décadence de la nation française, une critique radicale du monde moderne, à l’origine du mouvement intellectuel des non-conformistes ? Leur livre avait pourtant marqué son époque lors de sa sortie en 1931. À partir de la Seconde Guerre Mondiale, domine ce que l’historien Robert Frank nomme le « syndrome de 40 » : une interrogation angoissée sur les causes de la débâcle française contre l’armée allemande en 1940. La participation à la victoire finale n’a pas effacé ce sentiment de déclin de la puissance, comme en témoigne un livre majeur sous la plume de l’historien et officier Marc Bloch, rédigé sur le moment et paru en 1946 : L’Étrange défaite. Après la guerre, la décolonisation, les chocs pétroliers, la crise économique, le chômage de masse et la crise de l’État-providence nourriront la littérature décliniste à partir des années 1970.
Notre époque est quant à elle marquée par l’angoisse de la dissolution de la France dans la mondialisation, une perte d’identité causée par une immigration non contrôlée et la perte de sens de l’histoire nationale. Le fantasme du « grand remplacement » des Français par une population arabo-musulmane conquérante est le symptôme d’une angoisse que le rappel des chiffres sur la réalité de l’immigration en France, avancés par les esprits plus raisonnables, ne parvient pas à endiguer.
Au-delà de ses différentes manifestations, plusieurs traits communs unissent la pensée décliniste. Celle-ci repose avant tout sur une conception organique de la société française, conçue comme un être vivant dont chaque partie est en principe en harmonie avec l’ensemble, mais dont la dégénérescence se manifesterait lorsque certains éléments se détachent au détriment de la cohérence qui fait son unité. La destruction d’un ordre ancien, l’intégration d’apports extérieurs, le déclin de la foi majoritaire ou la modernisation de modes de vie historiquement enracinés sont autant de déclencheurs d’une transformation sociale jugée coupable du déclin. Cette pensée antimoderne repose sur l’obsession nostalgique d’une grandeur révolue, qui conduit les déclinistes à auréoler le passé d’une lumière de légende. Face à l’histoire en mouvement, à ce que le philosophe Claude Lefort nomme « la dissolution des repères de la certitude », ils opposent la « France éternelle », la permanence du passé dans le présent, la régurgitation sans fin des gloires et des blessures de l’histoire, le culte des morts glorieux face aux contemporains forcément médiocres. Leur ambition est d’alerter le peuple innocent des misères qu’on lui cache, et de la trahison des élites, coupables de concessions excessives à l’esprit du temps. À longueur de pages, chacune de leurs analyses apocalyptiques semble dessiner une situation désespérée. Mais les déclinistes sont de faux pessimistes. Tous vantent un possible « sursaut », seule solution pour sauver la France. « Tout est perdu… à moins que l’on fasse ce que je propose » est leur leitmotiv.
Le mythe de l’homme providentiel, introduit par Napoléon Bonaparte et popularisé par le général de Gaulle, est le débouché naturel de la tentation décliniste dans la vie politique. Face au déclin, un homme surgit, qui tire le pays du caniveau. Par un mélange de neurasthénie et de lecture messianique de l’histoire, de Gaulle a souvent usé de la ficelle du déclin pour asseoir son pouvoir et se poser en rempart contre la déchéance. Il aura été probablement le seul grand décliniste à connaître la responsabilité du pouvoir, tout en sachant que la restauration de la grandeur française demeurait, même sous sa houlette, hautement illusoire.
Aujourd’hui que se présente au portillon présidentiel un nouveau prophète du malheur français, l’on devrait se souvenir que dans l’histoire de ce pays, les sauveurs de pacotille, du général Boulanger à Jacques Doriot ou au maréchal Pétain, furent plus nombreux que les héros. Et que l’opprobre aura été la rançon la plus courante pour ces candidats au sauvetage d’une vieille nation qui ne leur avait, le plus souvent, rien demandé.
Cartes sur table
David Djaïz
Nicolas Baverez
L’avocat et essayiste Nicolas Baverez – qui publia en 2003 son fameux ouvrage La France qui tombe (Perrin) – et le haut fonctionnaire David Djaïz, enseignant à Sciences Po et auteur récemment du Nouveau modèle français (Allary), nous livrent leur vision dans une discussion appro…
[Déclinomania]
Robert Solé
DEUX idées-forces, à se mettre bien dans la tête :
1) C’était mieux avant.
2) C’est beaucoup mieux ailleurs.
Se défaire de la défaite
Thomas Schlesser
Un homme, isolé au milieu d’une bataille fumante, se relève à grand-peine. Il redresse le buste, yeux fermés. Ce tableau est un des symptômes les plus poignants du traumatisme de la défaite française contre la Prusse en 1870, défaite qui est elle-même synonyme d’un sentiment de déclin paroxystiqu…