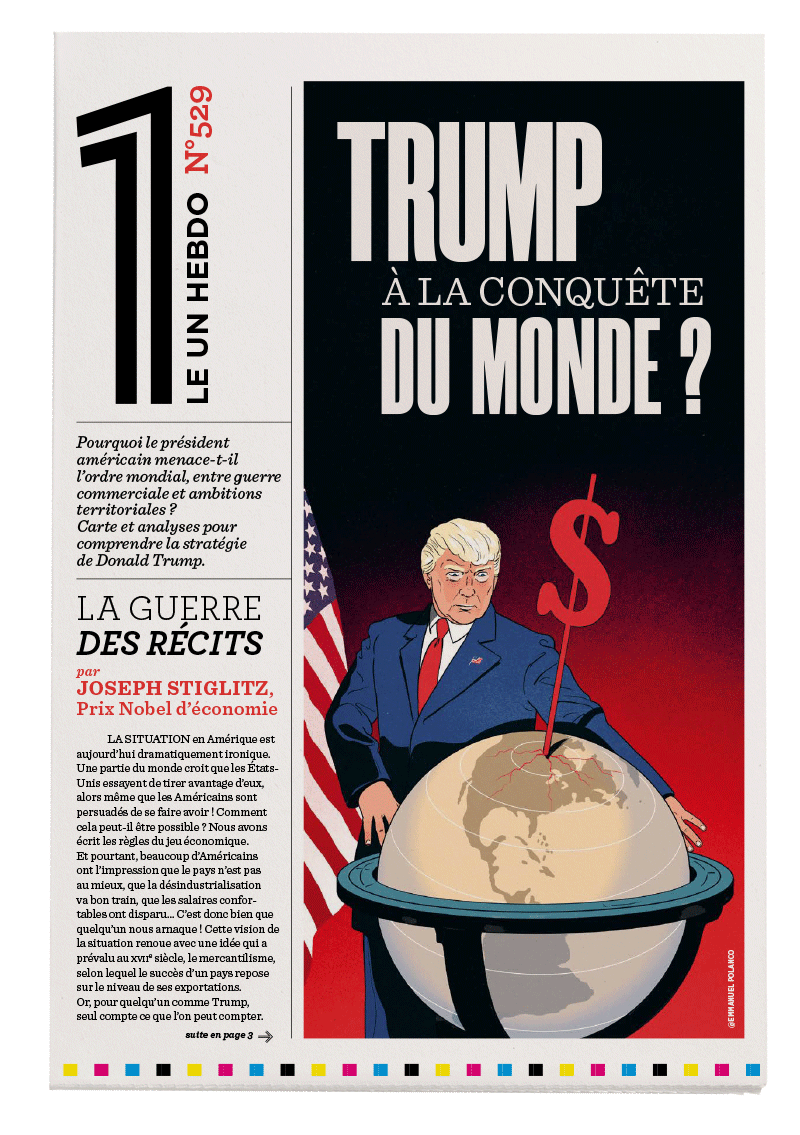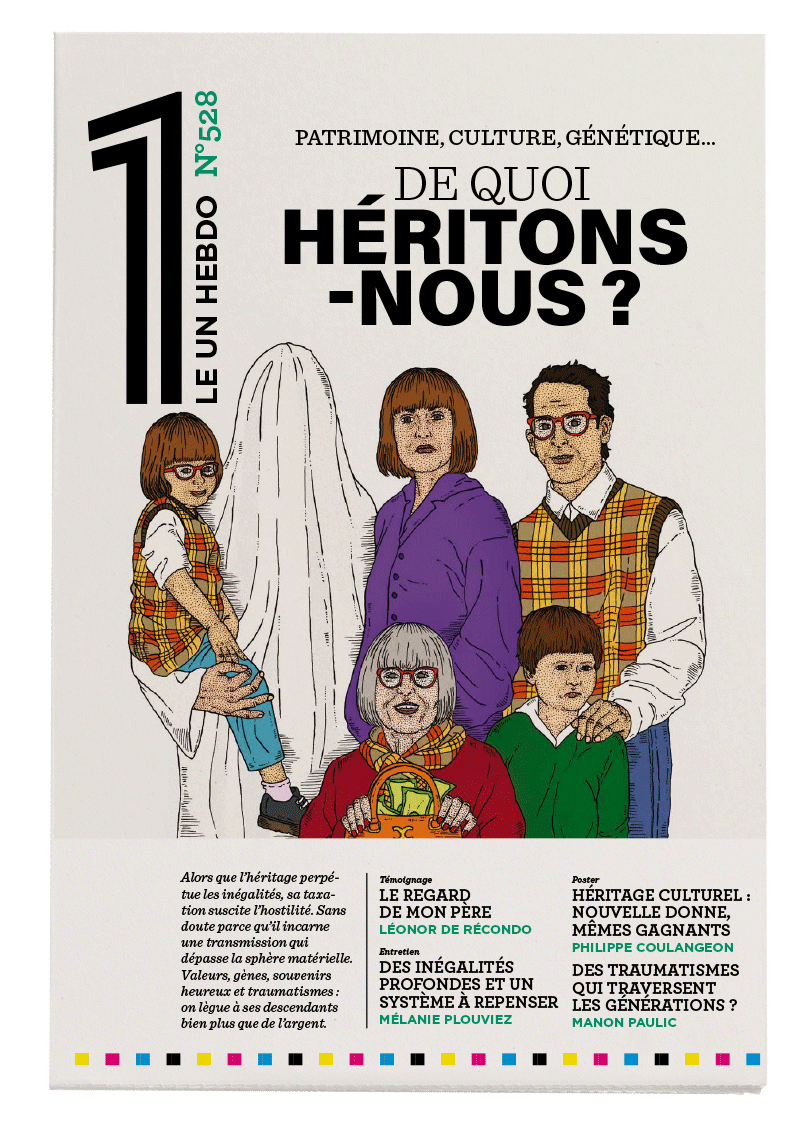Au-delà des chiffres
Temps de lecture : 3 minutes
Un déclin peut-il se mesurer ? Dans la jungle des indicateurs statistiques, il en est à coup sûr un qui domine aujourd’hui : le PIB. « Facile à calculer, le niveau de PIB et de revenu par habitant est le plus significatif et c’est là que le “déclin français” apparaît le plus tangible », pouvait-on encore lire le 12 novembre dans Le Figaro. Vraiment ? Créé en 1934 aux États-Unis pour suivre les effets de la Grande Dépression, cet outil d’évaluation de la production de richesse a certes son utilité. Mais, outre qu’employer un indicateur susceptible d’inclure des trafics illégaux de drogue ou des activités de prostitution pour mesurer les progrès d’un pays pose problème, les projections fantasmatiques dont le PIB est l’objet sont de longue date critiquées. Celui-ci a en effet d’étranges propriétés : indifférent aux fruits du bénévolat ou du travail domestique, il ne tient pas compte du coût social et écologique de l’activité économique et croît avec les guerres et les accidents de voiture, qui font tourner les services d’assurance et l’industrie… Comme le disait l’ancien candidat à l’investiture démocrate Robert Kennedy en mars 1968 : « Le PIB mesure à peu près tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d’être vécue. »
De plus en plus fortes à partir des années 1990, réserves et critiques ont amené à l’invention de nouveaux indicateurs. Au début de cette décennie, l’économiste indien Amartya Sen propose ainsi d’adjoindre au PIB le niveau d’éducation et l’espérance de vie à la naissance, inventant le plus célèbre d’entre eux, l’indice de développement humain (IDH). Des démarches intéressantes mais non sans limites, si l’on admet qu’il s’agit de faire la moyenne de valeurs quantifiant des réalités sans commune mesure : sécurité et liberté de la presse, éducation et pollution… Ajoutez à cela la variation selon les époques et les pays des méthodes de calcul, et les comparaisons géographiques et historiques s’avéreront souvent hasardeuses.
Loin d’être implacables et neutres, les chiffres sont donc délicats à manier, c’est entendu. Mais la querelle du déclin tient-elle à cela ? Attribuant celui de Florence à la « différence existant entre notre éducation et celle des Anciens », Machiavel n’avait certes pas en tête le classement Pisa : ce qu’il blâmait, c’était la perte de la virtù, la vertu républicaine héritée de la Rome antique. De fait, depuis Platon et Salluste, à l’acmé de la puissance et de l’opulence d’un empire – fruit trop mûr aux chairs déjà amollies –, les « déclinistes » préfèrent la jeunesse d’une cité tendue dans son ascension par des principes spirituels (ceux, en général, de l’auteur). Ce qu’ils redoutent, derrière le déclin, c’est la crise de l’esprit, la décadence. D’Ibn Khaldoun à Toynbee en passant par Montesquieu, Gibbon ou Spengler, les esprits amateurs de grandes synthèses historiques se sont retrouvés, malgré la diversité voire l’opposition de leurs thèses et de leurs conclusions, autour de l’idée qu’au cœur de l’effondrement se trouve un renoncement. « Les civilisations meurent de suicide, pas d’assassinat », plaide l’anthropologue Jared Diamond. Fataliste ou non, le diagnostic du déclin ne se résume donc jamais à une querelle de chiffres ; il est souvent davantage affaire de morale et dépend toujours de l’idéal qu’on se donne pour référence.
C’est d’ailleurs cet idéalisme qui, aujourd’hui, est plus profondément attaqué : l’idée même du déclin présuppose en effet celle, complexe, d’identité. En somme, pour pouvoir se perdre, se dissoudre ou se nécroser, encore faut-il qu’existe quelque chose de stable comme « une certaine idée de la France ». Une époque plutôt prudente face aux abstractions, voire hostile à elles, peut être tentée d’en douter. En attendant que soit tranché cet éternel débat philosophique, le pessimisme reste, lui, un sentiment aux effets politiques bien concrets.
Cartes sur table
David Djaïz
Nicolas Baverez
L’avocat et essayiste Nicolas Baverez – qui publia en 2003 son fameux ouvrage La France qui tombe (Perrin) – et le haut fonctionnaire David Djaïz, enseignant à Sciences Po et auteur récemment du Nouveau modèle français (Allary), nous livrent leur vision dans une discussion appro…
[Déclinomania]
Robert Solé
DEUX idées-forces, à se mettre bien dans la tête :
1) C’était mieux avant.
2) C’est beaucoup mieux ailleurs.
Se défaire de la défaite
Thomas Schlesser
Un homme, isolé au milieu d’une bataille fumante, se relève à grand-peine. Il redresse le buste, yeux fermés. Ce tableau est un des symptômes les plus poignants du traumatisme de la défaite française contre la Prusse en 1870, défaite qui est elle-même synonyme d’un sentiment de déclin paroxystiqu…