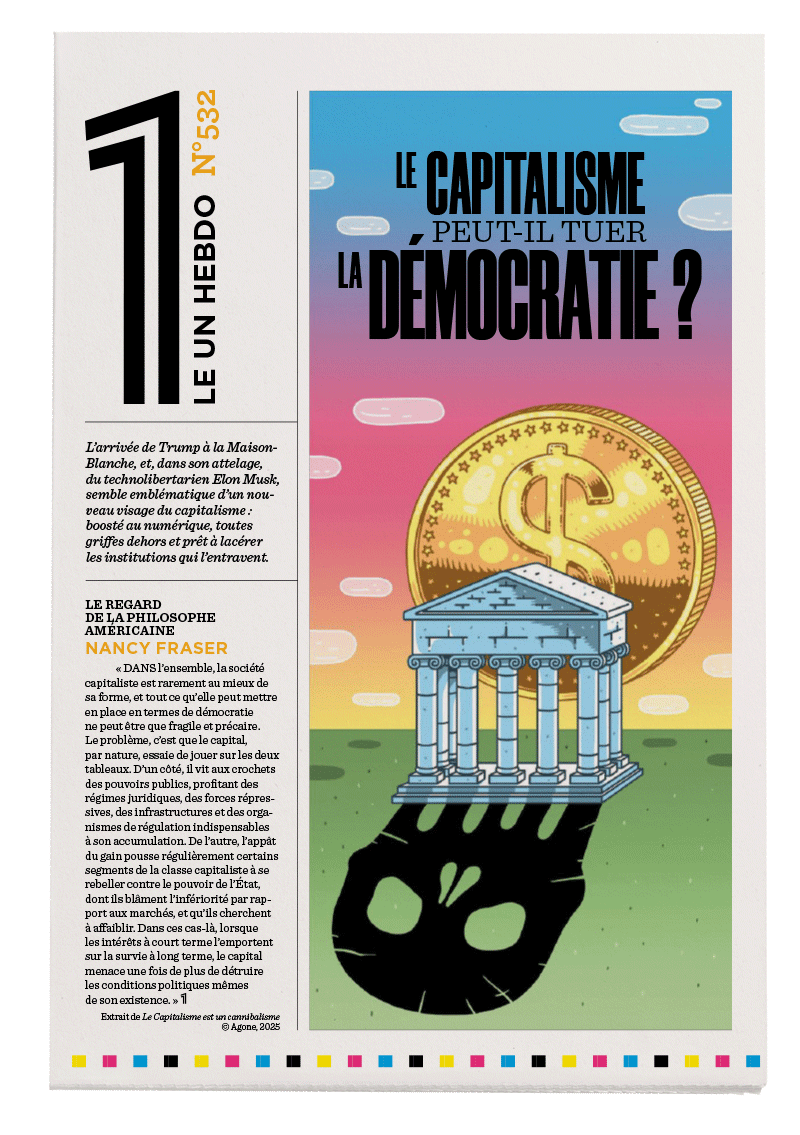« Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent »
Temps de lecture : 7 minutes
L’émergence du capitalisme est-elle allée de pair avec celle de la démocratie moderne ?
Cela a beaucoup été dit parce qu’il y a eu une coïncidence en Angleterre entre un surplus de liberté accordé par le roi et l’expansion d’une forme de capitalisme. Mais ce n’était pas du tout vrai dans d’autres pays, comme la France du xviie ou du xviiie siècle, laquelle a participé pleinement au capitalisme sans être démocratique pour autant. Pour moi, il n’y a pas de concomitance.
Quelles grandes phases du capitalisme peut-on distinguer depuis cette époque ?
La période qui commence au xviie siècle, que nous appelons « âge du commerce » dans le livre que j’ai écrit avec Pierre François, paraît assez exotique aujourd’hui : les entreprises étaient petites et organisées en réseau, avec des ateliers de moins de dix personnes, de petites sociétés de commerce, des banques, qui passaient des contrats en permanence. Ce modèle a été dominant jusqu’à la fin du xixe siècle, avant d’être remplacé par quelque chose de plus familier : de grandes entreprises avec énormément de salariés, comme General Motors ou Ford. C’est ce que nous appelons l’« âge de l’usine ».
Une phase différente s’est sans doute ouverte dans les années 1970-1980, avec l’« âge de la finance ». Le périmètre des entreprises varie alors sans cesse, selon les fusions ou scissions, et celles-ci travaillent avant tout en vue de la rentabilité à court terme pour les actionnaires - qui sont parfois des personnes individuelles mais surtout des fonds de pension ou de placement. Certes, durant l’« âge de l’usine », les entreprises avaient également des actionnaires, mais elles les rémunéraient juste assez pour qu’ils ne retirent pas leurs parts. Tout n’était pas optimisé en permanence dans le but de payer le maximum de dividendes.
« Il faut bien comprendre, pour commencer, que le capitalisme a besoin de l’État »
Comment ont évolué les liens entre capitalisme et État au fil de ces périodes ?
Il faut bien comprendre, pour commencer, que le capitalisme a besoin de l’État – pour garantir le droit de propriété et l’ordre, pour faire tourner les tribunaux en cas de besoin… Ensuite, les relations entre capitalisme et puissance publique varient en fonction des acteurs économiques dominants à chaque période. Durant l’« âge du commerce », par exemple, les entreprises étaient très réticentes à être contrôlées. En France, la loi interdisant le travail des enfants date de 1841 mais il a fallu cinquante ans avant qu’elle ne soit effective. Il n’y aura pas non plus d’inspection de la qualité des produits avant la fin du xixe siècle. Quant à l’impôt sur les sociétés, à l’époque, il n’existe tout simplement pas. Dans beaucoup de pays, les grands négociants étaient aussi des banquiers et prêtaient aux États, qui n’avaient donc pas du tout envie de se fâcher avec eux. On trouve à cette période des traces de ce que l’on appellerait aujourd’hui du lobbying : par exemple, lorsqu’il a été question de réduire le temps de travail des ouvriers à 10 heures voire 9 heures par jour, après la révolution de 1848, les commerçants ont écrit aux députés ou aux ministres pour exprimer leur mécontentement.
Le refus de l’impôt et de la contrainte semble refluer lors de l’« âge de l’usine », de la fin du xixe à celle du xxe siècle. Les capitalistes acceptent de contribuer à l’action de l’État pour que celui-ci se charge de la santé ou de l’éducation de la future main-d’œuvre. Dans cette période industrielle, l’État se sent également tenu d’écouter d’autres intérêts avant de prendre des décisions économiques : les syndicats, les défenseurs des consommateurs, plus tard les associations écologistes… En Europe, au Japon, des normes sur la qualité des produits ont été adoptées – par exemple, pour qu’on cesse de vendre des jouets inflammables. Aux États-Unis, la lutte pour les droits civiques a contraint les entreprises à cesser leurs pratiques d’embauche discriminatoires… Tout cela est une question de rapport de force.
Cet « âge de l’usine » est également une période où les entreprises se regroupent en organisations patronales ou de branche, comme la métallurgie, qui avait un poids immense durant les Trente Glorieuses.
Que change la financiarisation de l’économie, dans le dernier quart du xxe siècle ?
Avec la financiarisation, on a l’impression que le lobbying a repris le dessus. Cela s’explique d’une part parce que les entreprises sont devenues gigantesques – des sociétés de la taille d’Amazon ou de Walmart auraient été inimaginables dans les années 1950. Elles ont tendance à contourner leurs instances représentatives pour s’adresser directement aux gouvernements ou à l’Union européenne. Par ailleurs, la démocratie sociale – qui se caractérise par le dialogue entre les syndicats, le patronat, les experts, les associations… – passionne moins les partis politiques et les administrations. Une démocratie en bonne santé constitue normalement un contrepoids aux grandes entreprises.
« Avec la financiarisation, on a l’impression que le lobbying a repris le dessus »
Cette période marque aussi la montée en puissance des « clauses d’arbitrage », qui représentent à mes yeux une menace pour la démocratie. Il s’agit de dispositions incluses dans les traités de libre-échange depuis les années 1960-1970, qui protègent les investisseurs de quasi toute décision politique que pourraient prendre les États. Ainsi, lorsque l’Allemagne décide d’arrêter le nucléaire, l’entreprise qui lui fournit une partie de ses centrales est en droit de lui faire un procès pour perte d’opportunités de profit. Or, c’est normalement l’État qui a le monopole pour rendre la justice. Que des pays aient accepté d’être jugés par des tribunaux d’arbitrage privés représente une évolution vertigineuse.
A-t-on déjà connu des milliardaires aussi influents sur la marche du monde que les patrons de multinationales actuels ?
Oui, mais ce ne sont pas des périodes que l’on souhaite revivre. Cela fait penser au Gilded Age de la fin du xixe siècle aux États-Unis, l’âge en « plaqué or » : une période d’accroissement démesuré des entreprises du chemin de fer, du pétrole ou de la banque. Certains de leurs dirigeants, parfois milliardaires comme Rockefeller, prêtaient énormément à l’État et avaient la capacité de manipuler les gouvernements dans le sens qui leur convenait. Ce fut également le cas lors de la montée du nazisme en Allemagne, et de ses émules dans d’autres pays : plusieurs patrons très riches, comme le parfumeur François Coty, soutenaient les ligues d’extrême droite, prenaient le contrôle des médias, corrompaient les politiciens… C’est aujourd’hui une interrogation fréquente de l’autre côté de l’Atlantique : est-on entré dans un nouveau Gilded Age ?
À l’époque, aux États-Unis, le souvenir aigu de cette période avait entraîné la création de lois anti-trust et poussé F.D. Roosevelt à prendre des mesures qui ont abouti dans les années 1930 à l’imposition à 90 % des tranches supérieures de revenus. Mais les choses ont beaucoup changé depuis, notamment avec la fin du plafonnement des dons d’entreprise aux campagnes politiques. En France, les limites sont plus strictes, mais Julia Cagé a montré que, malgré ces restrictions, la campagne d’Emmanuel Macron en 2017 a bénéficié de dons cumulés très substantiels de la part de familles riches.
« Son objectif n’est pas de démanteler l’État : au contraire, il veut en utiliser la toute-puissance pour son profit personnel »
L’ingérence d’un Elon Musk dans le fonctionnement de l’État est-elle inédite ?
En France, nous avons déjà eu des banquiers aux affaires – Georges Pompidou, par exemple, ou Jacques Laffite dans les années 1830, qui était à la fois l’un des plus grands banquiers de France et le président du Conseil. Mais ils ne venaient a priori pas au pouvoir dans le but de procéder à des coupes sombres, même s’ils ont pu adopter des mesures favorables au monde des affaires. D’autres milliardaires, comme Bill Gates, s’inscrivent dans une tradition de philanthropie, en bénéficiant de défiscalisation lorsqu’ils financent telle ou telle cause. Cela est certes moins démocratique que de payer des impôts, mais la démarche ne sert pas directement leur propre intérêt. Avec Elon Musk, l’ambiance est différente : il va couper dans certaines dépenses publiques, mais probablement augmenter celles qui l’intéressent, comme les subventions publiques à la recherche privée sur l’intelligence artificielle, ou l’achat d’armement à ses propres entreprises. Son objectif n’est pas de démanteler l’État. Au contraire, il veut en utiliser la toute-puissance pour son profit personnel.
Est-ce une forme de déclin d’un capitalisme technocratique et impersonnel ?
Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent. Dans les pays récemment décolonisés ou en Europe de l’Est après la sortie du communisme, le fonctionnement oligarchique, clanique, avec une corruption brutale, constitue bien souvent l’ordinaire de la vie politique. On pensait que ces pays allaient sortir de cette situation, mais c’est peut-être nous qui allons connaître une situation similaire à celle des États-Unis la fin du xixe siècle ou de la Russie des oligarques, avant que Poutine ne les mette au pas. Il n’y a pas de sens de l’histoire.
Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER
« Ils considèrent l’état comme un obstacle, voire comme un adversaire »
Quinn Slobodian
L’historien Quinn Slobodian, qui vient de publier Le Capitalisme de l’apocalypse, montre comment ce système économique tend désormais à transformer nos démocraties en passoire à coups de zones économiques spéciales échappant au droit commun. À la suite d'entretien, un glossaire.
[Oligarque]
Robert Solé
C’EST un très vieux mot, tiré du grec : l’oligarque désigne une personne puissante, membre d’un petit groupe qui détient le pouvoir. Aristote et Platon ne sont pas les seuls à avoir commenté ce système que la République romaine illustrerait dans ses institutions...
« Il est possible que l’on assiste au retour du pouvoir nu de l’argent »
Claire Lemercier
L’historienne Claire Lemercier analyse les différentes phases du capitalisme depuis son évolution et les variations de son rapport avec la démocratie.