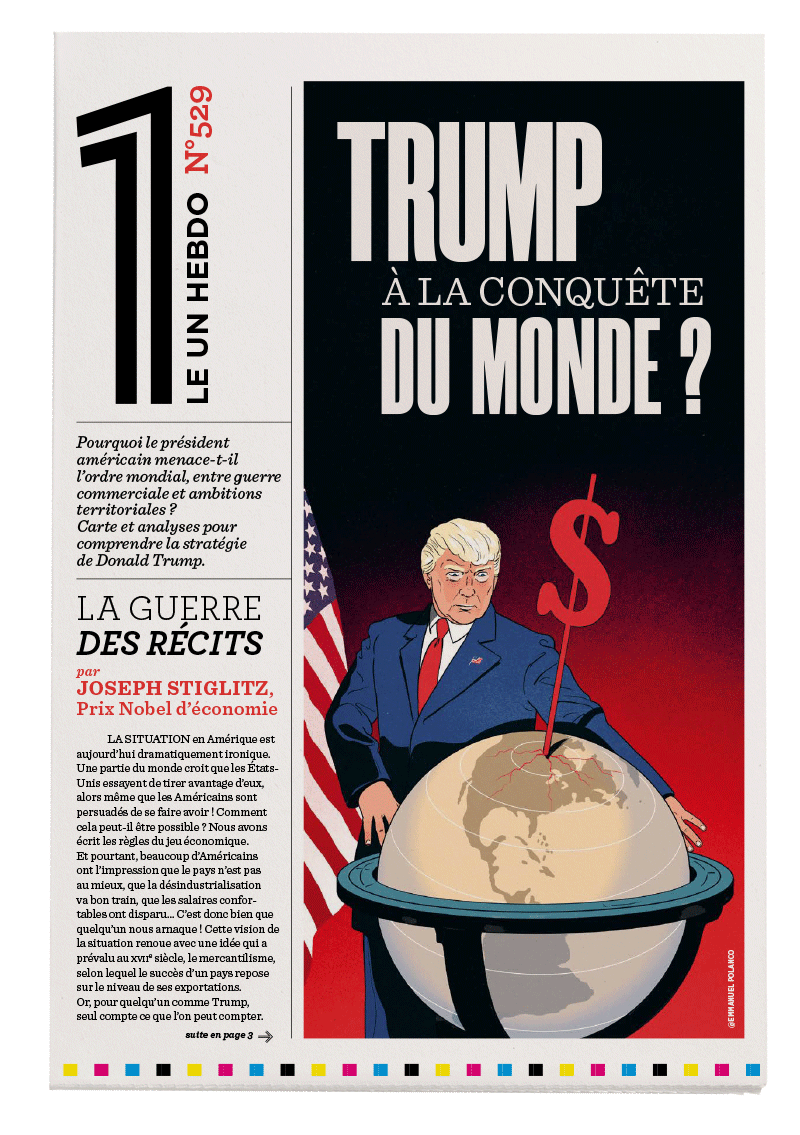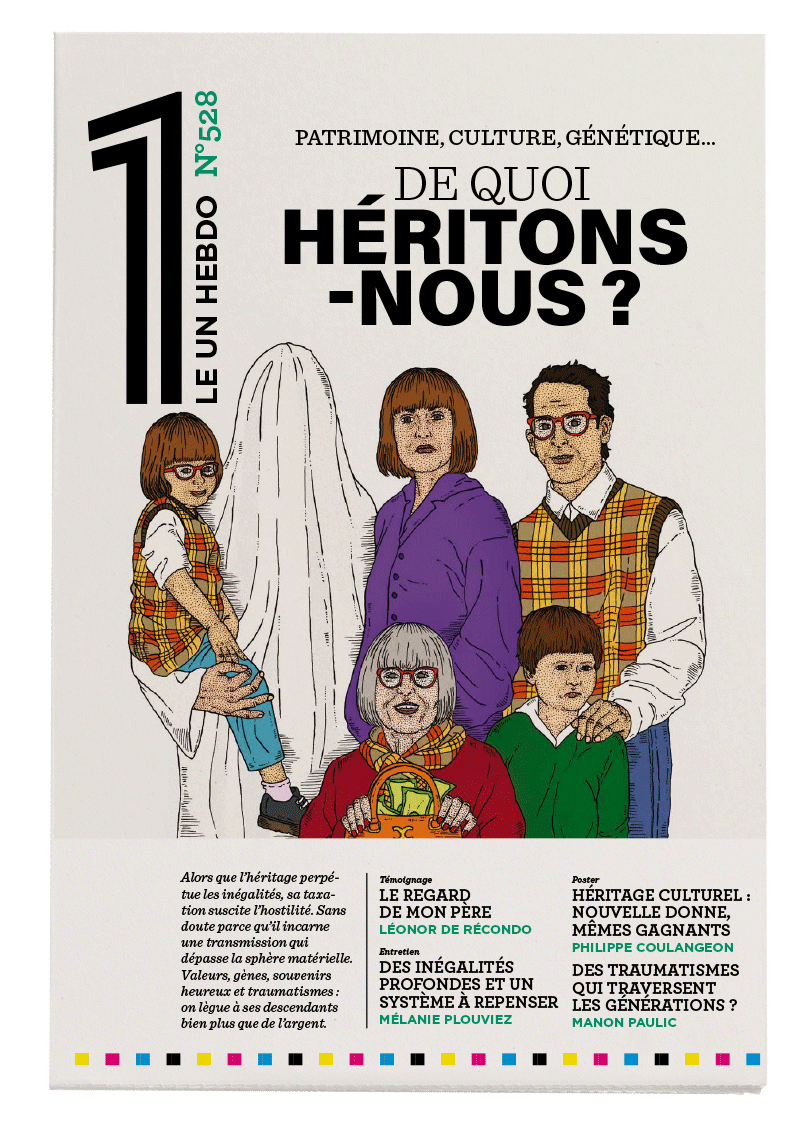« Pompidou n’aurait pas été Pompidou sans son sens politique aigu »
Temps de lecture : 9 minutes
Quel président a été Georges Pompidou ?
J’ai redécouvert Pompidou à la faveur du travail que j’ai effectué pour le Dictionnaire Pompidou [voir p. 6]. Succéder au général de Gaulle était terriblement difficile. J’ai assisté à ses débuts à l’Assemblée nationale, quand il s’est exprimé pour la première fois comme Premier ministre. Il a été très mauvais, car l’opposition l’a accueilli aux cris de « Rothschild, Rothschild ! », ce qui l’a complètement déstabilisé. Après son discours, dans la salle des pas perdus du palais Bourbon, j’ai trouvé le radical-socialiste Maurice Faure et François Mitterrand en conversation. Les journalistes agglutinés disaient : « Comme c’est décevant. » Mitterrand a rétorqué : « Vous avez tort, ce sera un grand orateur. » Or, à partir de là, il est en effet devenu formidable. On l’a vraiment découvert en Mai 1968. Il n’a pas vu dans cette révolte un simple mouvement de fils de famille indisciplinés. Il a compris que la société tout entière bougeait. D’où sa crainte de voir converger étudiants et ouvriers. Ce qui explique les accords de Grenelle, les liens qu’il tissa à ce moment avec les syndicats, en envoyant secrètement Chirac discuter, avant l’ouverture des négociations, avec le numéro 2 de la CGT, Henri Krasucki. Là, on s’est dit : il y a quelqu’un.
Je me souviens d’une forte scène : le jour de la disparition du Général à Baden-Baden, je suis tombée au Parlement sur Jacques Chirac, seul, qui croyait, lui aussi, se faire une idée de la température, sans savoir que les parlementaires avaient préféré prendre le large. Je le reverrai toute ma vie, avec son large sourire, l’air gai et totalement serein, s’écriant : « On s’en fiche, Pompidou est là ! »
De fait, quand je me suis penchée sur les conférences de presse de Pompidou, elles m’ont paru être un modèle.
En quoi ?
Ce n’était pas des conférences de presse pour rien. Il a commencé par dire aux journalistes qu’il en tiendrait deux par an, l’une en janvier, l’autre en septembre. La première fois, il a simplement annoncé : voilà quelle sera la relation entre vous et moi. Mais la suivante commença par son commentaire de l’affaire Gabrielle Russier et sa citation d’Éluard : « Comprenne qui voudra ! / Moi, mon remords, ce fut […] / La victime raisonnable […] / Au regard d’enfant perdue ». Cela montrait par là qu’il n’était pas n’importe qui, mais un professeur, normalien et agrégé de lettres. Citer Éluard plutôt que Péguy n’était pas un hasard non plus. Il faut souligner enfin les deux phrases qui précèdent sa citation : « Je ne vous dirai pas tout ce que j’ai pensé sur cette affaire… Ni même ce que j’ai fait. » Car en réalité il a essayé d’épargner à Gabrielle Russier l’excessive sévérité des juges, signe qu’il restait avant tout un humaniste.
Que voulait-il faire passer lors de ces rendez-vous avec l’opinion, à travers les médias ?
Il a d’abord montré qu’il assurait la continuité avec le général de Gaulle en étant, comme lui, concret et pragmatique. Et il feignait de s’irriter lorsqu’on lui posait pour la énième fois la question de sa fidélité aux dogmes gaullistes.
« La dimension humaine de la politique lui était la plus chère »
Le deuxième thème de ces rencontres avec les journalistes fut, justement, l’entrée du Royaume-Uni dans le marché commun. Sur ce sujet, il a marché sur la pointe des pieds. Il a commencé par laisser entendre, lors d’une première conférence, que ce serait une bonne chose, alors qu’il n’ignorait pas que le Général était contre ; et il a fini par annoncer en 1972 que le Royaume-Uni était prêt et qu’un référendum allait pouvoir se tenir. Le vote a été marqué par une abstention très haute – déjà –, à 40 %. Pompidou a tout de même obtenu une très bonne majorité, avec 68 %, mais cela ne lui suffisait pas : il a été très atteint par le désintérêt des électeurs pour un sujet qu’il jugeait capital.
Son troisième thème, enfin, fut l’industrialisation de la France, qui devait assurer sa modernisation, son expansion et, donc, son indépendance. Sur ce point, il avait raison sur tout.
Comment voyait-il cette industrialisation ?
Dans une dernière conférence de presse, il a suggéré : maintenons notre classe ouvrière et gardons la production chez nous. Ce thème a ensuite été passé sous silence. Dans ce domaine, son successeur, Giscard, pensait aux aspects monétaire et financier plus que social. Quant à la désindustrialisation, elle n’a commencé que sous la gauche, dans les années 1980. Pompidou restera ainsi comme le président de la réindustrialisation. Nul avant lui, ni sans doute après, n’en a fait son ardente obligation. Une anecdote : j’étais à l’inauguration du tronçon de l’autoroute A6 entre Lyon et Dijon, en 1970, et je me souviens que le président a pris sa voiture et est parti si vite que personne n’a pu le suivre. Le préfet était très embêté, car le véhicule a roulé comme une bombe, à 170 kilomètres-heure. Cette attitude était cohérente avec son choix de soutenir l’industrie : on ne pouvait pas être contre les bagnoles si on était pour l’industrie.
Quel portrait feriez-vous de lui, aujourd’hui ?
Je soulignerais ses contradictions : il était à la fois joyeux et parfois très coléreux, presque vindicatif. Il était le symbole d’un conservatisme éclairé et un moderniste qui se levait la nuit, avec son épouse Claude, pour replacer des tableaux à l’Élysée ! On fut surpris de l’arrivée des premières sculptures fantastiques de François-Xavier Lalanne dans la salle à manger présidentielle. Quel contraste avec Giscard, son successeur, qui détestait l’art moderne ! Enfin, Pompidou, sans avoir fait ses classes dans le sérail, avait un côté ultrapolitique.
Que vous inspire la nostalgie du pompidolisme ?
Si on parle de ces années comme de temps heureux, c’est qu’il y avait de la croissance. C’est aussi que Pompidou rassurait, à l’inverse de Giscard ou de Mitterrand, qui avait la confiance d’une partie de la population mais inquiétait l’autre. « Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ça sera la révolution », a-t-il déclaré en 1967… Dans ses conférences de presse, De Gaulle avait toujours un mot marquant et inattendu, comme lorsqu’il a évoqué le « volapük » [langue créée de manière artificielle à la fin du XIXe siècle pour servir à une échelle internationale, sans grand succès]. Pompidou, quant à lui, recourait beaucoup aux citations. En une sorte de clin d’œil aux amateurs de littérature, il avait plaisir à convoquer Chateaubriand, Rimbaud, Jean Giraudoux ou même, dans un genre plus léger, Courteline. Et l’on se souvient comment il accueillit Jacques Chirac, jeune énarque de 34 ans, venu en 1966 lui faire signer une pile de parapheurs : « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! » Il ne jouait pas de sa culture, mais il en avait. Aujourd’hui, je dirais plutôt qu’au sein de la classe politique, on joue de sa culture alors même que l’on n’en a pas…
Les Français se sentaient-ils proches de Pompidou ?
Sans doute, du fait de sa fibre rurale, qui était authentique. Le Cantal était très important pour lui. Il était né à la campagne. En cela, il n’était pas si éloigné de Mitterrand, mais avec des lectures différentes – à 18 ans, Mitterrand lisait Maurras quand Pompidou, suivant les recommandations de son père, lisait Jaurès. Il avait ce côté proche des gens qui a manqué à Giscard. La dimension humaine de la politique lui était la plus chère. Après tout, faire de la politique, c’était aussi vouloir, à ses yeux, que les hommes et les femmes d’un pays soient plus heureux, même si, au fil du temps, il s’est aperçu que les Français n’étaient pas faciles à gouverner.
En 1968, quelques mois après son remplacement à Matignon, la découverte du cadavre de Stevan Marković, ancien homme à tout faire d’Alain Delon, lié au milieu du banditisme, va servir à nourrir de folles rumeurs au sujet de prétendues parties fines auxquelles aurait pris part Claude Pompidou. Quelles traces a laissées en lui cette affaire ?
Chirac disait qu’elle l’avait profondément marqué dès lors que son épouse avait été attaquée. Ce fut un choc pour lui, surtout à cause du doute qu’il avait sur l’attitude de De Gaulle lors de cette affaire. Au départ, le Général a pris cela à la légère. Pompidou est venu lui expliquer que ce scandale venait des gaullistes de gauche, peut-être même de Couve de Murville, alors Premier ministre. Au bout du compte, on ne sait ce que de Gaulle et lui se sont dit. Il n’y a jamais eu entre eux de vraie réconciliation.
Leur entente politique s’était-elle aussi distendue ?
Oui. Après les événements de 1968, Pompidou souhaitait des législatives anticipées, quand de Gaulle voulait un référendum. C’est Pompidou qui a eu gain de cause, et ces élections, en leur donnant une majorité absolue, ont été un triomphe. Pompidou n’aurait pas été Pompidou sans son sens politique aigu. Y compris dans la tempête de 1968. Quand, lors de déplacements à Rome en janvier 1969, puis surtout à Genève le mois suivant, Pompidou s’est dit prêt à assumer un destin national, la France a su qu’il existait un successeur à de Gaulle. Cela s’est confirmé assez vite : le Général, après l’avoir remplacé par Couve de Murville en 1968, a finalement tenu à proposer aux Français un référendum, l’année suivante. Bien des électeurs de droite qui pensaient que le Général avait fait son temps n’avaient plus peur du vide. Ils savaient Pompidou prêt. Cela a beaucoup pesé dans leur vote individuel, leur « non » à ce référendum, qui a conduit au départ du Général.
Auxquels de ses successeurs peut-on trouver des ressemblances avec Pompidou ?
Pas avec Giscard. Giscard s’invitait ainsi à déjeuner chez des Français pour asseoir sa popularité, s’inspirant de Louis XI [réputé avoir arpenté les rues de Paris de manière anonyme pour apprendre ce qu’on disait de lui]. Se référer à ce que faisaient les rois était particulier… Mitterrand, lui, avait beaucoup de points communs avec Pompidou, mais il était moins financier et, alors qu’il y a eu une continuité entre le Pompidou Premier ministre et le Pompidou président, il y a eu beaucoup de réajustements entre les deux septennats de Mitterrand – 90 % de ses 110 propositions ont été réalisées tout de suite, avant le tournant de la rigueur, puis sont venues les privatisations du second mandat. Quant à Chirac, il adorait Pompidou. C’était son modèle absolu. Pompidou avait trouvé en Chirac une jeune pousse dont il était fier, après que celui-ci eut pris la Corrèze et entraîné derrière lui une poignée de compagnons, plus ou moins chanceux dans leur conquête du sud-ouest et du centre de la France. Il savait qu’il pouvait compter sur lui. Mais il n’a pas été d’accord quand sa conseillère Marie-France Garaud, l’année de sa mort, lui a proposé de le nommer Premier ministre. Pompidou a jugé qu’il n’était pas prêt et a préféré le nommer à l’Intérieur [de février à mai 1974]. Cela étant, il a beaucoup appris à Chirac. Leurs relations ne pouvaient être d’égal à égal, il y avait un professeur et un élève. Hollande, enfin, lui ressemble assez, mais en moins aigu. Il y a une bonhomie chez le socialiste, quand Pompidou avait un côté aigle, oiseau de proie. On peut toutefois dire que l’un et l’autre ont eu en commun une forme de roublardise !
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO
« Pompidou n’aurait pas été Pompidou sans son sens politique aigu »
Michèle Cotta
La journaliste politique, qui a elle-même couvert les années Pompidou, revient sur la trajectoire politique d’un homme plus complexe qu’il n’y paraissait, conservateur éclairé, amateur d’avant-gardes, doté, sous ses atours de lettré et d’amoureux de la campagne, d’un redoutable flair politique qu…
[Nostalgies]
Robert Solé
Suis-je nostalgique de la France des années soixante ou de mes jeunes années ? Les deux, sans doute, et elles sont intimement mêlées.
Une recette qui a fait son temps
Élie Cohen
Pour l’économiste Élie Cohen, Pompidou restera l’homme de l’« âge d’or de la politique industrielle française », lui qui encouragea l’émergence dans l’industrie d’acteurs puissants et de projets ambitieux, de Pechiney à Saint-Gobain, du TGV à Airbus. Mais ce « capitalisme de grandes unités liées …