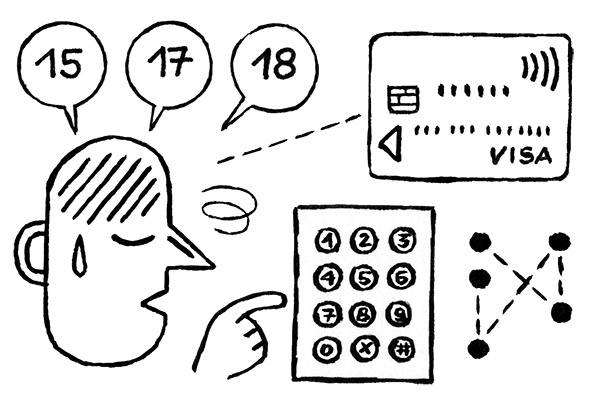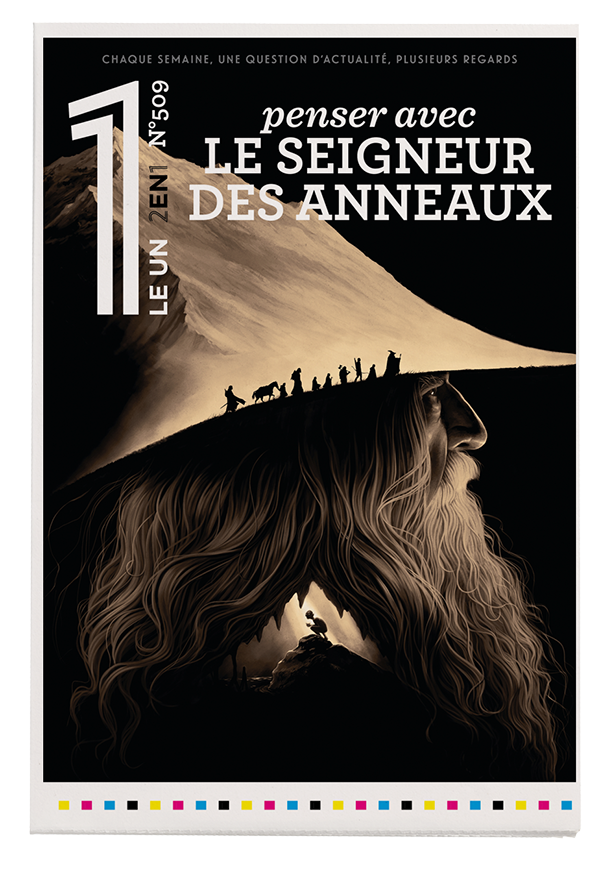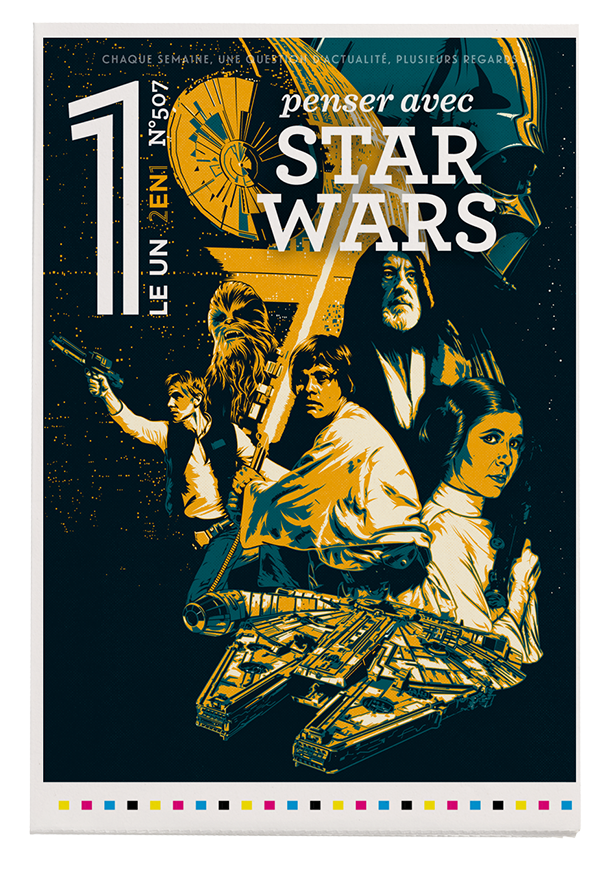« Le chiffre est toujours un instrument de pouvoir »
Temps de lecture : 10 minutes
Dénombrer, quantifier, est-il nécessaire à la vie démocratique ?
C’est capital. Au point que, dans le cas des États-Unis, le recensement est inscrit dans la Constitution. Il sert entre autres à déterminer combien d’élus chaque État pourra envoyer à la Chambre des représentants.
Dans les années 1930, pendant le New Deal, l’idée était aussi d’aider la population qui souffrait de graves carences alimentaires à subvenir à ses besoins. L’État a renoncé à se fier aux règles du marché, ce qu’il faisait jusque-là, pour davantage réguler l’économie. Pour cela, il avait besoin d’informations. Les enquêtes par sondage sont nées à cette époque. Il s’agissait de construire scientifiquement un échantillon de 1 000, 2 000 ou 3 000 personnes afin d’établir par projection des données valides pour l’ensemble de la population. Ce sont les prémices des sondages.
À partir de quel moment l’État cherche-t-il à évaluer les fonctionnaires, les administrations ? Quand met-il en place ce qu’on appelle le benchmarking ?
Le phénomène est né dans le monde anglo-saxon avec Ronald Reagan à la Maison Blanche et Margaret Thatcher au 10 Downing Street. À cette époque, l’État devient source de suspicion et ce mouvement de défiance entraîne une importation des techniques de management privé dans les administrations publiques. On se met à compter combien les agents règlent de dossiers et les données obtenues permettent de faire honte à ceux qui ne produisent pas assez (le shaming) et de fixer des objectifs quantifiés à atteindre (ce qui permet de motiver davantage les agents). La police new-yorkaise a utilisé ces méthodes. Ces techniques ont ensuite été importées en France, d’abord dans la police puis dans de très nombreuses bureaucraties.
Quelle est l’idée de départ de ce mouvement né dans les années 1980 ?
L’obsession de la productivité. La réponse, surtout dans des pays de culture sociale-démocrate comme en Europe, n’est pas de rétrécir la taille de l’État, mais d’améliorer son efficacité. Pour cela, il faut rendre les agents de l’État plus performants, donc les soumettre à ce genre d’évaluations quantitatives.
Sommes-nous toujours dans cette période ?
Les institutions les plus en pointe sont sorties de cette phase. La police a arrêté de « benchmarker » les policiers en raison des protestations des fonctionnaires et d’un gros malaise interne. Ce qu’on a appelé la « politique du chiffre » a révélé une faille : ce système d’évaluation permanente créait de la fraude. Les agents gonflaient leurs chiffres. Peu à peu, les ministères renoncent à ce genre de techniques ou les emploient de manière plus secondaire.
À l’ère du big data, on accumule beaucoup de données chiffrées. Celles-ci sont-elles un reflet fidèle de la réalité ?
Elles ont peu de correspondances avec le monde réel ! Je m’explique : admettons que je veuille mieux connaître les modes de consommation des Français. Je m’adresse au groupe Carrefour pour accéder à sa banque de données, une base gigantesque avec les habitudes de consommation de tous leurs clients qui possèdent la carte de fidélité de l’enseigne. Étant donné la taille de l’échantillon, on pourrait penser qu’il est représentatif de la population. Or c’est faux. La clientèle de Carrefour présente des caractéristiques (plutôt périurbaine, classes moyennes-populaires, etc.) qui ne se confondent pas avec celles du reste de la population. L’échantillon peut être énorme sans être représentatif. Il ne permet pas de parler de la France. Trop de chiffres ou beaucoup de chiffres ne donnent pas nécessairement la solution.
À quels chiffres peut-on se fier ? Existe-t-il des sources valables ?
Il faut faire preuve d’humilité. Pour savoir si les chiffres sont crédibles ou non, il faut d’abord savoir qui les a produits. Il existe des auteurs légitimes. L’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) et l’Ined (Institut national d’études démographiques) sont des institutions tout à fait crédibles et les services statistiques ministériels aussi. On peut parfois les juger désuets, estimer qu’ils ne décrivent pas assez les problèmes actuels, mais ce sont de très bons chiffres. D’autres institutions ou associations font de même un travail extrêmement sérieux. Je pense à la qualité de celui d’Emmaüs. Mais vous avez aussi d’autres producteurs de chiffres comme la chambre des notaires qui calcule l’indice du prix du mètre carré des logements à Paris. L’Insee lui a accordé son label.
Dans les années 1970, la CGT a contesté l’indice des prix de l’Insee, allant jusqu’à créer son propre indice…
La CGT expliquait que le premier indice était pertinent pour les classes moyennes, pas pour les ouvriers, dont la consommation n’est pas la même. Elle a créé un nouvel indice, du reste avec la méthode de l’Insee, qui a d’ailleurs été bien accueilli. Pendant de longues années, Le Monde l’a publié. Et puis, cet indice des prix de la CGT a disparu… C’est un cas très intéressant. Personne n’a jamais expliqué les raisons de cette désaffection. L’intérêt s’est dissipé. Plusieurs questions se posent : pourquoi la CGT a-t-elle cessé de produire cet indice ? Est-ce lié à la « diminution » des effectifs de la classe ouvrière ? Il y aurait à faire une sociologie de la pertinence des statistiques.
Le produit intérieur brut (PIB) est aussi contesté. Pourquoi des économistes ont-ils demandé que la richesse des pays soit observée avec d’autres lunettes, en intégrant des notions comme l’éducation, le bonheur ?
Le PIB est une mesure de la production des nations qui semble de plus en plus biaisée. Comment comprendre qu’il ne prenne pas en compte un élément capital : le travail domestique, ou bien l’éducation des enfants, encore massivement prise en charge par les femmes ? Cela revient à ignorer une partie du travail de la moitié de la population. Ensuite, la production peut être en contradiction avec la défense de notre environnement. Lors de la marée noire provoquée par le supertanker Amoco Cadiz, en 1978, le PIB français a grimpé parce qu’il a fallu nettoyer les plages… Ce travail a nécessité des embauches et donné pas mal de travail à des entreprises locales, etc. Une catastrophe écologique pouvait donc être jugée positive pour des raisons purement comptables ! Il y a eu depuis une prise de conscience. Le PIB était un bon indice pour la société française des années 1950-1960, une société industrielle classique qui misait tout sur la production. Cela ne suffit plus !
Pourquoi les statisticiens continuent-ils alors à se référer au PIB ?
Une statistique n’a de valeur que si elle est stable et durable. Si vous changez de statistique tous les vingt ans, vous perdez des repères stables qui permettent de mesurer les évolutions. Les statisticiens sont donc atteints d’une véritable schizophrénie : d’un côté, ils veulent s’adapter au monde contemporain ; de l’autre, ils veulent maintenir leurs repères pour avoir des mesures de comparaison. Pour le PIB, l’Insee rajoute désormais des comptes annexes, pour dessiner à quoi ressemblerait un PIB calculé autrement.
A-t-on besoin des mêmes chiffres pour conduire toutes les politiques ?
Non. Pour mener une politique keynésienne, par exemple, j’ai besoin de la comptabilité nationale, afin de mesurer le PIB. Pour une politique néolibérale, j’ai besoin des méthodes de benchmarking. Il y a donc une politisation des méthodes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’elles sont biaisées ou non scientifiques ! Simplement qu’elles correspondent bien à telle ou telle visée politique. Le chiffre est toujours un instrument de pouvoir. D’où l’émergence du « statactivisme », cette idée qu’on peut s’emparer des chiffres dans une perspective militante.
De quand datez-vous sa naissance ?
L’irruption du benchmarking a été déterminante : à force d’être personnellement évalués, beaucoup de gens ont décidé de s’emparer de cet instrument pour évaluer leurs supérieurs. Comme dans une prise de judo, ils prennent la force du chiffre pour la retourner contre leur adversaire. C’est un phénomène récurrent depuis les années 1990-2000.
Quelles sont les méthodes de ce statactivisme ?
Nous en avons identifié plusieurs. D’abord, utiliser les chiffres des grandes institutions pour les retourner et mettre en lumière leurs biais. C’est ce qu’a fait le sociologue Pierre Bourdieu dans Les Héritiers, en montrant que l’Éducation nationale n’était pas égalitaire, mais validait au contraire le capital culturel des familles, reproduisant ainsi les inégalités. Ensuite, il y a la triche : puisque la seule mesure de la qualité de votre travail est une évaluation chiffrée, alors vous allez trouver des moyens pour l’optimiser. Troisième méthode : compter pour faire prendre conscience à l’opinion d’une réalité sous-estimée. C’est ce qu’ont fait les féministes en dénonçant les féminicides : le chiffre de 149 femmes assassinées par leur compagnon a marqué l’opinion. Il a aussi permis de créer un nouveau critère comptable, se distinguant de ce qu’on appelait hier les crimes passionnels. Idem pour les statistiques ethniques, qui commencent à être produites par des groupes militants.
Y a-t-il une défiance plus forte que par le passé face à cette accumulation de chiffres ?
Jusque dans les années 1990, les chiffres s’imposaient par leur simple nature scientifique. Cette idée a été battue en brèche par les sociologues comme par les militants et, à partir des années 2000, le chiffre est devenu naturellement suspect. Aucune de ces deux postures n’est la bonne. Ce qui est certain, c’est qu’il est plus facile aujourd’hui de produire des « contre-chiffres », mais, comme ils ne sont pas fournis par les autorités traditionnelles, il est plus difficile d’en contrôler la fiabilité.
Sommes-nous soumis aujourd’hui à une dictature des chiffres ?
Il n’y a pas réellement de dictature des chiffres, mais plutôt une domestication du chiffre, avec qui nous devons vivre. Simplement, les chiffres contribuent à la conformation de notre monde, au même titre que le langage.
La mise en nombres de notre vie peut-elle nous permettre de l’améliorer ?
Il existe tout un courant empreint d’une forme d’éthique protestante, qui culmine aujourd’hui avec le quantified self, cette propension à mesurer des données sur nous-mêmes (nombre de pas effectués, calories ingérées, nombre d’heures de sommeil, activité sexuelle…). Les applications numériques le permettent de plus en plus. Alors c’est un phénomène sans doute positif pour la santé, mais qui implique que notre vie soit dominée par des objectifs clairs – ce qu’on peut discuter. Vaut-il mieux partager un dîner gras et arrosé avec des amis ou marcher seul toute la soirée ? Ça se discute…
Propos recueillis par JULIEN BISSON & LAURENT GREILSAMER
« Le chiffre est toujours un instrument de pouvoir »
Emmanuel Didier
Dénombrer, quantifier, est-il nécessaire à la vie démocratique ?
C’est capital. Au point que, dans le cas des États-Unis, le recensement est inscrit dans la Constitution.…
[Best of]
Robert Solé
En cette fin d’année, qui était aussi la fin d’une décennie, les médias nous ont comblés. Chacun y est allé de son best of, fondé sur des statistiques, des sondages ou des like additionnés…
Notre alimentation à la loupe
Manon Paulic
Au supermarché, elles sont la clé d’une consommation éclairée. Logées aux coins des paquets d’emballage, les valeurs nutritionnelles des produits alimentaires se mesurent en grammes, en kilojoules, en pourcentages. Gl…