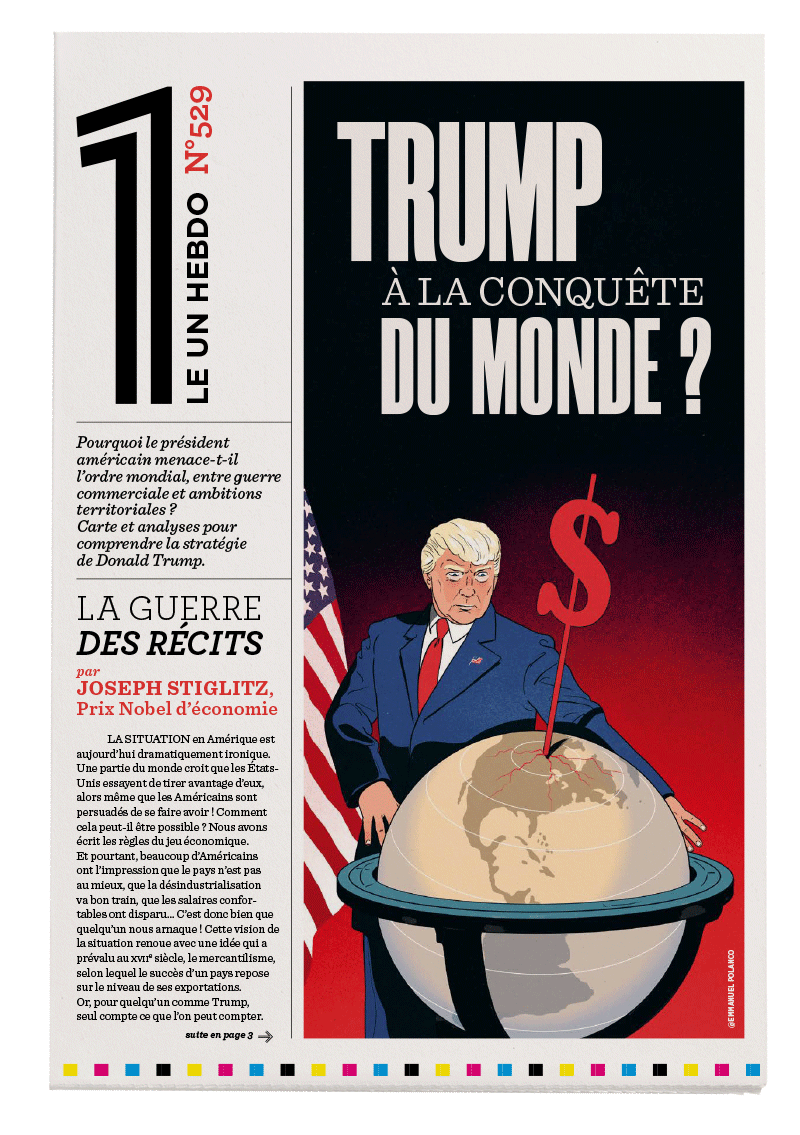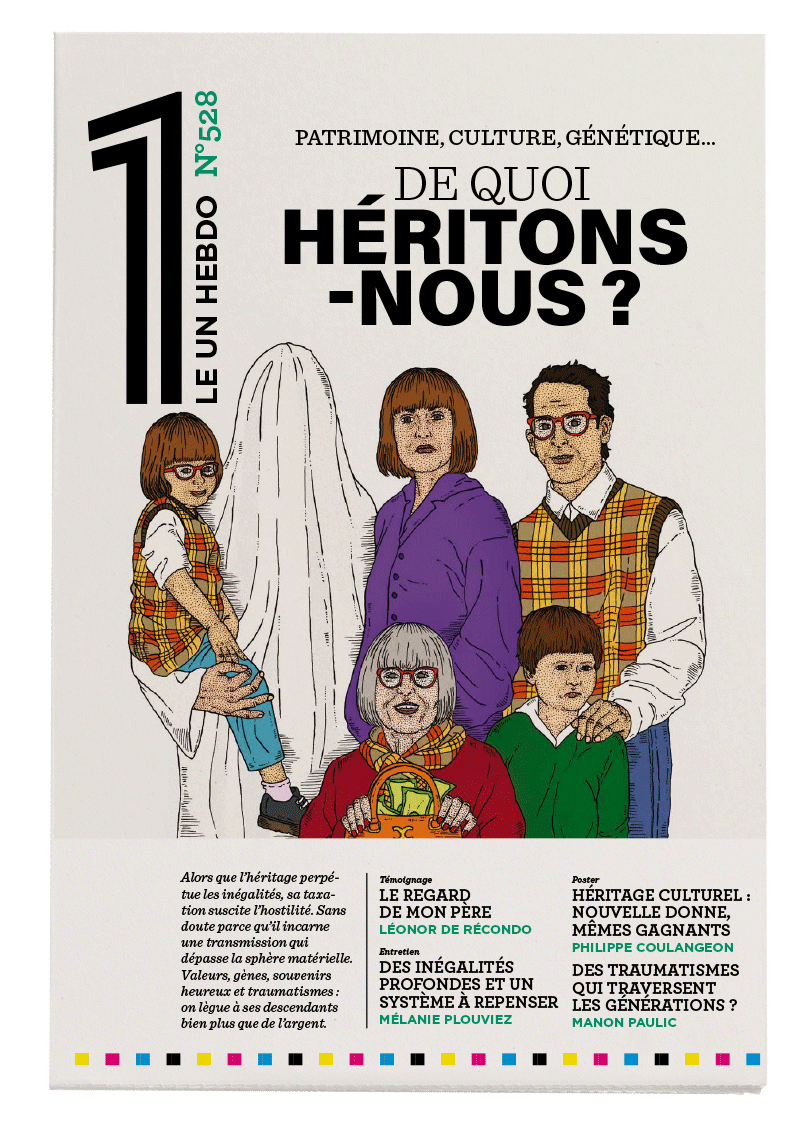Une vie normale
Temps de lecture : 5 minutes
L’enseignante d’un lycée pour filles m’a invitée à participer à son cours de littérature. Parmi le groupe d’élèves en manteau bleu marine, l’une se lève. Elle est mince, petite et porte des lunettes. Ses cheveux dépassent du bord de son voile. Elle dit : « Cette histoire ne peut pas être vraie. Est-il possible que quelqu’un qui essaie d’atteindre son but n’y parvienne pas ? Non, ce n’est pas possible. » Elle me fixe de ses yeux brillants et attend une réponse. Ma bouche devient sèche. Je n’ai pas de réponse à opposer à la volonté claire d’une fille de seize ans qui n’a pas encore été obscurcie par la réalité de la vie dans notre pays. Je lui dis : « Oui, ce n’est qu’une histoire, chérie. Celui qui essaie réussira. »
Il y a vingt ans. Mes deux copines et moi sommes assises sur le sol de l’école, devant des centaines d’autres élèves. On ne nous a pas donné de siège. Je frissonne de froid. Nous avons supplié pour avoir le droit de jouer à la fête de l’école. Nous avons promis de ne pas jouer de chansons joyeuses. Nous nous sommes entraînées tous les jours après l’école pendant deux mois. Avant le spectacle, ils ont vérifié si nos ongles étaient coupés court, si nos cheveux étaient bien cachés et s’il n’y avait pas de maquillage sur nos visages. Ils m’ont ordonné d’enlever la veste rose que je portais sur mon manteau et ont demandé à mon amie d’ajuster le foulard autour de son voile pour que le volume de ses cheveux ne soit pas visible. Nous jouons et les enfants applaudissent. La directrice, elle, nous surveille avec impatience. Nous n’avons joué que deux des cinq morceaux. Elle dit : « Arrêtez ! Ramassez vos instruments. »
J’ai un entretien d’embauche pour un poste universitaire. Documents, notes et lettres de recommandation sont prêts, j’ai passé en revue toutes les réponses aux questions possibles. Je maîtrise parfaitement la situation. Un homme est assis en face de moi. Il me demande : « Vous voulez venir à l’université en portant ce genre de tenue ? » Inconsciemment, je touche mon foulard pour mieux couvrir mes cheveux. L’homme me donne une longue liste de choses à ne pas dire et de choses à ne pas porter. Il me demande : « Où est l’islam dans votre livre ? » J’essaie de me contrôler. Je donne des explications sur l’état de la religion chez les jeunes. Il me coupe la parole et pose des questions sur la prière, l’autorité religieuse… Il n’est pas question de littérature. Il me semble que nous parlons deux langues complètement différentes. Désormais, je ne réponds plus à ses questions.
« Arrêtez ! Ramassez vos instruments »
Je suis venue au département de la censure. Mon deuxième roman n’a pas été autorisé et je suis ici pour parler au directeur. Ils ne me laissent pas entrer car mon manteau ne m’arrive qu’aux genoux et je porte un foulard au lieu d’un voile. Je le tire sur ma tête et entre enfin. La secrétaire du directeur, ennuyée, vérifie sur son ordinateur et dit : « Votre livre est totalement interdit. Il ne peut pas être corrigé. » Je lui réponds : « Dites-moi quel est le problème, je le résoudrai. Vous savez que pour mon premier livre, j’ai fait toutes les corrections que vous avez demandées. Il m’a fallu cinq ans pour écrire ce livre. Laissez-moi parler à votre directeur, je lui expliquerai. – Le directeur n’a pas le temps. – Quand aura-t-il le temps ? Je peux revenir ! – Dans un mois, dans deux mois, on ne sait pas. » En rentrant chez moi, je repense au jour où j’ai commencé ce livre. Comment puis-je effacer ces cinq années de ma vie ? Je n’ai plus envie d’écrire. Je ne veux pas de ces mots tellement réduits pour passer la censure qu’ils finissent par perdre leur sens. Pour la millième fois, je songe à trouver un autre travail, une autre voie. Mais laquelle ?
« Pourquoi aurais-je honte de ma vie ? Pourquoi devrais-je toujours abandonner ? »
Je dois me procurer un médicament rare pour mon père. J’attends que la pharmacie ouvre devant un kiosque à journaux, de l’autre côté de la rue. Leurs feuilles flottent au vent et seules des pierres les empêchent de s’envoler. Les titres sont tous les mêmes : « Voyage en province du président. » La pharmacie ouvre enfin. Je cours dans la rue. Le vent fait s’envoler mon foulard. De l’autre côté de la rue, quelqu’un m’appelle : « Madame, venez ici ! » Je remets mon foulard et me retourne. Deux femmes se tiennent devant une camionnette blanche avec une bande verte. Je me fige. C’est la police de la moralité. Je sais qu’il ne sert à rien d’expliquer, d’insister, de résister. Je fais tout ce qu’ils disent, pour en terminer au plus vite. Avant d’être embarquée, je demande : « Pouvez-vous me laisser aller chercher des médicaments ? Vous pourriez m’accompagner pour vous assurer que je ne m’enfuie pas. » Ma voix tremble. « Monte ! » dit la femme avec insistance en me poussant vers la camionnette. Celle-ci est remplie de filles qui pleurent et crient. Je me sens étourdie. Je ferme les yeux et me bouche les oreilles pour ne pas les entendre. Une fille vomit devant moi. On lui hurle dessus. Avant, j’étais sûre que j’écrirais sur le sujet si un jour on m’attrapait. Mais il n’y a pas assez de mots pour décrire une telle brutalité. On entend un cri provenant de l’avant de la camionnette. Ils veulent embarquer une adolescente et sa mère résiste. Les policiers les battent et les emmènent de force. Un filet de sang s’écoule du front de la mère, jusque dans son œil. La camionnette démarre. Après cela, je ne peux plus dormir la nuit. Le bruit des cris des autres, ces cris que je n’ai pas poussés, résonne dans ma tête. Pourquoi n’ai-je pas crié ?
Les premiers jours, je n’ai crié que dans mes rêves. J’ai crié contre la directrice de l’école, contre l’homme qui m’a interrogé, contre le directeur du département de la censure, contre la police de la moralité. Mais maintenant, j’ai appris à crier fort. J’ai appris à ne pas avoir peur de réclamer mes droits. Pourquoi aurais-je honte de ma vie ? Pourquoi devrais-je toujours abandonner ? Je suis même capable de crier.
Traduit du persan par SEDIGHEH SARABI
« Une thanatocratie qui règne par la mort et par la peur »
Farhad Khosrokhavar
Spécialiste de l’Iran contemporain, le sociologue Farhad Khosrokhavar brosse un panorama du mouvement actuel et de ses protagonistes, entre une jeunesse contestataire et une gérontocratie.
[Chasteté]
Robert Solé
On dit aux Iraniennes de rester à la maison et de faire des enfants. Croyez-vous qu’elles écoutent ?
Le cinéma iranien, miroir de la contestation ?
Asal Bagheri
Asal Bagheri, spécialiste du cinéma iranien, montre le regard que cet art et ses représentants portent sur la société, ainsi que sur le régime et sur sa contestation.