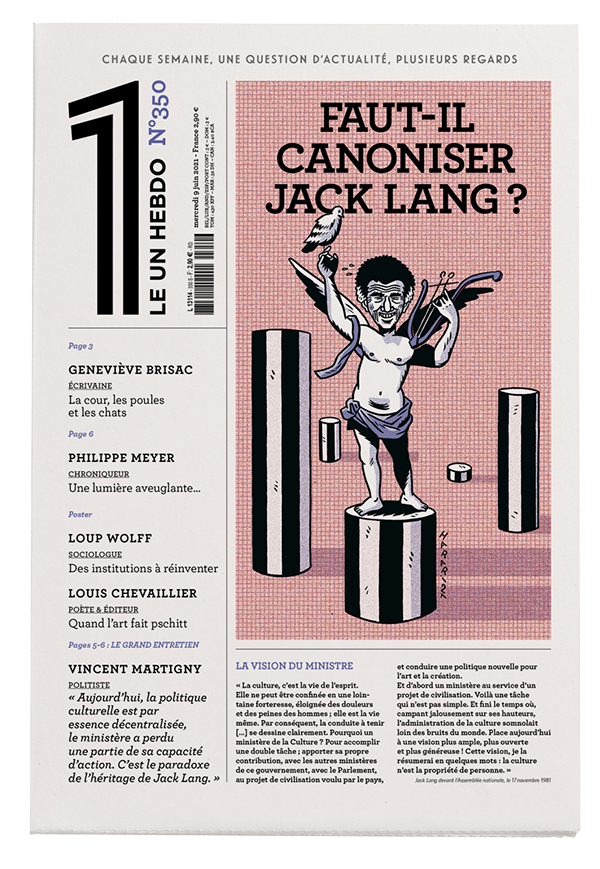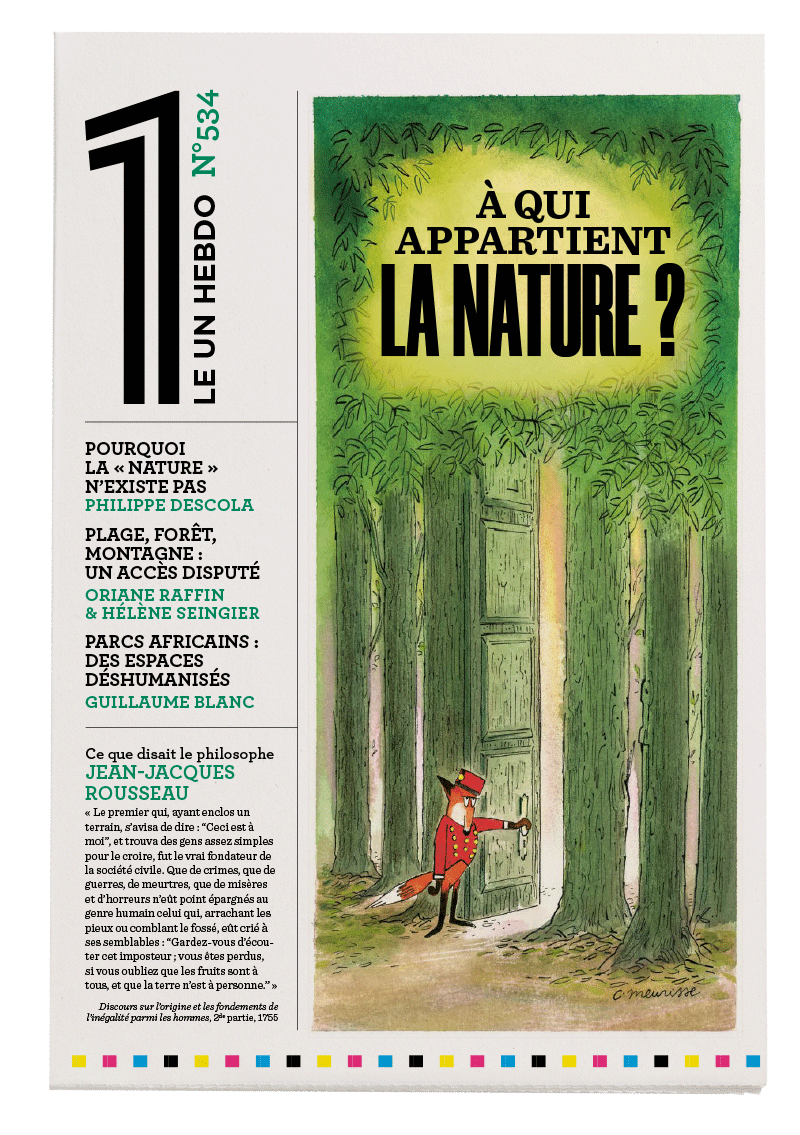Tiers-lieux : un bouillonnement créatif
Temps de lecture : 6 minutes
Ils sont présents sur tout le territoire, dans un petit village du Puy-de-Dôme comme en plein cœur de Paris. Se nichant dans des sites délaissés, ils peuvent prendre la forme de cafés-bibliothèques, de restaurants-librairies, parfois même de fermes-salles de concert. On les appelle les tiers-lieux culturels. En 2018, on en comptait 18 000 à travers toute la France, et leur nombre ne cesse d’augmenter. L’émergence de ces nouveaux acteurs redessine les contours de notre paysage culturel et bouscule les vieilles habitudes.
Insuffler une seconde vie à des territoires abandonnés
Le « tiers-lieu » culturel tire son nom de l’expression anglo-saxonne third place, un terme forgé par le sociologue américain Ray Oldenburg dans les années 1980 pour désigner ces lieux de sociabilité situés entre l’espace de la maison et celui du travail que sont les cafés ou les bibliothèques. Les tiers-lieux culturels constituent à leur manière de nouveaux espaces intermédiaires à l’intérieur de la vie culturelle, où s’inventent de nouvelles sociabilités. Ces lieux ont émergé dans les années 2000, au cours d’une période de capitalisme effréné. « Depuis la révolution industrielle, explique le sociologue Raphaël Besson, on n’a cessé de sectoriser, diviser, réduire les espaces à une seule et unique fonction. Les tiers-lieux ont émergé en réaction à ce morcellement de l’espace. » En s’installant dans des entrepôts ferroviaires désaffectés (la Friche Lucien à Rouen), d’anciens hôpitaux (Saint-Vincent de Paul, dans le 14e arrondissement de Paris, a accueilli les Grands Voisins de 2015 à 2020) ou des locaux dont la SNCF n’a plus l’usage (Ground Control, qui occupe 4 000 m2 dans le 12e, près de la gare de Lyon), les tiers-lieux insufflent une seconde vie à ces sites abandonnés en les transformant en nouveaux lieux culturels.
Fondés dans leur grande majorité par des associations d’artistes ou des collectifs citoyens, dotés de faibles moyens, ces lieux expérimentaux s’appuient le plus souvent sur de petites équipes qui accordent une large place au savant bricolage. Pas de programmation préétablie ni de spécialisation revendiquée. Un seul mot d’ordre : l’hybridité. C’est-à-dire un joyeux mélange des genres et des publics. À la Halle Tropisme, vaste hangar réhabilité au cœur d’une friche militaire à Montpellier, on n’hésite pas à « sauter du coq à l’âne ». Comme l’explique son directeur, Vincent Cavaroc, « ici, on peut passer d’Edgar Morin à la scène queer de Bucarest, du bal musette au jeu vidéo, des films pour enfants aux concerts de réfugiés comoriens. Cette diversité correspond à notre vision du monde et nous permet de parler à un public très large, constitué de voisins, de touristes de passage, de parents avec leurs enfants, de jeunes ou de personnes âgées, tous issus de classes sociales différentes. Et c’est quelque chose qui manquait ».
Comme bien d’autres grandes agglomérations en France, Montpellier dispose pourtant de théâtres, de salles de concert et de centres culturels. « Ces grands équipements implantés depuis une quarantaine d’années à la faveur des politiques de décentralisation sont bien sûr nécessaires, souligne Vincent Cavaroc. Mais ils sont très budgétivores, manquent de flexibilité et peinent parfois à se renouveler. » À l’inverse, les tiers-lieux ont cette souplesse indispensable à l’éclosion d’une nouvelle scène artistique. D’envergure plus réduite, avec un fonctionnement moins pyramidal et une programmation plus ouverte à l’expérimentation, les tiers-lieux sont devenus de véritables laboratoires de création, aptes à susciter des rencontres inédites entre les artistes, leurs œuvres et le public, mais également à nouer un « dialogue avec le génie du lieu ». Pour Arnaud Idelon, consultant et programmateur de ces nouvelles scènes culturelles, les tiers-lieux sont incontestablement devenus la source du « bouillonnement créatif ».
Zone sensible en banlieue, Gare de l’Utopie à la campagne
Dans le petit village de Vertolaye, au cœur du Massif central, Fanny Herbert et son association Carton plein ont investi une ancienne gare désaffectée, transformée en médiathèque-café. Ils l’ont baptisée la Gare de l’Utopie et y organisent des projections de films, des cafés-lectures, des débats citoyens, des ateliers de chant traditionnel ou de sauvegarde des abeilles. Pour Fanny Herbert, cofondatrice de l’association, « l’idée était de s’appuyer sur les mémoires et sur les lieux plutôt que de chercher à importer une offre culturelle de l’extérieur ». Carton plein a mené une vaste enquête sur le patrimoine historique local auprès des populations les plus âgées du village et organisé un atelier participatif pour réfléchir au nouvel avenir des boutiques fermées du centre-bourg. Pour Fanny Herbert, il est impératif dans ces déserts verts de « réunir les habitants dans un même lieu et de lier les enjeux culturels à des questions aussi cruciales que celle de l’avenir du village ».
À quelque 400 kilomètres, en plein cœur de la Seine-Saint Denis, le tiers-lieu Zone sensible poursuit un objectif assez similaire dans un environnement radicalement différent. « Zone sensible, c’est une ferme sur un hectare de zone maraîchère en plein milieu des tours », résume Jean-Philip Lucas, l’un des membres fondateurs. Le credo de ce collectif : nature, culture et nourriture. Durant la semaine, les membres cultivent la terre et animent des ateliers d’initiation à la permaculture et à la nutrition, notamment à l’intention des scolaires. Le samedi, ils ouvrent leurs portes au public, qui peut profiter du vaste espace de verdure et assister à des concerts, spectacles et conférences. « Les habitants doivent pouvoir se sentir les bienvenus, explique Jean-Philip Lucas. C’est pourquoi notre espace est ouvert et sans vigile, tous nos événements sont gratuits, et nous collaborons avec tous les acteurs locaux, que ce soient les DJ des quartiers environnants, le théâtre d’Aubervilliers ou l’académie de cirque de Saint-Denis ! » « Un tiers-lieu, c’est un véritable écosystème », abonde Mathilde Girault, responsable éditoriale de Ground Control, l’un des tiers-lieux les plus réputés de la capitale. Qu’il soit rural ou urbain, qu’il concerne une poignée d’habitants ou un quartier surpeuplé, il s’inscrit toujours dans un territoire, qui le façonne et qu’il façonne à son tour.
L’appel de 1 600 structures à réinventer les politiques culturelles
Parfois éphémères, toujours en équilibre précaire, les tiers-lieux recourent dans leur grande majorité à des subventions publiques provenant de la ville, de la région ou de l’État, ainsi qu’à des financements privés. Quel rôle doit jouer l’État à l’égard de ces nouveaux écosystèmes ? « Ces subventions nous permettent d’entretenir un cercle vertueux et d’en faire profiter le plus grand nombre. Nous ne sommes pas dans une logique de profit », insiste Jean-Philip Lucas. La participation de l’État se justifie également pleinement pour Mathilde Girault, qui considère les tiers-lieux comme des « lieux d’intérêt public » : « À Ground Control, par exemple, nous avons préparé et distribué des repas aux plus démunis pendant toute la période de confinement. Nous sommes nombreux à nous être transformés en centre d’aide sociale, psychologique… C’est ce que permet ce modèle. » Dans un manifeste publié en décembre dernier, près de 1 600 structures ont d’ailleurs appelé à réinventer collectivement les politiques culturelles, à les mettre au goût du jour, à les alléger, les simplifier, les rendre moins rigides, pour qu’elles prennent en compte les particularités des lieux, qu’elles parviennent à s’adapter aux formats hybrides sans les enfermer dans des critères stricts et prédéfinis.
« Il y a vraiment quelque chose à inventer, quelque chose de suffisamment souple pour permettre à chaque initiative de se développer en fonction de son environnement propre », souligne Mathilde Girault. Mais il semble également impératif d’accompagner un tel renouveau de la politique culturelle par un réaménagement des politiques urbaines. En effet, aucun tiers-lieu n’est propriétaire de son espace. Installés provisoirement sur des lieux en friche ou dans des bâtiments désaffectés, ils risquent à tout moment de devoir les quitter et donc de disparaître. Tout l’enjeu de ces prochaines années sera donc la question de leur pérennisation. L’appel des tiers-lieux a-t-il été entendu ? Le nouveau plan de relance du gouvernement prévoit en tout cas de débloquer deux millions d’euros pour les « quartiers culturels et créatifs ». Serait-ce là le début d’une prise de conscience ? « Sans une réelle considération, le modèle du tiers-lieu culturel s’essoufflera, pour finalement se réduire à quelques cours de yoga », prévient Vincent Cavaroc, non sans une pointe d’ironie.
« Un personnage en couleurs dans un monde en noir et blanc »
Vincent Martigny
« Cette appétence systématique pour la nouveauté est l’un des traits les plus caractéristiques de la personnalité de Jack Lang et de son action. Il faut lui reconnaître d’avoir été précurseur dans la défense de formes culturelles alors décriées, comme les cultures urbaines, et d’avoir compris l’i…
[Revolver]
Robert Solé
« QUAND j’entends le mot culture, je sors mon revolver… » La phrase a été attribuée à différents dirigeants nazis – Hermann Goering, Joseph Goebbels ou Alfred Rosenberg – alors qu’on la doit au dramaturge Hanns Johst. Dans Schlageter, la pièce de théâtre qu’il avait cré…
Mirobolang
Philippe Meyer
Cassandre, aujourd’hui, n’importunerait pas ses contemporains par ses prévisions, mais par ses souvenirs. L’époque a la mémoire courte et prompte à falsifier le passé pour mieux frelater le présent. Voilà qu’à l’occasion du quarantième anniversaire de l’avènement de François Mit…