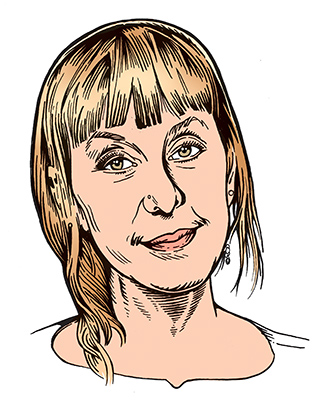Le rien et l’immensité
Temps de lecture : 6 minutes
Dans une rue désertée, un collage subsiste, à moitié décollé : « notre colère sur vos murs ».
La colère, aujourd’hui, se heurte à nos quatre murs, à un quotidien où on a le droit d’aller faire ses courses mais plus celui d’enterrer ses morts. On n’a plus pied. Tout, autour de nous, est immense : la misère, le danger, nos questions.
Chaque jour, on passe par tous les âges. On a la concentration d’un enfant de quatre ans, les larmes nous montent aux yeux telle une ado, on remplit son caddie avec l’égoïsme d’un trader quadragénaire. Nos humeurs sont un océan. Elles creusent, déferlent. Des courants contraires nous traversent : à 20 heures pile, on applaudit sans savoir si on célèbre l’exploitation des soignants, si on s’étourdit d’une joie fugace ou si on est là parce qu’on a besoin d’échanger quelques mots avec sa voisine. À 20 h 05, on pense au lendemain, le futur est une vague scélérate. Sur notre écran, avant de s’endormir, on caresse de l’index des biches folâtrant sur une plage, des canards devant la Comédie-Française. Les animaux sont cathartiques, ils sont bons princes, et nous, les roitelets nus d’un monde en suspens.
Allô ? Dans le monde confiné, on délaisse les SMS, on s’appelle, on se cherche. Il y a l’ombre d’une chance qui pointe, celle de ne pas se rater, cette fois. Celle de poser sincèrement la question : toi, comment vas-tu ?
Le confinement a défait nos parades et nos illusions : notre « moi » fantasmé est à terre. On ne lit toujours pas de poésie au réveil, pas plus qu’on n’a appris à cuisiner d’un rien ou à bricoler. Et ça n’est pas de temps, qu’on manque, c’est de disponibilité. Elle est en miettes, comme nos certitudes.
A-t-il vraiment commencé en mars 2020, le confinement, ou l’étions-nous déjà, « avant », confinés ? Avant, quand le libéralisme numérique nous faisait de l’œil pour mieux nous assigner à résidence, quand tout venait à nous, séries HBO et Uber-burgers, porno et formations professionnelles en ligne. Quand sortir semblait être dépassé, une perte de temps réservée à celles et ceux qui avaient gardé cette habitude très XXe siècle.
Oh, on le savait, que nos plaisirs, nos conforts, reposaient sur des corps épuisés, ces « autres » qu’on glorifie aujourd’hui. Que les livreurs, les éboueurs, les caissières, les travailleuses du sexe, les vigiles, les AVS, les aides-soignantes étaient en première ligne, déjà. On le savait que, pas très loin de chez nous, se jouaient des guerres quotidiennes de la survie.
Il fallait gravir la pente de plus en plus vite pour n’en rien entendre, de ces fracas. À force, on a fini par oublier que la politique n’est pas qu’une posture d’hommes en costume gris. Elle agit sur les corps : les nôtres. Aujourd’hui, on le sait : des choix ont été faits ; il n’y a pas de masques, pas de gel hydroalcoolique, mais l’appel d’offres lancé le 12 avril par le ministère de l’Intérieur fait état d’une commande de 651 drones du « quotidien » pour 3,8 millions d’euros. Aujourd’hui on le sait : la pollution des particules fines nous a rendus plus fragiles aux virus. Aujourd’hui on le sait : des gamins nés dans la septième puissance du monde ne mangent plus à leur faim, les files d’attente s’allongent devant les distributions de repas qu’organisent des collectifs de quartier.
Le confinement nous regarde à la loupe ; nous y sommes si nus qu’il n’est plus possible d’ignorer nos cicatrices, nos mensonges : tout n’allait pas si bien avant.
On a le ventre serré à l’idée de « reprendre », d’être confinés dans des open spaces, des hiérarchies, une famille, une sexualité terne. Et déjà, on est invités à préparer « l’après ».
Mais le temps ne se découpe pas en tranches, à la façon d’un graphique sur PowerPoint. Et c’est peut-être un réflexe du monde « d’avant », de chercher à tracer les contours de celui d’« après ». Un avant-après où l’on se contenterait de maquiller en vert, en « durable » ou en éthique la même économie de marché, le même dérèglement climatique, les mêmes inégalités, la même violence.
Quand quelques semaines ont suffi pour qu’on réalise que ce qui manque, sur les étalages, ne nous manque pas vraiment. Comme l’écrit Romaric Godin, journaliste spécialisé en macroéconomie : « En quelques semaines, on se rend compte que l’on peut stopper la fuite en avant de l’économie marchande, que l’on peut se concentrer sur l’essentiel : nourrir, soigner, prendre soin […]. La valeur produite par le marché qui donne à un consultant un poids monétaire dix fois supérieur à celui d’une caissière ou d’un éboueur apparaît pour ce qu’elle est : une abstraction vide de sens. Ou plutôt une abstraction destinée à servir ce pourquoi elle est créée : le profit. »
Le soir tombe, on a peur du noir et du lendemain, mais on applaudit même si on se trouve pathétique.
On a tort. Le deuxième mouvement de la Symphonie no 6, dite Pathétique, de Tchaïkovski a été décrit comme un sourire entre les larmes : une bande-son appropriée à ce qu’on voit naître ; un merci bredouillant à la caissière, des affichettes scotchées dans les halls d’immeuble, qui offrent de faire leurs courses aux personnes âgées, qui proposent de l’aide aux devoirs par téléphone aux enfants en difficulté. Des tentatives de faire communauté, de faire corps, des attentions nouvelles ; des colères aussi, qu’on se devra de ne pas oublier, qu’on se devra de porter à la place de celles et ceux qui n’en auront peut-être plus la force, « après ».
Ce matin, encore, on n’arrive à rien, c’est une bonne nouvelle. Notre « rien » ressemble au début d’autre chose.
« Notre civilisation vient de recevoir un avertissement »
Dominique Bourg
Pourquoi découvre-t-on selon vous, avec cette crise sanitaire et économique, que « la croissance est négociable » ?
Les économistes nous ont mis en tête que la croissance et le progrès étaient des rouleaux compresseurs que rie…
[Demain]
Robert Solé
Que de leçons tirées de la catastrophe ! Ça tire de tous côtés… Et chacun (qu’il soit écologiste, socialiste, mondialiste, pro-européen ou anti-européen) y voit la confirmation éclatante de…
Plaidoyer pour le marché
Olivier Babeau
On ne doit pas être étonné de l’empressement avec lequel les prophètes de l’effondrement et les vendeurs de dictature verte se précipitent pour exiger un nouveau monde conforme à leurs souhaits. Les guerres ont toujours e…