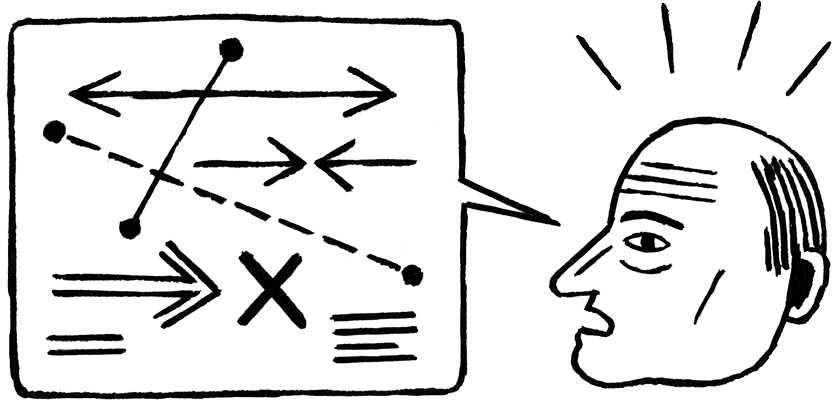« Il a inventé une sociologie qui refuse les grilles idéologiques »
Temps de lecture : 8 minutes
Que diriez-vous si vous deviez présenter Edgar Morin à des étudiants ?
D’abord, je raconterais la cérémonie de remise de décoration au cours de laquelle il a été élevé commandeur de la Légion d’honneur à titre militaire. À ma connaissance, c’est le seul intellectuel français qui le soit ! C’est un côté extraordinaire de sa personnalité. Edgar Morin est un grand résistant, un combattant qui a eu d’abord des responsabilités à Toulouse, puis à Lyon et à Paris, et… qui s’en est sorti vivant. Une chance énorme, car il a failli mourir dans la clandestinité. Plusieurs de ses camarades ont du reste été arrêtés et torturés.
La seconde chose que je mettrais en avant, c’est sa capacité d’empathie. Il aime les gens ! Il aime la vie. C’est un hédoniste travailleur d’une immense générosité. Enfin, je dirais qu’il a construit son œuvre à partir du terrain – Berlin en 1945, la Californie, Plozévet, Orléans, la Méditerranée, Salonique en particulier, la ville d’origine de sa famille… – et d’immenses bibliothèques. Une œuvre empreinte de l’absence-présence de sa maman, morte jeune, et qui fut une blessure extrême.
Entré presque naturellement dans la Résistance, il s’engage dix ans plus tard face à ce qu’on appelait alors les événements d’Algérie. Quel était son combat ?
Durant les « événements d’Algérie », il a soutenu les minoritaires contre le FLN. Dans cette lutte impitoyable, il est proche de Mohammed Bellounis, membre du Mouvement national algérien (MNA) et qui va fonder l’Armée nationale du peuple algérien. Le FLN va l’emporter et liquider les compagnons de Bellounis en les accusant de travailler pour les Français. Il était préoccupé par la question de la survie de la démocratie à l’intérieur de la guerre. Pour lui, cette lutte devait faire écho à la guerre d’Espagne, lorsque les anarchistes ont été pourchassés et massacrés par les communistes.
Comment avez-vous rencontré Edgar Morin ?
Je suis allé le voir à la fin des années 1970. Il habitait alors dans le Luberon, pas très loin de chez moi. Je crois qu’il m’a reçu parce qu’il avait croisé mon père dans les mouvements de gauche favorables à l’indépendance algérienne. C’était l’intellectuel qui me faisait le plus rêver. Il écrivait alors La Méthode à Ménerbes, qu’il continuera sur la Côte d’Azur. Je lui ai demandé s’il accepterait de diriger ma thèse de sociologie. Non seulement il l’a fait, mais il l’a ensuite préfacée quand elle fut éditée… Une longue préface sur la manière dont un intellectuel doit s’auto-analyser pour bien exercer le métier de chercheur, ce qui était le sujet de mon DEA. Je suis donc tout à la fois un élève et un compagnon. Aujourd’hui, je suis l’un de ses éditeurs, avec quinze de ses livres dans notre catalogue aux Éditions de l’Aube !
À la Libération, Edgar Morin est assez rapidement devenu sociologue. Comment s’est opérée cette mue, de la Résistance à la recherche ?
Il s’est retrouvé en 1946 en Allemagne, chargé de la communication du gouvernement militaire français. Il est en poste à Baden-Baden, dans ce pays en ruine. Il est tout jeune, 25 ans : il regarde, écoute et écrit L’An zéro de l’Allemagne. C’est son premier livre. Il y décrit une Allemagne anéantie. Un texte important. Cela correspond à un moment où les jeunes résistants intellos cherchaient leur voie et où les autorités se demandaient ce qu’elles allaient faire d’eux. On leur a donc trouvé des postes dans un CNRS qui venait d’être créé, en leur disant : « Vous allez être sociologues. » Je ne suis pas très sûr qu’ils savaient ce que cela voulait dire ! Cette génération était composée de philosophes, d’historiens. Morin avait fait du droit et de l’histoire-géo… Ils ont de facto « inventé » la sociologie en France !
Quel sociologue est-il ?
Edgar Morin invente une sociologie qui refuse les grilles idéologiques. Il restera longtemps marginal. Ce n’est un sociologue ni à la manière d’Alain Touraine, qui va élaborer des analyses structurantes, ni à celle de Bourdieu, qui a une théorie qu’il applique… et qu’il somme tous les autres d’appliquer. Morin, c’est une démarche empathique, très personnelle, ce qui explique qu’il n’a pas au sens strict fait école, qu’il n’a pas de disciples. Il nous parle de son temps. Il essaye d’en rendre compte avec affection. Il crée une sociologie dont le propos est la mise en récit de la société dans laquelle nous vivons. Au fond, il s’intéresse à l’an zéro de l’Allemagne, au mythe des stars, et ainsi de suite, en suivant ses intuitions et le fil de sa vie.
Dans les années 1960, une grande enquête scientifique a pour cadre un village breton, Plozévet. Edgar Morin y participe…
À sa manière, avec un regard généreux, pas du tout un regard en surplomb. Il faut comprendre que cette enquête pluridisciplinaire se situe à un moment où l’idéologie gaulliste cherche le Français de souche et jette son dévolu sur ce village reculé du pays breton. On pense alors que l’on a quasiment trouvé le Français d’origine ! L’homme de Néandertal préservé ! Et on a envoyé tous nos scientifiques là-bas pour leur mesurer la taille des oreilles, des pieds, etc. On avait l’impression d’avoir trouvé la « vraie souche ». Edgar Morin s’est imposé comme l’observateur de la démarche, refusant de partager cette vision de l’homme de Néandertal gaullo-français…
Encore une fois, ce sont ses qualités d’empathie que je retiens. Il prend le temps d’écouter, d’observer, de regarder avec humanité les habitants de ce village. Un détail savoureux : il décrit l’allure et les fesses d’une serveuse sans machisme et intègre ces lignes dans son étude. Quel autre intellectuel aurait osé ? Au début, les villageois n’appréciaient pas ce regard porté sur eux dans la mesure où il s’agissait d’un regard intrusif ; et puis, avec le temps, cette collecte est devenue la mémoire du village. Aujourd’hui, à Plozévet, c’est le livre d’Edgar Morin qui est dans la vitrine du bar-tabac.
Sociologue, il devient ou redevient philosophe.
Il y a plusieurs œuvres dans l’œuvre de Morin. Et La Méthode est son livre le plus ambitieux. Est-ce le tronc principal de son œuvre ou est-ce une branche parallèle ? Je ne sais pas. J’aime sa sociologie et sa Méthode. Il s’agit de six livres qui sont construits les uns par rapport aux autres. Il a voulu faire une sorte d’encyclopédie universelle, penser la totalité et la complexité. Il a travaillé avec les scientifiques de toutes les disciplines. Il y dévoile une connaissance des mathématiques, de la physique, de la chimie tout à fait considérable. C’est une grande œuvre qui tisse les disciplines entre elles dans une époque où la construction de la pensée est à la séparation. Il relie, met dans un cercle, articule les savoirs comme on pouvait le faire à la Renaissance, quand un Léonard de Vinci était tout à la fois peintre, auteur, savant, inventeur de machines. Il a tenté d’être Léonard de Vinci sans nous laisser de tableaux… Un peu Diderot aussi.
Il y a parfois chez lui une dimension prophétique. Il n’hésite pas à parler de l’avenir. Comment analysez-vous cela ?
Il pense par lui-même et il ne se demande pas ce qu’en pensent ses collègues ou la commission de sociologie du CNRS ! Il n’en a strictement rien à faire ! Il n’a pas passé sa vie à se battre pour des fauteuils… Au fond, il est complètement indifférent à l’institution – même s’il fut bien aise de la protection que le CNRS lui a garantie toute sa vie –, il ne pouvait pas être reconnu par elle. Ce n’était pas son enjeu. Son enjeu, c’est l’aventure de la société, l’humanisme, l’écologie, la transmission, ce sont ses lecteurs et les jeunes. Il adore aller dans les collèges et les lycées ! C’est un intellectuel qui se sent en responsabilité du futur.
Vous avez évoqué son engagement dans la Résistance, lors de la guerre d’Algérie. Il a aussi été membre du Parti communiste, jusqu’à son exclusion en 1951. Est-il toujours engagé ?
Il appartient à la famille de la gauche et il sera un acteur politique jusqu’au bout. D’où ces entretiens avec François Hollande, avec Stéphane Hessel, avec Boris Cyrulnik, Tariq Ramadan, et tant d’autres. Ce qui lui plaît, c’est l’échange, le dialogue. C’est un acteur politique. Il a essayé de transmettre aux politiques sa vision de la société prenant largement en compte l’écologie et l’éducation. Il annonce un changement de civilisation. Sa vision de la complexité l’a conduit à chercher à influencer les responsables, tous ceux qui décident. D’où l’importance qu’il accorde aussi à la sphère du journalisme. Il n’a cessé d’écrire dans la presse et particulièrement dans Le Monde.
Peut-on dire qu’il n’a jamais été aussi lu, aussi écouté qu’aujourd’hui ?
Les médias l’adorent. Un centenaire, cela fait rêver ! Les très vieux sont devenus très à la mode : pensez à Stéphane Hessel, à Michel Serres, à Boris Cyrulnik, à Pierre Rabhi. Nos sociétés ne savent plus très bien où elles vont, et ils proposent des repères, une direction. Ils ont par définition du recul, et ils brassent large. Edgar Morin incarne aussi. Et je veux ajouter que s’il n’a pas toujours été lu et compris en France, ce n’est pas le cas ailleurs. Il a été fait docteur honoris causa dans une quarantaine d’universités étrangères. Son œuvre est traduite un peu partout. Il existe même, je crois, une statue de lui en Amérique du Sud, et au Mexique une université porte son nom. En France, il y a maintenant une chaire Edgar Morin à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Il est un des grands penseurs du monde moderne. ¡ Abrazo !
Propos recueillis par Éric Fottorino & Laurent Greilsamer
« Il a inventé une sociologie qui refuse les grilles idéologiques »
Jean Viard
« C’est un intellectuel qui se sent en -responsabilité du futur. » Edgar Morin, qu’il a rencontré à la fin des années 1970 pour lui demander de diriger sa thèse, est pour le sociologue autant un maître qu’un ami. Dans ce grand entretien, il dresse un panorama de la vie et de la pensée de son aîné…
[Marelle]
Robert Solé
ENTRE deux réflexions sur l’air du temps, Edgar Morin, très actif sur Twitter, y glisse volontiers un clin d’œil. « Évitez d’être centenaire, écrivait-il le 18 juin dernier. Passez directement à 101 ans. » Pour enjamber un tel anniversaire, lui a fait remarquer en souriant l’un …
Le questionnaire de Proust
Edgar Morin
Edgar Morin a accepté pour nous de se prêter au jeu du questionnaire de Proust. Un seul principe, des réponses brèves, du tac au tac.
Le principal trait de mon caractère ?
Sa complexité.