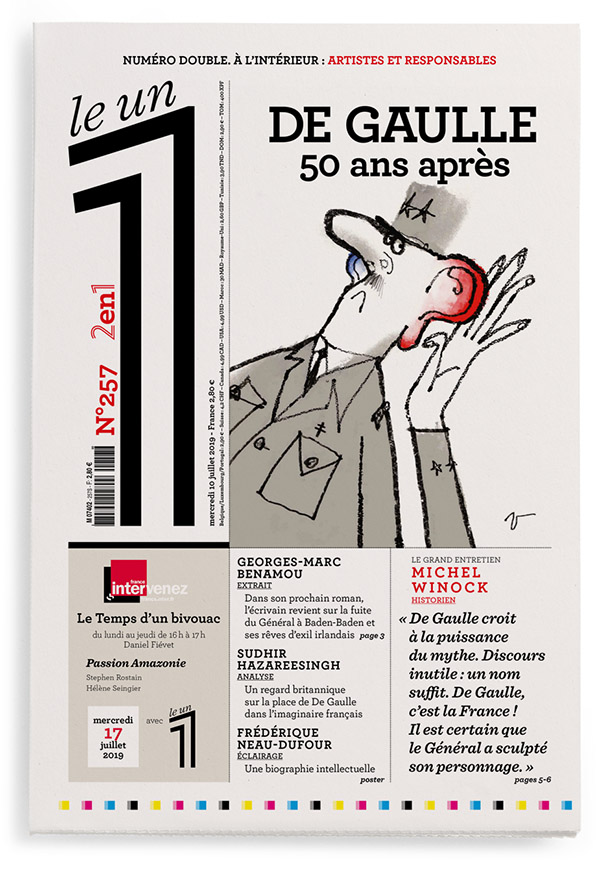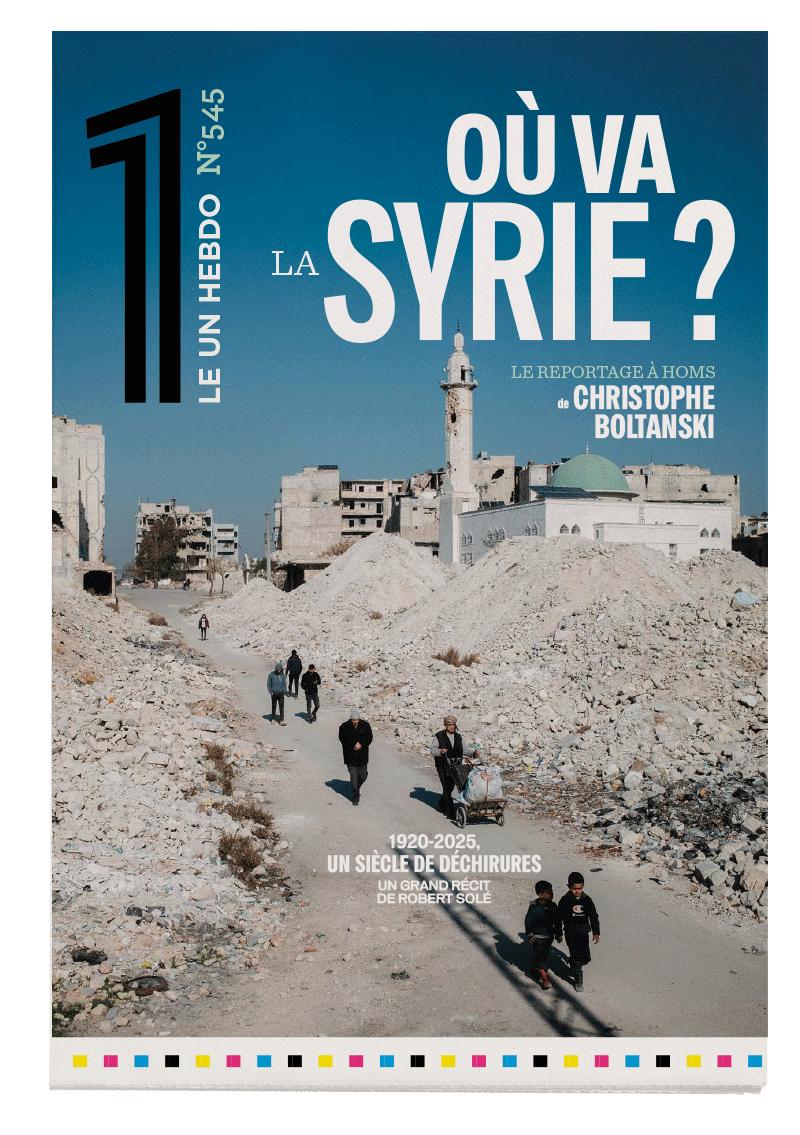Le gaullisme introuvable
Temps de lecture : 10 minutes
Le gaullisme pouvait-il survivre à de Gaulle, et si oui, comment ? La question, récurrente, divise commentateurs et historiens depuis un demi-siècle. Elle se pose dès le 29 avril 1969, au lendemain du départ du Général, après le référendum perdu qui a précipité sa chute. Complexe, cette problématique trouve ses racines dans la définition même du gaullisme, intrinsèquement liée à la personne du Général et à son expérience d’exercice du pouvoir. Par nature rétif à toute classification dans le clivage droite-gauche traditionnel, le gaullisme est un ensemble d’idées flottant, mouvant, qui fédère des hommes venus de tous horizons politiques, essentiellement soudés par leur fidélité au fondateur de la Ve République. Difficile, a priori, d’imaginer qu’un tel mouvement puisse subsister après l’effacement de celui qui constituait sa raison d’être. Après son départ, de Gaulle avait d’ailleurs confié à André Malraux que la page était tournée et qu’il se sentait étranger à ce qui se passait chez ses partisans.
Comment expliquer alors que, cinquante ans après la fin de la République gaullienne, la plupart du personnel politique, de la gauche radicale à l’extrême droite, se revendique de l’homme du 18 Juin, porteur d’une « certaine idée de la France » ?
Une telle interrogation appelle plusieurs réponses. La première et la plus nette tient à ce que la disparition du général de Gaulle de la scène politique marque moins la fin du gaullisme que celle d’un gaullisme, celui de son inventeur. Sur le plan strictement politique, le gaullisme comme famille politique se réunit d’abord autour de Georges Pompidou après le départ du Général. En dépit d’accusations de trahison après sa démission du gouvernement en juillet 1968, parfois qualifié « d’anti-de Gaulle » par certains députés conservateurs de l’UDR – le parti gaulliste – qui n’acceptaient pas sa ligne réformiste, l’ancien Premier ministre installe, une fois élu, le gaullisme durablement comme force politique.
Candidat dès le 30 avril à l’élection présidentielle, avec le timide soutien du chef de l’État démissionnaire, Pompidou garde chez les gaullistes l’aura du Premier ministre qui résista à la « chienlit » de Mai 68 et fut l’artisan de la victoire aux élections législatives du mois de juin. Il est de ce fait le continuateur de l’œuvre, malgré des changements de style conséquents, le nouveau locataire de l’Élysée se montrant plus débonnaire et plus pragmatique que son prédécesseur. Il peut alors compter sur un parti gaulliste devenu, déjà au temps du Général, un parti dominant, attrape-tout, qui avait commencé à s’émanciper de sa figure tutélaire. Les notions d’« ouverture » et de « coalition », étrangères à la pensée du fondateur de la Ve République, font leur apparition sous Pompidou, instaurant un écart entre la référence au Général et la réalité du fonctionnement du parti.
Après la mort de Pompidou en 1974, la victoire de Valéry Giscard d’Estaing marque un tournant. L’échec dès le premier tour de Jacques Chaban-Delmas, grognard du Général et héritier du gaullisme des origines, puis l’élection d’un président libéral, pro-européen et non gaulliste – quoique plusieurs fois ministre dans des gouvernements de cette famille politique – manifestent une première rupture. Mais, si les gaullistes ont perdu une bataille, ils ne s’avouent pas vaincus pour autant. Malgré une campagne présidentielle en rupture avec l’ère gaullo-pompidolienne, Giscard a été en réalité élu avec le soutien d’une fraction importante des gaullistes emmenée par Jacques Chirac, puis par l’ensemble du parti qui constituera le socle de la majorité présidentielle dès mai 1974. Nommé au même moment à la tête du gouvernement et de l’UDR, Jacques Chirac fait tomber, temporairement, le gaullisme dans l’escarcelle du giscardisme. Union de courte durée, puisque dès 1976, le bouillonnant Premier ministre rompt avec le président de la République pour proposer, avec la création du RPR, un « retour aux sources » gaullistes.
Le « retour aux sources » : c’est la formule magique qu’empruntent toutes les tentatives de réorganisation de cette famille de la droite française, qui espèrent renouer le fil du récit fondateur. Reste à savoir à quel gaullisme se référer : celui, triomphant, de la Résistance ? Celui, militant, de la IVe République et du RPF ? Ou celui de l’épreuve du pouvoir ? Cette ambiguïté d’une référence, de plus en plus symbolique au fil du temps, caractérise la fondation du RPR et son évolution jusqu’à sa fusion au sein de l’UMP en 2002.
Pour les gaullistes, l’élection de François Mitterrand en 1981 est un tremblement de terre. La victoire de l’adversaire le plus acharné de leur mentor et des institutions mises en place en 1958 conduit les gaullistes à quitter le pouvoir pour la première fois depuis 1958, même si certains d’entre eux, marqués à gauche comme Michel Jobert, entrent au gouvernement de Pierre Mauroy. Humiliation pour les gaullistes historiques, Michel Debré, l’ancien Premier ministre de 1958 à 1962, candidat à l’élection et autoproclamé « seul candidat gaulliste », ne recueille qu’un piteux 1,6 % des suffrages.
Le triomphe de l’auteur du Coup d’État permanent semble alors mettre fin à une époque pour la droite. Au RPR, dans les premières années de la décennie 1980, l’effacement des emblèmes gaullistes comme les portraits du Général ou la croix de Lorraine manifeste un ralliement à d’autres références, à commencer par une conversion au néolibéralisme lancé par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Jacques Chirac, qui s’est toujours tenu éloigné de la mémoire gaulliste, se présente alors comme un « républicain démocrate et de tradition corrézienne », sans aucune référence au courant originel de son parti.
La situation change à nouveau au milieu des années 1980. Le Général revient d’abord en librairie, sous la plume de Jean Lacouture qui lui consacre une biographie en trois tomes à partir de 1984, devenue rapidement un best-seller. Cette redécouverte contribue à une résurgence en politique de la référence à de Gaulle, non seulement au RPR mais aussi dans l’ensemble des familles politiques.
À gauche, l’émergence du « gaullo-mitterrandisme », un principe de politique étrangère axé sur l’indépendance de la France à l’égard des superpuissances, témoigne d’une continuité inattendue : le locataire de l’Élysée, qui manifestait avec ardeur sa volonté de détruire les institutions de la Ve République avant son élection en 1981, paraît tout à fait s’en accommoder une fois au pouvoir. La redécouverte du Général par un Régis Debray, intellectuel organique du pouvoir socialiste, ou même, dès le milieu des années 1980, par un Jean-Pierre Chevènement, montre que la figure de l’homme de Colombey commence à devenir consensuelle.
À droite, de Gaulle devient également une référence utile pour se différencier d’un nouveau concurrent : le Front national. La référence au gaullisme, qui connaît un grand retour dans la seconde moitié des années 1980, fait office de caution à opposer à tous ceux qui accusent le RPR d’être tenté par une alliance avec le diable. Elle devient un talisman, un brevet d’antiracisme au nom de la mémoire de la lutte des gaullistes contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Chirac en fera un usage permanent durant ses deux mandats, pour marquer sa différence avec l’extrême droite. Apparaît un discours spécifique, axé sur la célébration et la défense de la Ve République, avec des références marquées à la guerre et à la Résistance, mais aussi des appels récurrents à l’union – un ensemble qui constitue ce que la spécialiste de la droite française Florence Haegel nomme le « parler gaulliste », qui s’impose au RPR jusqu’au tournant des années 2000. Les thématiques du rassemblement, du peuple, et de la souveraineté deviennent centrales à droite, même si la filiation se dilue et prend surtout la forme de « codes verbaux », véritables signaux envoyés à l’électorat pour le séduire plus que pour faire vivre des idées.
À partir des années 2000, la référence au général de Gaulle et aux valeurs du gaullisme se généralise et continue sa dilution. Nicolas Sarkozy, libéral et pro-européen, très éloigné des valeurs du gaullisme, en fera un usage aussi extensif qu’éloigné de la réalité historique. De Gaulle devient alors une référence dont on se sert à l’envi, souvent pour lui faire dire n’importe quoi.
La conquête du FN par Marine Le Pen en 2011 marque l’entrée du Front national dans ce consensus mou de la vénération de la figure de De Gaulle. Alors que la détestation de celui qu’on accusait d’avoir « abandonné » l’Algérie française singularisait jusqu’alors cette famille politique, le FN fait entrer le Général au panthéon de ses héros, vanté pour son patriotisme, son antilibéralisme et sa défense d’une Europe des patries. Singulier retournement de l’histoire, qui voit aujourd’hui aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen ou Emmanuel Macron communier dans un éloge inconditionnel du « père de la nation », pourtant chassé du pouvoir cinquante ans plus tôt par des Français lassés de cette figure tutélaire.
Aujourd’hui, le consensus autour du Général est tel que les instituts de sondages ont arrêté depuis bien longtemps de tester sa popularité. Le géant est définitivement devenu un personnage historique, dont le fantôme continue de hanter la vie politique française, à l’image de ce tome des Mémoires de guerre trônant sur le bureau d’Emmanuel Macron sur sa photo officielle. Transformé en une allégorie désincarnée de la République, de Gaulle est devenu un mythe dont tous les usages semblent permis.
Dans le même temps, les idées qui caractérisaient le gaullisme, détachées de leur contexte, mal interprétées, voire manipulées, ont quasiment disparu. Nul courant ni parti ne s’en réclame, hormis peut-être Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, dont la singulière alliance avec le Rassemblement national au second tour de la dernière élection présidentielle, est bien peu conforme à l’esprit du gaullisme. De Gaulle est aujourd’hui partout, mais le gaullisme, lui, n’est plus nulle part. Le Général, ce pragmatique qui détestait les partis et les idéologies, ne s’en plaindrait probablement pas.
« Le mot clé de sa vision politique, c’est “rassemblement” »
Michel Winock
De Gaulle est-il entré de plain-pied dans l’histoire dès le 18 juin 1940 pour n’en plus jamais sortir ?
De Gaulle apparaît, dans le champ politique, comme la seule individualité proprement « hist…
[« Qui vous savez »]
Robert Solé
Après l’annonce de sa mort, en août 2011, Paris-Match titrait : « L’autre de Gaulle s’est éteint. » Il faut dire qu’Henri Tisot avait fini par s’identifier au personnage qu’i…
Un gaullisme sans postérité ?
Nicolas Tenzer
La figure du général de Gaulle hante notre imaginaire politique. Comment ne pas rendre hommage à l’homme libre qui s’est insurgé contre l’esprit de défaite et l’ignominie de la Collaboration ? Comment ne pas saluer l&rsquo…