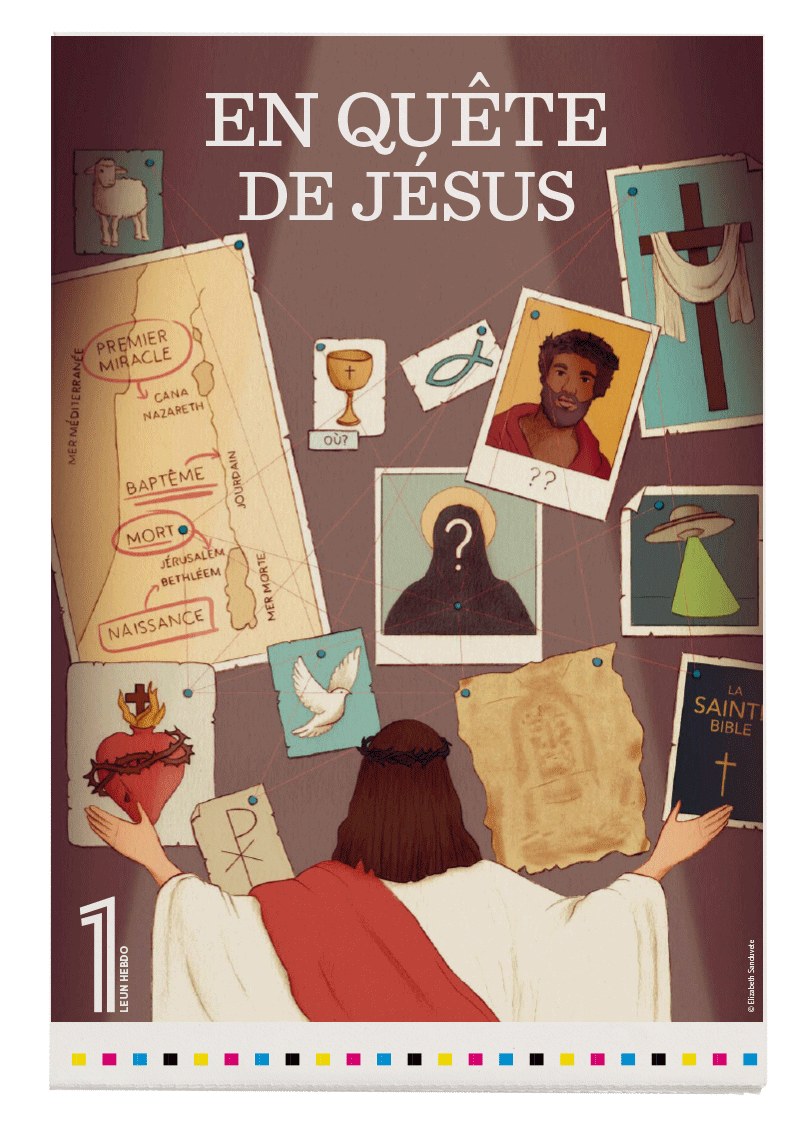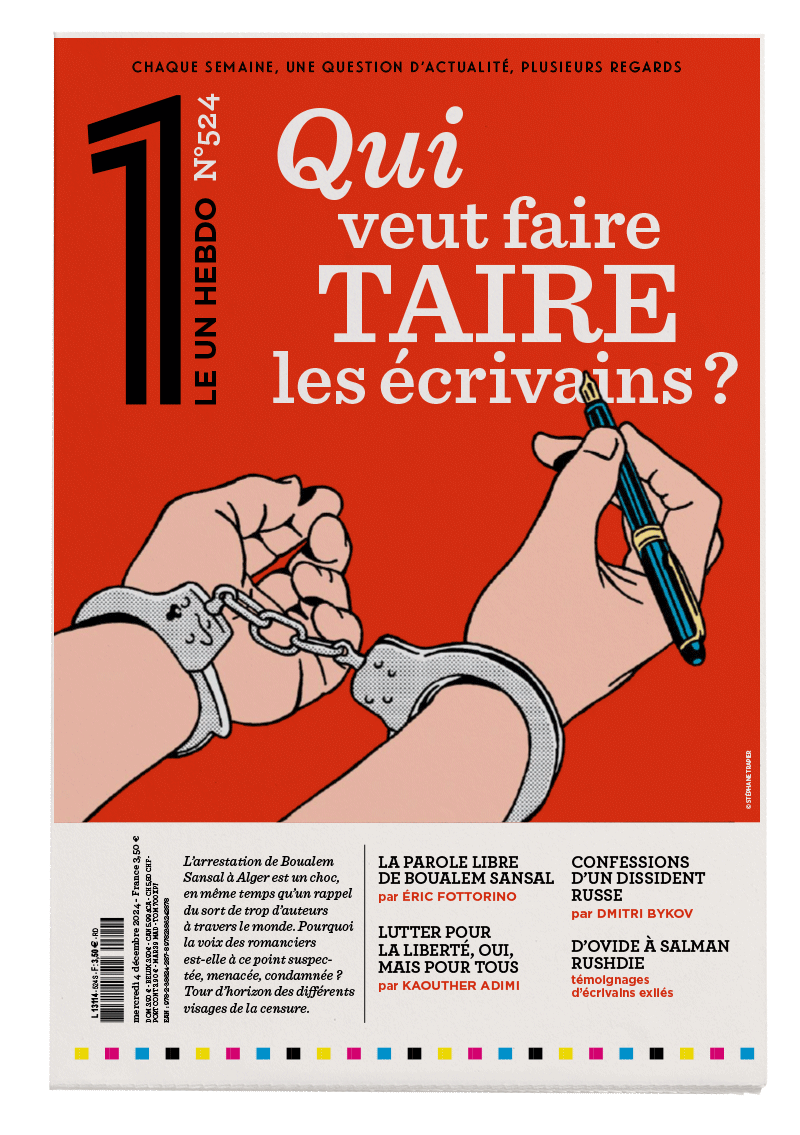« L’État hygiéniste a été le premier grand vecteur de l’action publique »
Temps de lecture : 10 minutes
Dans votre ouvrage La Crise de l’État providence paru en 1981, vous parliez d’une crise morale et culturelle de l’État. Près de quarante ans après, pensez-vous que l’actuelle épidémie signifie le grand retour de l’État providence ?
Cette crise marque avant tout le grand retour de ce qu’on peut appeler l’État hygiéniste, qui a une histoire différente. L’État providence, c’est une histoire de redistribution sociale, de solidarité et de dette sociale. Le propre de l’État de redistribution, c’est de considérer les termes dans lesquels il faut organiser une forme d’égalisation des conditions, des chances et des situations. L’État providence organise une certaine vision de la solidarité – l’État social classique, auquel s’ajoute l’État fiscal. La crise de l’État providence était liée aux limites du prélèvement fiscal. L’État hygiéniste se préoccupe de la population considérée dans sa globalité. Son sujet, c’est la population, alors que celui de l’État providence, ce sont les individus et donc les groupes sociaux.
Quelle est l’histoire de cet État hygiéniste ?
Elle a été marquée par plusieurs grandes dates : la première, c’est celle de l’épidémie de choléra, en 1832. Après cet épisode, on a vu se développer des conseils de salubrité publique. Lors de la nouvelle épidémie de choléra, en 1849, plus forte que la précédente, énormément de décisions ont été prises par la Seconde République qui ont amené l’État à reconsidérer son rôle et son champ d’action. Il a fait des réglementations et mis en place des institutions pour gérer l’insalubrité des logements, comme les comités consultatifs d’hygiène et de salubrité publique. À ce propos, un républicain célèbre, Martin Nadaud, a écrit : « Je crois que l’apparition du choléra dans notre vieille Europe, au lieu d’avoir été un malheur, a été au contraire un grand bienfait. Sans le choléra, en France comme à Londres, je doute que les pouvoirs publics eussent jamais songé à porter la pioche dans les quartiers pauvres. »
Cette forme de l’État passe à une étape supérieure après les découvertes de Pasteur. La vision du lien social va au-delà des relations perceptibles : c’est aussi la circulation invisible des microbes. Et Pasteur va dessiner une vision du rapport entre l’État et la société renforçant cette première étape hygiéniste que les historiens nomment « infectionniste ». C’est ce que symbolise Léon Bourgeois, grande figure de l’État social.
On avait un peu oublié cette dimension de l’État, car l’éradication de la tuberculose a marqué la fin de l’âge des grandes épidémies en Europe. Mais cet État hygiéniste a été le premier grand vecteur de l’action publique au nom d’une conception d’un État au chevet d’une population. Il a été historiquement décisif dans la construction de l’État.
Dans cette crise, on voit le modèle libéral de la mondialisation attaqué : pensez-vous qu’il puisse être abandonné ?
On ne sait pas encore si c’est une situation momentanée, une parenthèse, ou un véritable tournant. En revanche, la situation actuelle montre qu’il faut déplier la notion de mondialisation. Elle est devenue un fait culturel qui ne s’arrêtera pas. Il revêt des formes économiques qui demandent à être reconsidérées : si un seul pays produit un ensemble de médicaments décisifs, pour des raisons de sécurité sanitaire, il va sûrement falloir revoir cela. Mais plutôt que de dire que mettre un frein à la mondialisation s’impose à présent, il faudrait déconstruire cette vision globale et unifiée. Car nous souffrons aujourd’hui en réalité d’un manque de mondialisation.
Dans quel sens ?
D’abord dans la coordination des actions. On voit bien que nous manquons d’Europe aujourd’hui, en matière de politique budgétaire, mais aussi que nous ne parvenons pas à considérer l’Europe comme une seule population et pas simplement comme une addition de populations nationales. Cette vision un peu trop étriquée est problématique.
Assistons-nous, comme en 2008, à un retour en force du concept même d’État protecteur des individus ?
Tout dépend à quelle dimension de l’État on fait référence. Ce qui a faibli, c’est l’État régulateur. Mais l’État égalisateur des conditions n’a jamais été remis en cause, même si on doit réinventer certaines de ses modalités, notamment la Sécurité sociale, parce que les modes de redistribution des richesses, les modes d’organisation de la société, les termes des inégalités ont été modifiés.
Les témoignages de solidarité à l’égard des agents de l’État providence ont été nombreux depuis le début de la crise et ses institutions jouissent d’un haut niveau de confiance, que ce soit l’hôpital ou l’école……
L’épidémie a un effet d’égalisation des situations ; elle ramène chacun à être un membre de la population à égalité avec les autres et réintroduit l’idée du commun. Ce rapport au commun est aussi celui qui existe dans un État de guerre. L’écrivain Ernst Jünger disait que, lors de la Première Guerre mondiale, chacun avait senti combien la notion de nation pouvait prendre un sens presque physique. C’est la même chose aujourd’hui, dans cette période d’épidémie. Et puis s’il y a bien une institution qui est la gardienne de la population, c’est l’hôpital. Quant à l’école, à tort ou à raison, elle incarne l’une des institutions gardiennes de l’égalité.
Les énormes dépenses publiques engagées ne risquent-elles pas d’appauvrir l’État pour de longues années ?
Les sorties d’épreuves collectives se sont toujours opérées à travers des formes nouvelles de solidarité. Un impératif moral de solidarité apparaît alors. Pour ma part, je n’imagine pas qu’à la sortie de cette épreuve, il n’y ait pas un grand impôt de solidarité nationale. Bien sûr, ce déficit, il ne faut pas simplement le faire porter aux générations futures. Il doit être résorbé. Une partie de l’épargne des Français devra le payer. Mais là, il faudra un véritable impôt sur les patrimoines et la fortune. Il n’y aura pas de sortie de crise sans que la société solde les comptes. Et cela ne pourra se faire sans qu’il y ait une contribution majeure et massive de ceux qui ont les patrimoines les plus importants.
On a supprimé l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune dont le taux maximum atteignait 2 %. Dans quelques mois, j’espère qu’aller bien au-delà de ces 2 % constituera une évidence politique, sociale et morale. Il devrait y avoir un impôt exceptionnel sur les patrimoines, qui soit proportionnellement bien plus élevé pour les patrimoines les plus importants. Il faut qu’il y ait un signal de reconsidération des inégalités et des patrimoines qui ait une portée symbolique plus forte et qui aille au-delà d’un simple rétablissement de l’ISF.
Pourrait-on assister à un bouleversement des rapports entre l’État et les entreprises, à l’heure où même le Medef demande des nationalisations ?
Oui, mais à ce moment-là, c’est l’État brancardier qui devient le sauveur de l’économie. Le Medef le demande mais ce serait de la nationalisation temporaire. En 2008, il y avait eu un soutien massif à l’économie dans un souci de rétablissement, mais cela n’avait pas débouché sur une restructuration. Peut-être va-t-on arriver à cette restructuration aujourd’hui. Même si, pour l’instant, la question ne semble pas à l’ordre du jour.
Après cette crise, peut-on s’attendre à une société plus solidaire et plus responsable, en particulier sur le plan de l’écologie, et assister à une prise de conscience plus globale ?
Il est certain que si l’on revient à l’histoire, on s’aperçoit que la vision hygiéniste de l’État a eu un impact sur la façon de reconsidérer la ville, le logement, les rapports entre les individus. Aujourd’hui, cela va certainement, d’une manière ou d’une autre, se reproduire. Il faut en tout cas le souhaiter. Une épreuve de confinement, même si elle ne dure que deux mois, implique de revoir ce qui est nécessaire, de réinventer une forme de frugalité ; une certaine conception de la société de consommation est mise temporairement de côté.
Quelles conséquences peut avoir ce confinement pour les libertés individuelles ? Pourraient-elles durablement en pâtir ?
Non, je ne le pense pas. Et c’est pour cela qu’il est très important de clarifier ce que veut dire un état d’urgence sanitaire. Il faut constitutionnaliser l’exception, afin qu’elle ne devienne pas insidieusement la règle. Que tout ce qui est exceptionnel soit voté pour une durée limitée, avec des institutions ad hoc. Il faut avoir une pensée de l’exception. Après les attentats du Bataclan, il y a eu une forme d’état d’urgence déclaré. Nous vivons dans une démocratie où il faut faire une place à ces états d’urgence, en les encadrant clairement dans le temps, tout en définissant la nature des institutions chargées de les mettre en œuvre comme les conditions de leur contrôle. Car sinon le temporaire peut devenir la matrice d’habitudes liberticides.
Pensez-vous qu’à la sortie de cette crise on pourrait voir se dessiner les contours d’un État original ?
Non, je ne vois pas émerger de choses originales. Car ces expériences de l’État hygiéniste et de l’État providence s’inscrivent dans une histoire longue. Nous sommes à un moment de cette histoire. En revanche, il y a un élément qui pourrait marquer une rupture dans les formes démocratiques. Bien sûr, on va porter une attention accrue à une institution symbolique comme l’hôpital, qui en sera revalorisé. Mais on découvre aussi à présent l’importance d’une implication citoyenne. Des institutions publiques renforcées ne peuvent être mises en place et financées que si elles sont légitimées par le sentiment d’une communauté solidaire. C’est la qualité de la démocratie qui donne son sens profond aux différentes figures de l’État. Là, nous voyons que notre démocratie est fragile, contestée et inachevée. Je constate un appel à une démocratie renforcée et plus vivante, qui ne soit pas simplement une démocratie électorale, mais une démocratie permanente. La représentation ne doit pas être simplement l’élection des délégués. Chacun doit avoir le sentiment que ce qu’il vit est présent dans le débat public et le débat social. Cette forme de démocratie avancée est la condition d’un nouveau rapport entre l’État et la société.
Propos recueillis par VINCENT MARTIGNY et FRANÇOIS VEY
[Majuscule]
Robert Solé
Avec une majuscule, l’État, c’est l’ensemble des institutions et des services qui permettent de gouverner et d’administrer un pays. On en connaît de toutes les couleurs : démocratique, autocratique, despotique, totalitaire, d…
Gare à l’illusion nationale !
Justine Lacroix
Jean-Yves Pranchère
Le Covid-19 sera-t-il notre nouveau Roosevelt ? Il est évidemment trop tôt pour le dire et l’expérience de 2008 devrait inciter à la prudence. Mais voir ceux qui, hier, n’en avaient que pour le new public management et la…