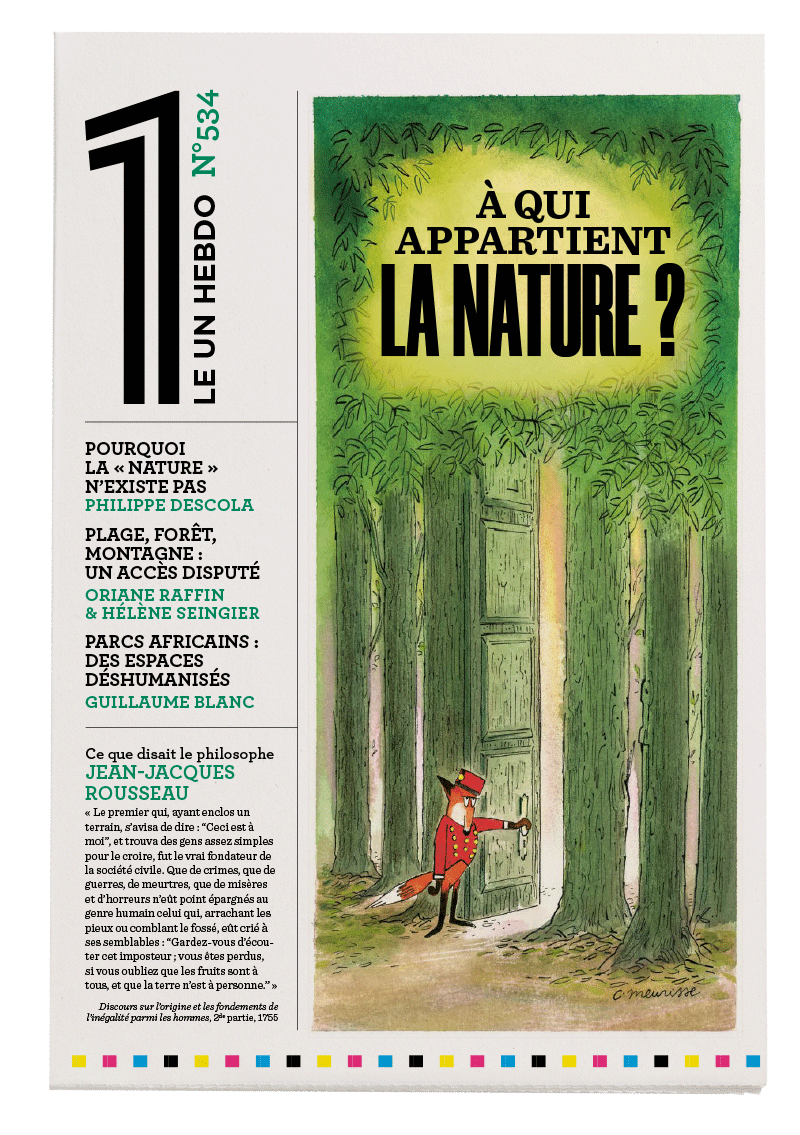Légitimité vs légalité
Temps de lecture : 3 minutes

De la purée sur un Monet, de la soupe à la tomate projetée contre les Tournesols de Van Gogh et La Jeune Fille à la perle de Vermeer, des graffitis bleus sur un Warhol, des mains collées à un Picasso… Après un été de cendres, l’automne a pris les couleurs arc-en-ciel de l’activisme écolo-artistique. Ces œuvres étant toutes protégées par des vitres, aucune n’a été détériorée, mais ces happenings ne sont pas passés inaperçus. Un vent de désobéissance civile souffle sur la planète. Des militants mettent leurs pas dans ceux des grands anciens (la marche du sel en Inde, le mouvement des droits civiques aux États-Unis) ou de leurs aînés (Act-up, Greenpeace…) qui ont considéré que seule une résistance publique et non violente était susceptible de s’opposer à des lois jugées injustes.
Dans ce numéro du 1, nous avons voulu comprendre les raisons pour lesquelles la tension entre légitimité et légalité était réactivée par les refus de la catastrophe climatique et des violences sexistes et sexuelles, combats politiques à dimension existentielle. Après nous avoir expliqué les rapports complexes que la désobéissance entretient avec la démocratie, le philosophe Frédéric Gros estime qu’il faut entendre la rage et le désespoir qui s’expriment dans des actions « parfois un peu musclées ».
Une quinzaine de désobéissants climatiques ont raconté à notre reporter Manon Paulic leur parcours, leurs motivations et leurs débats sur les méthodes d’action : si tous rejettent la violence à l’encontre des personnes, la question de la détérioration de matériels, voire des sabotages, est posée par certains. Des suffragettes aux Femen, ces interrogations traversent également les combats féministes, dont l’historienne Florence Rochefort dresse un tableau complet.
Depuis le début de l’année, le ministère de l’Intérieur a recensé 104 actions de « malveillance »
Cet été, des pneus de SUV ont été dégonflés, des parcours de golfs ont été sabotés, quelques jacuzzis ont été éventrés. Depuis le début de l’année, le ministère de l’Intérieur a recensé 104 actions de « malveillance », sans pour autant fournir le moindre indice d’« écoterrorisme ». Fin octobre, des centaines d’activistes se sont attaqués au chantier d’une méga-bassine à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, réussissant à couper un tuyau d’alimentation d’eau au prix d’affrontements sévères avec les forces de l’ordre qui craignaient l’installation d’une nouvelle ZAD. Ces zones à défendre concentrent l’ambivalence de la désobéissance, à la fois symptôme d’une désertion de l’espace commun, pour l’intellectuelle Anne-Lorraine Bujon, et potentielle invention « de nouvelles formes de socialité », pour Frédéric Gros. Il y a huit ans, la ZAD de Notre-Dame des Landes était un camp retranché. Fin août, elle est devenue partenaire de l’ONF pour la gestion de la forêt environnante.
« La désobéissance nous aide à redéfinir la politique »
Frédéric Gros
Auteur en 2017 d’un livre intitulé Désobéir, le philosophe Frédéric Gros nous livre sa vision de la recrudescence actuelle des actions de désobéissance civile pour le climat.
Désobéir ou périr
Manon Paulic
Une quinzaine d’activistes pour le climat témoignent de leurs motivations, des modalités de leurs actions, ainsi que des dilemmes et des débats qui traversent leurs rangs.
[Formation]
Robert Solé
Les stages de désobéissance civile font florès. On y apprend notamment à faire la tortue, pour cesser de faire l'autruche. Explications dans ce dialogue imaginé par l'écrivain et journaliste Robert Solé.
Une colère à prendre au sérieux
Anne-Lorraine Bujon
Anne-Lorraine Bujon, chercheuse à l’Ifri et directrice de la rédaction de la revue Esprit, invite nos démocraties à prendre au sérieux ce « double mouvement de détachement et de colère ».