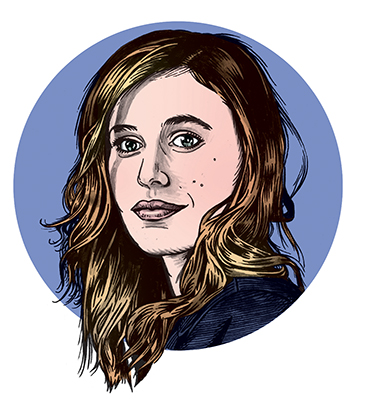Boutef ciao
Temps de lecture : 4 minutes
On a sorti les drapeaux et pourtant ce n’est pas jour de match. On pousse des youyous et pourtant ce n’est pas pour célébrer un mariage. On nettoie après chaque marche et pourtant nous ne sommes pas chez nous. En fait, si, mais ça, on avait presque fini par l’oublier tant le pouvoir algérien nous donnait l’impression d’être des cousins pauvres à peine tolérés. Ce pouvoir constitué par un ensemble d’hommes d’affaires, de députés, de diplomates, de hauts gradés, de conseillers et de membres de la famille de Bouteflika. Ils avaient presque réussi à nous faire croire qu’il ne s’agissait pas de nos rues, nos murs, nos villes.
Nous vivons depuis deux décennies en cohabitation. Ils font leurs affaires, achètent des biens immobiliers partout dans le monde, changent la Constitution lorsqu’elle devient trop étroite pour eux, créent des lois à leur juste mesure pendant que, nous, nous vivons dans une réalité différente, tentant de rester fidèles à nous-mêmes dans un pays où nous ne sommes jamais consultés et où notre parole n’était audible que sur les réseaux sociaux.
Mais depuis quelques années déjà, cette cohabitation connaît des perturbations.
En 2011, de jeunes militants s’organisent en collectif et font pression sur le gouvernement. Ils réussissent à obtenir la libération du moudjahid Mohamed Gharbi qui purgeait une peine en prison depuis déjà dix ans pour avoir assassiné Ali Merad. Ce dernier, un terroriste ayant bénéficié de la concorde civile, était revenu vivre dans le même immeuble que Mohamed Gharbi, le narguant et le menaçant de mort.
En 2016, un jeune artiste est arrêté place Maurice-Audin, à Alger, pour avoir joué de la guitare dans la rue. Les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire et de nombreux musiciens professionnels ou amateurs descendent à leur tour dans la rue. On chante, on danse, on crie son soutien. Il est relâché et le maire d’Alger-Centre accorde des autorisations pour permettre aux artistes de jouer dans les rues en toute légalité.
Un mois plus tard, des résidents de Dely-Brahim, commune de l’ouest d’Alger, se défendent contre des généraux qui se sont approprié leur terrain de football pour construire des villas.
Oui, la cohabitation se fissurait et au mépris envers le peuple algérien s’ajoutait le ridicule. Abdelaziz Bouteflika ne peut plus se déplacer ? Qu’à cela ne tienne, il est remplacé par une photo de lui datant de plusieurs années, encadrée et installée sur une chaise. En février, quelques semaines avant la première manifestation, on avait assisté à cette scène pathétique où des dirigeants du FLN offraient un cadre au… cadre d’Abdelaziz Bouteflika.
Ce système en train de s’écrouler, j’en suis réduite à le suivre sur les réseaux sociaux du matin au soir. J’ai raté toutes les grandes révoltes de l’Algérie de ces trente dernières années. En octobre 1988, j’avais à peine deux ans. J’étais trop petite pour ouvrir la porte de la maison, sans doute fermée à double-tour, même si mes parents racontent que, dans les années quatre-vingt, on ne fermait pas les portes à clé. En juin 2001, lors du printemps noir kabyle, j’étais à plus de 400 kilomètres de là, autant dire sur une autre planète pour l’époque. Aujourd’hui, c’est à Alger que je devrais être. Sous le tunnel des facultés, rue Didouche-Mourad, place Maurice-Audin, rue Hamani… Plus j’habite en France et plus je vais en Algérie. Je fais partie de ces horribles étrangers qui non seulement volent le travail des Français, mais continuent de prendre des avions tous les deux ou trois mois pour rentrer chez eux au lieu d’aller en Ardèche.
Mais encore une fois, je rate la révolution. Coincée à Paris, c’est depuis mon canapé que je suis ce qui se passe, harcelant mes amis, actualisant sans cesse mon fil Twitter, pestant contre les analyses à l’emporte-pièce de certains médias.
Je zoome sur les photos et vidéos. Je reconnais parfois quelques visages. Je vois cette génération, qui est la mienne mais aussi celle de mon petit frère, qui a grandi avec des barreaux aux fenêtres. Ils sont tous beaux, courageux, drôles.
Juste après les premières manifestations et alors que le monde entier saluait leur pacifisme, leur esprit joyeux bien que contestataire, Ahmed Ouyahia, alors Premier ministre, a rappelé qu’en Syrie aussi « ça a commencé […] avec des roses ». En réponse, les Algériens sont descendus encore plus nombreux dans la rue, tenant des pancartes où on pouvait lire : « Nous ne sommes pas la Syrie. »
Nous sommes les enfants des années quatre-vingt-dix. Nous avons été Charlie bien avant le reste du monde car, dès 1996, nous étions Le Soir d’Algérie*. Nous savons ce qu’est l’intégrisme. Nous avons vu nos amis et familles être assassinés dans une indifférence quasi générale. Nous avons vu tous les pays nous fermer leurs frontières. Nous ne sommes pas la Syrie car nous l’avons à vrai dire déjà été et l’avons payé de notre sang, de notre enfance, de notre jeunesse et de notre insouciance.
Nous voici à la croisée des chemins.
Nietzsche disait qu’il fallait avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Gageons que cette musique nous accompagne encore longtemps !
* Le 11 février 1996, une voiture piégée explose à Alger, devant la maison de la presse qui regroupe plusieurs journaux, faisant des dizaines de morts et des dégâts considérables.
« Bouteflika incarne un régime insensible à toute critique »
Mohamed Kacimi
La renonciation de Bouteflika est-elle une victoire de la rue algérienne ?
Non, il ne s’agit pas d’une victoire, mais au contraire d’une confirmation de la cécité et de la surdité du régime. Il faudrait être naïf pour croire que cette caste, accroché…
[Momification]
Robert Solé
On n’arrête pas de qualifier Abdelaziz Bouteflika de momie. Ce n’est pas très gentil pour les momies. Il ne faut d’ailleurs pas tout mélanger. Ni Ramsès II ni Séthi Ier, qui reposent côte à côte …
Les spectres de Kabylie
Philippe Meyer
Sujet du concours : « Jugurtha, roi numide. » Jugurtha, roi berbère, qui tint tête sept années durant aux armées de Rome. Jugurtha, roi kabyle, que Caius Marius ne put asservir que par traîtrise. Jugurtha, qui rétablit l…