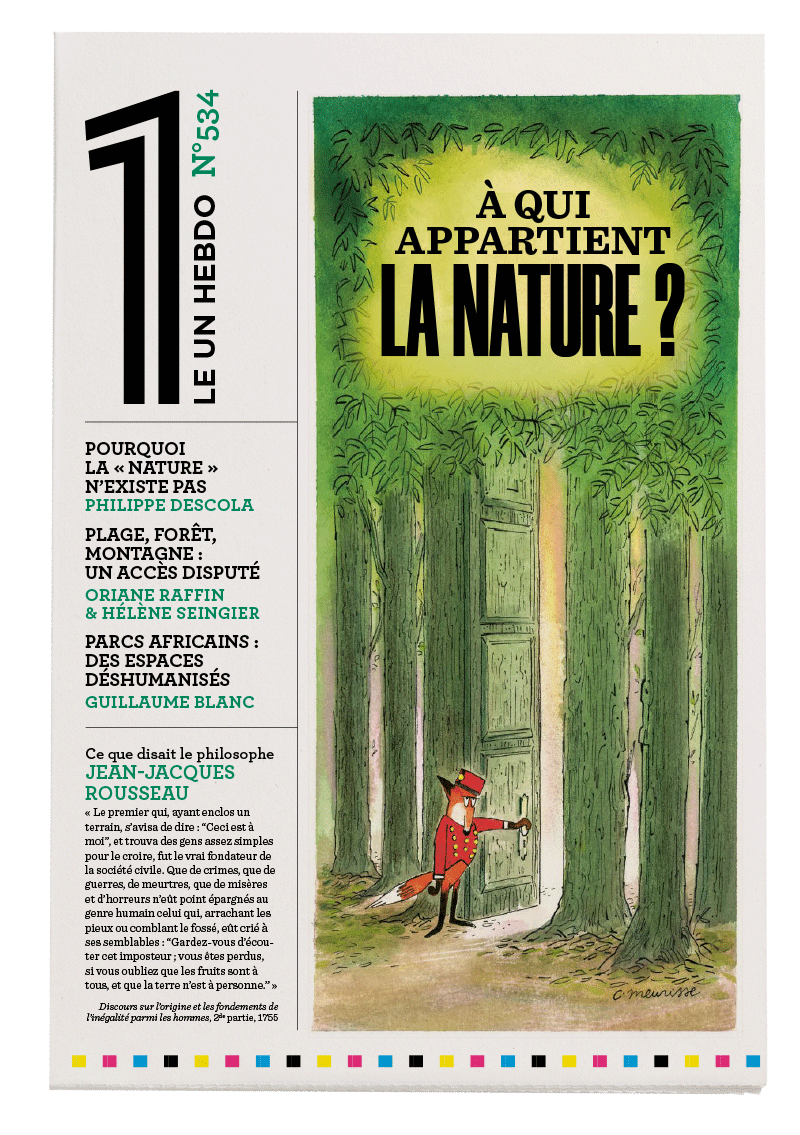La Peur
Temps de lecture : 4 minutes
Gouverner, c’est parfois avoir peur.
C’est avoir peur que Notre-Dame brûle puis s’effondre. C’est sentir l’angoisse monter lorsque le général Gallet, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, après avoir mesuré tous les risques, après avoir évoqué toutes les options, propose d’envoyer dans la tour nord, alors que la nuit tombe, une vingtaine de ses hommes pour essayer de sauver la cathédrale et qu’il relève les yeux vers le Président, pour savoir si, le risque opérationnel étant admissible, le risque politique qu’il reviendra au Président et au gouvernement d’assumer peut être couru. C’est la peur de l’attente. Et c’est surtout la peur qui vous saisit, 24 heures après, lorsque la cathédrale est sauvée, lorsque l’Assemblée unanime et la nation tout entière ont salué les héros et tous ceux qui ont participé à cet incroyable sauvetage, en passant devant les Invalides : c’est être pris d’un tremblement incontrôlable des mains en imaginant, comme dans un cauchemar, les vingt cercueils alignés des pompiers s’ils n’avaient pas réussi leur exploit et que la cathédrale s’était effondrée. Il arrive d’avoir peur avant les faits, mais il n’est pas rare aussi d’avoir peur après.
« Le pire n’arrive pas toujours, mais il ne doit jamais être exclu »
C’est parfois avoir peur que quelqu’un frappe à la porte. Il se trouve qu’échoit au Premier ministre la responsabilité de la défense aérienne du territoire. À ce titre, il lui revient d’ordonner le feu contre un aéronef qui constituerait un danger avéré. Tout cela peut sembler théorique. Mais l’expérience du gouvernement montre que rien de ce qui peut sembler théorique ne doit être pris à la légère. Le pire n’arrive pas toujours, mais il ne doit jamais être exclu. Le pire peut prendre la forme d’un renseignement indiquant qu’un avion d’une compagnie aérienne étrangère, décollant d’un pays voisin et se rendant dans un pays tiers mais survolant notre territoire, pourrait être détourné et transformé en avion suicide pour commettre un attentat d’ampleur. Le renseignement n’est pas complètement solide, mais il est suffisamment sérieux pour que le dispositif d’alerte et de réaction soit placé à un niveau de mobilisation maximale. Et qu’ainsi, toute la journée, pendant toutes les réunions qui doivent se tenir normalement, dans les ministères ou à l’Assemblée, sous l’œil des caméras, ou dans votre bureau, vous redoutiez que le chef de votre cabinet militaire, un général qui en a vu d’autres, mais qui n’est pas totalement détendu pour l’occasion, vienne vous interrompre pour vous annoncer qu’il faut décider.
C’est avoir peur de manquer de médicaments. Lorsque l’épidémie de Covid-19 s’est déclarée en France, les stocks de médicaments nécessaires à la réanimation étaient constitués dans les hôpitaux. Les circuits d’achat étaient éprouvés. Il n’y avait pas de précédent d’une tension réelle sur ces approvisionnements. Et puis l’épidémie a éclaté. Chez nous, bien sûr, mais aussi en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Belgique. Puis aux États-Unis. En quelques semaines, la consommation de ces médicaments indispensables à l’anesthésie et au maintien en intubation a progressé de 2 100 %. Aucun stock ne résiste à une consommation aussi rapide, à des réanimations aussi nombreuses et aussi longues. Et pendant quelques jours, la crainte d’une pénurie de ces médicaments a été sérieuse : les stocks dans certains hôpitaux du Grand Est, des Hauts-de-France ou de l’Île-de-France n’étaient plus que de quelques jours, et il aura fallu les efforts remarquables et trop souvent ignorés, voire dénigrés, des autorités sanitaires françaises (et des membres du corps diplomatique) pour mettre en commun les réserves de médicaments d’établissements hospitaliers de toute la France et réussir à acheminer dans des conditions parfois rocambolesques les molécules indispensables aux soins prodigués par les services de réanimation. Mais pendant ces quelques jours, où l’approvisionnement est resté incertain, où les démarches internationales intenses et les réorganisations internes profondes ont permis d’éviter une situation dramatique, la peur a rôdé et saisi beaucoup de ceux qui gouvernaient.
Évidemment, ce jour d’avril 2017, en sortant du bureau du dernier étage de cet immeuble banal du XVe arrondissement de Paris, aucune de ces raisons d’avoir peur n’était envisageable. Notre-Dame semblait éternelle, les gilets jaunes rangés dans les coffres des voitures ou dans les boîtes à gants et les pandémies lointaines dans l’espace et dans le temps. Le risque d’attentat était bien plus concret, le pays ayant été durement éprouvé par le passé par des actes abominables et criminels. Mais sans toujours mettre un nom ou une image sur les dangers auxquels notre pays est soumis, la perspective de gouverner impose de prendre la mesure des risques immenses qui se présentent. Et à ces risques, qui provoquent à raison l’angoisse, s’ajoute un sentiment plus humain, plus naturel, plus normal même : la peur de faire. D’être non plus en situation de commenter, d’objecter, de proposer, de critiquer, dans une opposition qui peut être féroce ou constructive, mais qui ne ressemble à rien de ce que peut être le fait de gouverner. D’être en situation de prendre des décisions multiples, dans les domaines les plus variés. De devoir répondre de ces choix, d’en être comptable.
Impressions et lignes claires © JC Lattès, 2021
« Avec cette nomination, le président a brûlé sa dernière cartouche »
Bastien François
Selon le politiste, la nomination de Michel Barnier à Matignon représente un double déni démocratique : il fait du RN le maître du jeu parlementaire alors même que le corps électoral a très majoritairement rejeté ce parti lors des dernières législatives ; il signifie aussi le refus de la demande …
[Côté jardin]
Robert Solé
Matignon est peut-être un enfer, mais le parc de près de deux hectares dont bénéficie cet hôtel cinq étoiles est un paradis. On n’en finirait pas de citer toutes les merveilles qu’il contient et les techniques naturelles, sans un gramme d’engrais chimique, qui lui ont permis d’obtenir le label « …
Une fonction malmenée par le présidentialisme
Alain Duhamel
Fin connaisseur de l’histoire de la Ve République, le journaliste raconte comment les présidents, de De Gaulle à Macron, ont eu tendance à affirmer leur primauté au détriment de leurs Premiers ministres.