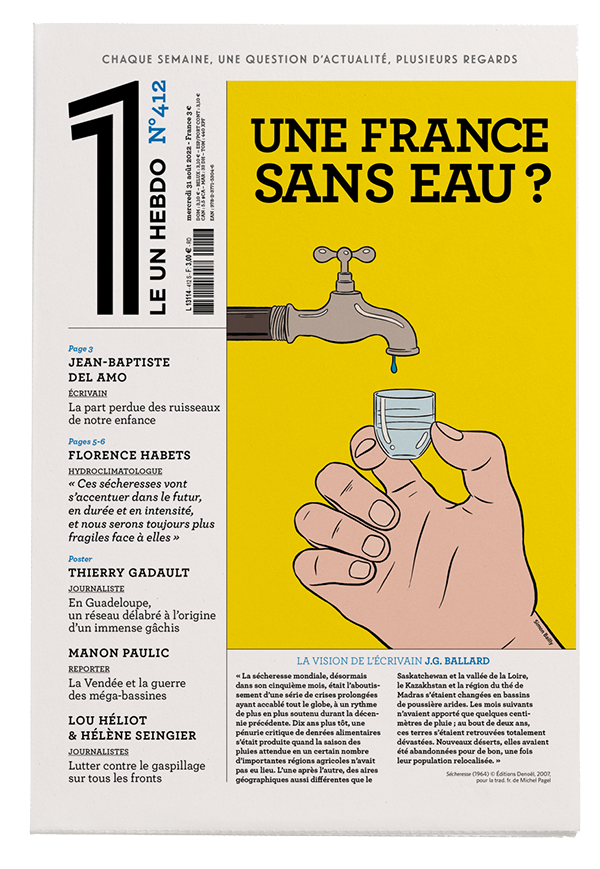Ce qui se tait
Temps de lecture : 4 minutes
Ce n’était pas une terre de lacs, de marais. La Garonne nous semblait loin. L’eau ne s’y rencontrait que par hasard. Un mince ruisseau glissait dans le creux herbeux d’un fossé avant de disparaître dans la pénombre d’une buse de béton. Au détour d’un chemin, dissimulées par un coteau, les eaux verdâtres d’un lac d’irrigation surgissaient, clapotant contre des berges ourlées, bordées de saules pleureurs.
Au village, un petit cours d’eau passait, l’Aussonnelle, qui prenait sa source dans la province du Savès pour rejoindre la Garonne quelque quarante kilomètres plus loin. Là, mon père m’amenait observer et capturer des grenouilles. Il fallait différencier la grenouille rousse de la grenouille agile, la rieuse de la Lessona.
L’ombre moite des roseaux, le secret des limons
Rien ne m’enthousiasmait plus que ces heures passées à l’affût, le regard rivé sur les frémissements de l’eau, l’ondoiement des algues, l’observation patiente et dévouée de la vie qui se logeait dans les interstices des pierres, l’ombre moite des roseaux, le secret des limons.
Au printemps, les pluies formaient çà et là des trous d’eau, de vastes flaques où venaient pondre crapauds et tritons – pas un seul de ces points d’eau accidentels que la vie n’ait aussitôt colonisé. Il suffisait de s’y attarder pour contempler l’infinie variété de ses formes.
Nous y trouvions d’abord de larges grappes d’œufs translucides qui ne tardaient pas à éclore, puis la cohorte gracile des têtards bordant les flaques comme autant de gouttes d’encre versées sur les sables ocre, ou patiemment suspendues aux tiges d’herbe immergées desquelles ils s’élevaient soudain pour gagner la surface, happer l’air et regagner prestement leur position. Renversés dans le creux de la main, ils dévoilaient leur abdomen nacré, leur petite bouche bordée de noir et leur œil de poisson-globe.
À trente ans de ces heures magiques, je mesure combien elles ont été constitutives de ma sensibilité, de mon imaginaire
À genoux près de la flaque, enjambant le ruisseau pour mieux m’y pencher ou me retenant aux racines nues des saules qui affleuraient sur les berges friables du lac d’irrigation, je faisais l’apprentissage d’une certaine présence au monde. À trente ans de ces heures magiques, je mesure combien elles ont été constitutives de ma sensibilité, de mon imaginaire.
C’étaient, sans que je le sache, les instants d’un bonheur plein, parfait, désormais nimbés dans mon souvenir par l’éternelle lumière de ces étés-là, ceux de l’enfance – l’effrayante larve de la libellule fouissant la vase à la recherche d’une proie, le placide triton palmé, la couleuvre à collier surprise à se prélasser au soleil sur une rive, et qui file majestueusement à la surface de l’eau.
Au petit garçon que j’étais, ces explorations offraient le lieu et le temps, depuis à jamais perdus, d’une forme de communion sensorielle, dans le silence bruissant de la nature, débarrassée du langage. Un espace où mon corps d’enfant était comme soustrait à sa condition, retournant sans difficulté à quelque stade antérieur de moi-même, à ma propre espèce, fusionnant d’une certaine façon avec l’essence du monde. Je faisais, sans avoir lu un seul poème, l’expérience ineffable de la poésie.
Par contraste, c’était le temps aussi de la découverte de ma propre cruauté. Étais-je désireux d’emporter avec moi quelque chose de cette ivresse sensuelle ou simplement avide de posséder ces êtres aux formes extraordinaires dont j’apprenais par cœur les noms communs et les noms latins ? J’enfermais pêle-mêle dans des bocaux, des terrariums bricolés, des aquariums rafistolés, tritons, couleuvres, têtards et dytiques, sans parvenir à reconstituer quoi que ce soit de leur biotope, les condamnant à une mort certaine dont seuls réchappaient ceux qu’il fallait finalement me résoudre à relâcher.
Il m’aura fallu du temps, bien trop de temps, pour comprendre ce que nous devons aux animaux. « Car l’animal, écrit Henry Beston dans La Maison du bout du monde, ne doit pas être mesuré par l’homme. Dans un monde plus ancien et plus complet que le nôtre, il se meut, achevé et parfait, doué d’une perfection que nous avons perdue (à moins que nous ne l’ayons jamais atteinte), guidé par des voix que nous n’entendrons plus jamais. Les animaux ne sont pas nos frères, ils ne sont pas nos vassaux : ils constituent un autre peuple, pris avec nous dans le réseau de la vie et du temps, prisonniers avec nous de la splendeur et du laborieux travail de la terre. »
Des voix secrètes, infiniment modestes, se sont tues
Aujourd’hui, une rocade ralliant Toulouse borde le lotissement où j’ai grandi. Quelques prés subsistent par endroits entre les nouvelles résidences aux accès sécurisés, une centrale de traitement des eaux usées, un champ de panneaux solaires. Les fossés se sont asséchés, ont été enterrés. L’Aussonnelle ne charrie plus que des morceaux de polystyrène ou des amas de mousse jaunâtre qui s’attardent pesamment au pied des joncs.
Quelque chose s’est éteint en silence, et continue de s’éteindre, sans que nous en ayons conscience, ou ne paraissions vouloir nous en émouvoir véritablement. Des voix secrètes, infiniment modestes, se sont tues, emportant avec elles une part de ce qu’ensemble, avec elles, nous formions : la communauté du sensible.
Parfois, sur une berge triste, il arrive qu’un vieil enfant se souvienne, le cœur lourd de nostalgie, de cet enchantement du monde qu’il avait cru effleurer du doigt.
« Il y a peu d’espoir que la situation s’améliore rapidement »
Florence Habets
Pour l’hydroclimatologue Florence Habets, l’épisode de sécheresse que nous traversons en annonce d’autres, d’une ampleur encore inédite. Il faut nous y préparer.
[Que d’eau !]
Robert Solé
En juin 1875, visitant une région dévastée par les crues de la Garonne, le maréchal de Mac Mahon était visiblement en mal en panne d’inspiration.
Le cycle de l’eau potable et les usages de l’eau
Le cycle de l’eau potable et les usages de l’eau, deux infographies réalisées par Claire Martha.