« Cette peinture contient le monde entier »
Temps de lecture : 8 minutes
Peut-on distinguer différentes périodes dans l’œuvre de Pierre Soulages ?
Son œuvre est d’une remarquable cohérence, mais on peut incontestablement y déceler des « phases ». La principale rupture se situe en 1979, lorsque commence cette période qu’il a appelée Outrenoir. On peut constater aujourd’hui qu’elle se poursuit.
Quels sont les principaux moments avant 1979 ?
Le premier moment commence lorsqu’il arrive en 1946 à Paris. Sa peinture se caractérise par des petits formats et l’utilisation du brou de noix, qui est d’ordinaire employé par des ébénistes ou des menuisiers. Ce matériau permet alors à Pierre Soulages de développer un travail tout à fait original sur le plan formel.
Ensuite, tout au long des années 1950, il y a des peintures, souvent de grand ou de très grand format, où il travaille une matière épaisse, puissante, en faisant apparaître la lumière.
Au contraire, vers le milieu des années 1960, il utilise une peinture beaucoup plus liquide avec de grandes nappes de couleur. Il joue du contraste entre le sombre et le clair, le noir et le blanc, le noir et d’autres couleurs. Il est très abusif de dire que Soulages ne peint qu’avec du noir, cela va de soi. Ce qu’il affirme et revendique, c’est un travail sur la lumière.
En quoi l’année 1979 marque-t-elle une évolution majeure ?
Avec l’Outrenoir, il réduit le protocole de sa peinture à un seul pigment. Et selon la manière dont il applique cette matière, les contrastes lumineux diffèrent. C’est pourquoi il explique qu’il s’agit d’une peinture non pas monochrome mais polychrome, obtenue avec une seule couleur !
Il a raconté la nuit de cette révélation, de cette découverte… Il est en train de patauger dans la couleur sans parvenir à s’en sortir et finit par quitter son atelier en laissant tout en plan. Quand il revient peu après, il s’est passé quelque chose sur la toile qui l’intéresse. À partir de là, il engage une nouvelle voie qui demeure ouverte aujourd’hui. C’est cela qui est assez étonnant. On aurait pu penser qu’avec un protocole aussi resserré, au bout de quelques œuvres, cela s’épuise. Mais il est très libre, il ne s’est pas enfermé dans un système trop contraignant, et il existe des différences tout à fait notables d’une œuvre à l’autre.
Pourquoi a-t-il renoncé aux cadres pour ses tableaux ?
Il a d’emblée refusé leur encadrement. Quelquefois, on voit dans des expositions des Soulages avec de beaux cadres dorés ou noirs… Je fais partie de ceux que cela désole, car c’est complètement contradictoire avec son idée de la peinture. Pour lui, la peinture est un objet. Si le tableau est très grand, il peut être assimilable à un mur et le fait de lui mettre un cadre autour n’a aucun sens.
Peut-on le considérer, à ses débuts, comme un peintre gestuel ?
Non. Cela sous-entendrait que sa peinture est fondée sur l’écriture d’un geste. Or, Soulages a certes toujours revendiqué le fait que sa peinture exige un geste, mais pas une gestualité. Il a souvent dit, par exemple à propos de ses peintures de 1946-1947, que l’œuvre doit se lire d’un seul coup, en une seule fois. Contrairement à certains peintres qui ont travaillé à partir d’une écriture du geste, comme Georges Mathieu, Soulages inscrit sa peinture comme une totalité sur sa toile. C’est un geste très contrôlé.
Cherche-t-il à limiter sa présence subjective, à se mettre en retrait ?
Il essaye d’éviter tout ce qui pourrait relever de l’anecdotique et d’une narration, y compris d’une narration abstraite. Sa peinture ne raconte pas un moment, un état d’âme. Si vous lui posiez la question, il répondrait probablement qu’il ne s’efface pas devant sa peinture. Il est là ! Il est bien présent, mais il ne se raconte pas.
Est-il solitaire ou bien a-t-il fait partie d’un groupe ?
Il s’est toujours méfié de tout ce qui est mouvement, école, label. Il a récusé tout cela, mais il n’est pas isolé. D’abord c’est un homme qui aime le monde, très sociable, curieux, en relation avec les milieux artistiques. Si vous prenez l’exemple de ses liens avec les peintres américains, il a eu beaucoup de contacts amicaux avec les expressionnistes abstraits, plus âgés que lui – Mark Rothko, qu’il connaissait très bien, ou Robert Motherwell… De même qu’ici, à Paris, il était l’ami de Hans Hartung, de Gérard Schneider. Mais il est toujours resté lui-même, affirmant son autonomie et sa singularité dans un monde où les critiques d’art adorent mettre dans des boîtes plusieurs artistes à la fois. Il n’est assimilable à aucun groupe ou courant spécifique même s’il témoigne d’une relation à l’art non figuratif très exemplaire.
Qu’est-ce qui le singularise ?
Lorsqu’il arrive à Paris, il tente d’exposer au Salon d’automne de 1946 et se voit refuser. Il participe alors au Salon des Surindépendants – sans comité de sélection, il suffisait de payer une cotisation pour y exposer. Débarquant de sa province, complètement inconnu, il est immédiatement repéré. Sa peinture se singularise par rapport à l’esthétique ambiante par sa couleur à dominante sombre, voire noire, et cet usage très particulier du geste. D’emblée, Soulages n’est pas un peintre comme les autres et ses œuvres sont exposées à l’étranger, notamment en Allemagne.
A contrario, a-t-il fait naître un courant ? A-t-il des héritiers ?
Je n’en ai pas l’impression. Je pense qu’il a été très respecté par les générations suivantes et tout particulièrement par des peintres de la mouvance Supports/Surfaces (1969-1972), qui ont considéré son œuvre – et qui l’ont d’ailleurs considérée à un moment où elle était un peu négligée. Ils ont trouvé en Soulages quelqu’un qui les intéressait. Mais Soulages n’a jamais eu d’héritiers, il n’a d’ailleurs jamais enseigné, contrairement à d’autres peintres. Il n’a pas créé d’école, et je crois que cela fait vraiment partie de sa manière d’appréhender la peinture.
On a souvent l’image de Soulages dans son grand atelier blanc, impeccable, immaculé. Pouvez-vous nous faire pénétrer dans cet espace ?
Il a deux lieux de vie, Paris et Sète. À Sète, sa maison est tournée vers la mer, l’atelier non. La lumière du nord vient d’une petite cour qui n’a pas d’intérêt particulier. Le paysage assez sublime que l'on découvre depuis sa maison n’entre absolument pas en jeu dans la façon dont il va être au travail dans l’atelier. On peut parler à cet égard, non d’austérité, mais d’une volonté de considérer la peinture et uniquement la peinture, et de ne pas subir d’interférences.
L’atelier est un espace très simple, d’une dimension tout à fait raisonnable par rapport à beaucoup d’ateliers qu’on voit aujourd’hui.
Comment êtes-vous entré dans cette peinture lorsque vous étiez jeune conservateur ?
Je me souviens avoir vu en 1968 une grande peinture très noire avec quelques éclats de blanc. C’était l’une des deux ou trois qu’il a peintes au cours du mois de mai 68 – qui n’ont rien à voir avec les événements de 1968. Ce tableau m’avait frappé. J’étais jeune. De fil en aiguille, je me suis intéressé à son œuvre et j’ai eu la chance, en 1979 – j’étais alors conservateur dans l’équipe du Centre Pompidou –, de proposer et de voir acceptée l’idée d’une exposition Soulages. J’ai été nommé commissaire de l’exposition au moment même – et ça n’était pas prémédité – où Soulages entrait dans une nouvelle phase de son œuvre. C’est donc là qu’ont été montrés les premiers Outrenoirs.
Existe-t-il une bonne manière d’appréhender son œuvre ?
On peut être aidé, si on le souhaite, par un certain nombre de propos qu’il a tenus sur sa peinture, qui sont éclairants. Quand il dit : « La peinture est un objet », ça peut au moins aider à se débarrasser de toutes les idées reçues qu’on peut avoir sur la peinture.
C’était très impressionnant en 2009, au Centre Pompidou, lors de la grande rétrospective organisée avec Pierre Encrevé, de voir un large public ressentir avec émotion cette peinture. Cela apportait la preuve que son œuvre, présentée parfois comme austère, transmet quelque chose. L’historien Georges Duby a pu faire un rapprochement entre Soulages et l’art cistercien. L’un et l’autre offrent un espace très nu, avec très peu d’événements, sur le plan de l’architecture comme de la peinture, et il s’en dégage tout de même quelque chose de très fort. On peut ressentir une émotion architecturale – je ne parle pas du contexte religieux. Cette peinture n’a pas vocation à vous transporter dans un autre univers. Elle est son propre univers et, en même temps, contient le monde entier.
Ce qui est formidable avec Soulages, c’est qu’il vit chaque tableau comme une aventure. Et, en effet, chaque peinture est une nouvelle expérience, même s’il y a des points communs d’une œuvre à l’autre.
N’y a-t-il pas une tentation des institutions de transformer Soulages en peintre officiel ?
Je ne sais pas très bien ce que c’est qu’un artiste officiel. Si c’est un artiste qui fait les billets de banque et les médailles, ce n’est pas vraiment son histoire. Il a beaucoup exposé en France, mais il a surtout exposé à l’étranger. Il a d’ailleurs été beaucoup plus connu à l’étranger dans les dix premières années qu’en France – notamment aux États-Unis, où il a eu une carrière très impressionnante.
Le Louvre a eu la générosité de répondre à une proposition que Pierre Encrevé et moi-même avons faite : il nous semblait qu’un peintre de cette importance et qui atteint cet âge méritait un salut de la part d’une grande institution comme le Louvre. Son président Jean-Luc Martinez a répondu avec beaucoup d’enthousiasme.
Soulages n’est pas le premier. Braque a reçu la commande d’un plafond au Louvre en 1953 ; Picasso et Chagall, pour leurs 90 ans, y ont eu une exposition. Je crois qu’on n’a jamais qualifié Picasso de peintre officiel, c’est un terme qui lui convenait assez mal !
Notre société n’éprouve-t-elle pas le besoin de se donner un grand peintre ?
Soulages est certainement le peintre français le plus célèbre aujourd’hui. La célébrité, c’est quelque chose qui vous arrive sans que vous l’ayez forcément provoquée. Que la société française ou internationale le considère comme un grand peintre, ce qu’il est, c’est assez logique. Mais ça n’est pas une officialité. Vous demandez : est-ce que la société n’en éprouve pas le besoin ? Eh bien ! tant mieux si la société se raccroche plutôt à des artistes, à des créateurs qu’à d’autres personnages !
Propos recueillis par MAXENCE COLLIN et LAURENT GREILSAMER
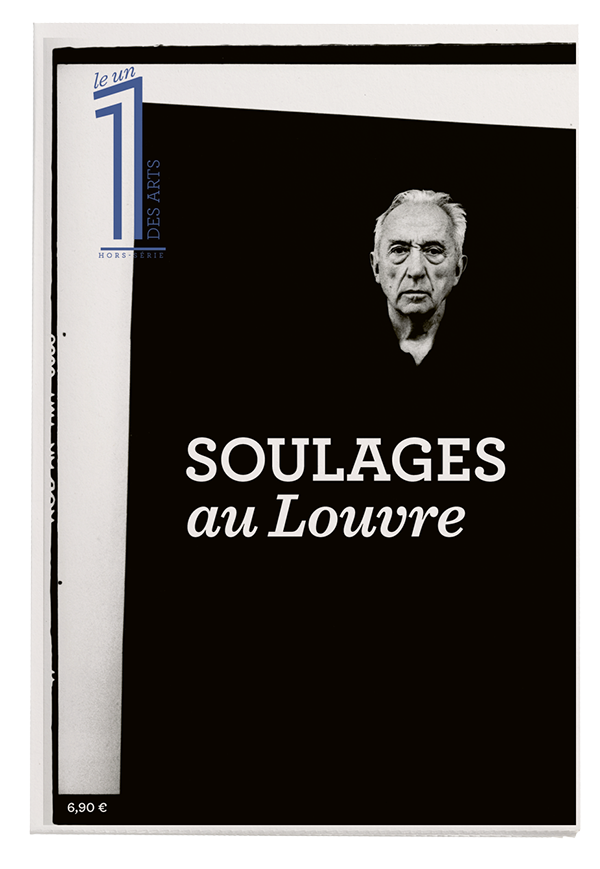
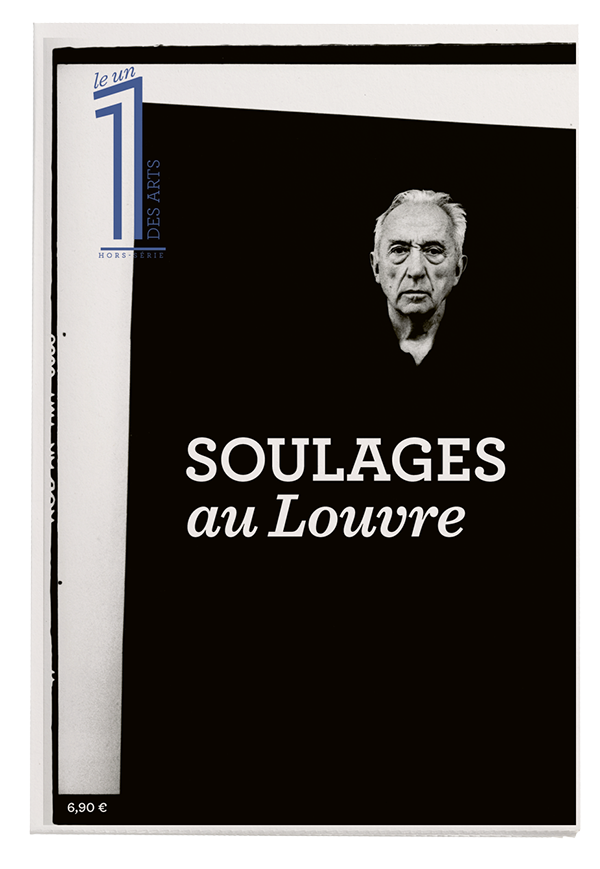
« Cette peinture contient le monde entier »
Alfred Pacquement
Son œuvre est d’une remarquable cohérence, mais on peut incontestablement y déceler des « phases ». La principale rupture se situe en 1979, lorsque commence cette période qu’il a appelée Outrenoir. On peut constater aujourd’hui qu’elle se poursuit.
La morsure de l’acide
Lou Héliot
Même si elle n’en constitue qu’une partie infime, la gravure illumine toute l’œuvre de Soulages. Passion cyclique et creuset d’expérimentation, l’ensemble de ses eaux-fortes, qui sont toutes c…
« Il crée des stèles arc-en-ciel »
Fabienne Verdier
Pierre Soulages a inventé ses outils de peintre. Vous aussi. A-t-il ouvert la voie ?
Il m’a enseigné cela. Il a eu l’audace de quitter les pinceaux traditionnels du peintre et de réinventer l’acte de peindre avec de nouveaux outils. Il s’est intéressé aux outils d’autres tec…







