Les trans ne demandent rien d’inouï
Temps de lecture : 8 minutes
Pour qui s’intéresse à la condition morale des individus aujourd’hui, le vœu de changer de sexe est un témoignage unique des nouveaux embarras qui nous affectent – et qui nous affectent tous, pas juste une poignée de transsexuels, de transgenres et d’intersexués (les rares individus qui naissent avec des caractéristiques biologiques à la fois masculines et féminines).
Ce à quoi nous avons assisté au tournant des années 1990-2000 est en effet stupéfiant : le vœu de changer de sexe, chez un individu biologiquement normal, et qui se déclare absolument sûr que son sexe n’est pas le bon, qu’il ne s’y reconnaît en rien, ce vœu avait longtemps incarné un délire particulièrement pur. C’est désormais un quasi-droit de l’homme. Ce que psychiatres et psychanalystes jugeaient unanimement psychotique (ou pervers), s’est métamorphosé en expression paradigmatique du droit inaliénable à décider de son destin. La Cour européenne de Strasbourg s’est rangée, dans toute une série d’arrêts, à l’idée qu’il fallait accorder aux transsexuels leur changement d’état civil et lutter contre les discriminations dont ils étaient victimes. Au fond, ils ne faisaient que donner une interprétation radicale, certes, mais nullement insensée, des notions de privacy et de self-ownership, soit du droit à être laissé en paix quand on ne nuit pas à autrui, et de la propriété de soi étendue à son propre corps.
Dans la plupart des pays développés, la dépathologisation du vœu de changer de sexe est désormais entrée dans une nouvelle phase. On peut dire sans grand risque que si l’homosexualité a cessé d’être une maladie mentale, le trans-sexualisme, rebaptisé « transsexualité », en prend aussi le chemin.
Or plus ce terme approche, et plus les paradoxes se multiplient, plus les résistances se font farouches. Les médecins se crispent : on ne peut pas changer de sexe sans eux, mais il ne faudrait pas considérer leur intervention comme un traitement, puisqu’il n’y a pas maladie… Ce n’est pas non plus de la chirurgie esthétique, car la souffrance de ceux qui s’adressent à eux est bien réelle, et il y a donc un fondement à ce que l’assurance maladie prenne en charge des soins qui ne sont en rien un luxe. Longtemps, les magistrats en charge des modifications d’état civil, en France et ailleurs, ont traîné des pieds. On s’étripe sur le mariage homosexuel. Mais là, le droit engendre des familles où, par exemple, les enfants ont un père qui devient femme (donc mère ?). D’autres s’interrogent : pourquoi diable obliger les gens à se faire opérer, et donc stériliser, pour « prouver » (étrange preuve !) le bien-fondé de leur demande, qu’elle n’est pas un caprice et qu’ils ne rechangeront pas d’avis ? En Argentine, déjà, plus besoin d’être opéré pour modifier librement la mention de sexe sur ses papiers d’identité.
Or les revendications des intéressés ont elles-mêmes bien changé, en vingt ans. Aujourd’hui, la lutte militante contre les « stéréotypes de genre » est au premier plan : elle implique le refus forcené de se faire dicter par le corps médical, ou par la justice, ce à quoi on devrait ressembler. Les femmes opérées, devenues « hommes de genre », ne se font plus guère construire de pseudopénis, par exemple. Deux ou trois ont même réussi, sans quitter leur identité masculine, à tomber enceints. Les degrés et les formes du malaise, les solutions politiques ou médicales pour y remédier, tout s’est multiplié à l’infini.
Une voix en revanche s’est tue, qu’on entendait encore très fort dans les années 1980-1990 : la voix de ceux qui ne voulaient pour rien au monde de ces ambiguïtés. Opérés, ils revendiquaient l’oubli total. Ils se comportaient en parfaite adéquation avec leur rôle sexuel postopératoire, et ils critiquaient avec violence les « transgenres », coupables de décrédibiliser leur combat, voire de nier le caractère objectif du changement de sexe. Ces hommes et ces femmes (pour qui, au départ, le mot « transsexuel » avait été forgé) existent pourtant toujours. Mais le discours du genre a gagné sur toute la ligne.
Il est tentant de voir dans tout cela des symptômes sociétaux, soit pour en faire le motif d’une insurrection libertaire contre les préjugés sexistes, soit au contraire en cédant à la panique morale face à ce que l’historien du droit Pierre Legendre appelait le « self-service normatif » : l’individu obéissant à la loi qui lui sied. Calmons le jeu. Et si, bien loin d’être une subversion ultime, il n’y avait là rien que de normal ? Déjà, on devrait s’étonner de la facilité avec laquelle les systèmes juridiques et les formes classiques de revendication des libertés ont absorbé ce prétendu coup fatal administré aux fondements symboliques de l’humanité. Tout cela se gère et se négocie fort bien, y compris sur le plan marchand, où le patient est devenu un client (il y a désormais un marché pour les opérations, pour accompagner la transition, etc.). Pourquoi ? Mais parce que les trans ne demandent justement rien d’inouï – ils demandent ce que nous demandons tous : se glisser dans le schéma parfaitement conservateur (dans nos sociétés individualistes) de l’individu qui prend sa vie en main, qui oppose son expertise vécue à la prétention à l’« objectivité » scientifique impersonnelle, et qui refuse les asymétries paternalistes, voire autoritaires (médecin/-malade, savant/profane).
Loin de renverser notre ordre social ou symbolique, tous ces gestes, denses éthiquement comme politiquement, le confortent : ils accomplissent l’idéal le plus ordinaire de l’autonomie individuelle. Or cet idéal n’est pas un idéal qui nous isole ou qui nous sépare ; au contraire, il nous rassemble. Ce n’est pas un ferment d’égoïsme, mais de sympathie, car c’est cela que nous attendons et que nous valorisons chez autrui, dans nos sociétés : l’autonomie. La gesticulation « subversive » des uns prête donc autant à sourire que les « angoisses civilisationnelles » des autres. Car changer de sexe, ou de genre (peu importe), est un non-problème tant qu’on aspire à cette chose qui ne dérange surtout personne dans notre univers moral : devenir soi-même. On devrait même se convaincre que l’individualisme est décidément une forme sociale bien résistante, si elle est capable d’accomoder sans sourciller des trajectoires de vie qui mettent à ce point en cause le sexe et le corps !
Si l’idée est correcte, elle a trois conséquences. Tout d’abord, il se pourrait que la colossale débauche idéologique, à base de gender studies, de féminisme avant-gardiste et d’enthousiasme libertaire, qui donne à la question trans son allure si romantique, ait beaucoup moins d’importance, dans les faits, que de plates questions de droit de la famille et de droit à la santé, décevantes pour tout le monde, c’est vrai, mais plus utiles en pratique.
Ensuite, au lieu de s’étonner de la fragilité des arguments ou de se scandaliser des positions subjectives qu’ils révèlent chez les uns et les autres, on devrait transformer la question trans, toute circonscrite soit-elle, en un observatoire privilégié de ce à quoi mènent les polémiques identitaires en contexte démocratique. Qu’on le veuille ou non, en effet, aucune identité ne pourra plus être unilatéralement imposée aux gens. Encore faudra-t-il qu’ils s’y reconnaissent.
Enfin, et c’est le clinicien qui parle, et qui n’a par définition affaire qu’à des gens qui se plaignent (et bien des gens ne se plaignent pas de changer de sexe), dédramatiser pourrait aider beaucoup de monde à se délivrer du fardeau comme de l’épouvantail d’une cause imaginaire. Sexe, genre, identité, autant de motifs dont les individus peuvent se saisir très personnellement, au lieu d’être saisis par eux et transformés en étendards de positions de principe largement mortifères.
Vue ainsi, la question trans n’est plus un accident périphérique, ni un symptôme de la décadence des temps, ni l’avant-garde esthéticopolitique du futur. C’est une expression parmi bien d’autres d’une inquiétude individualiste commune.


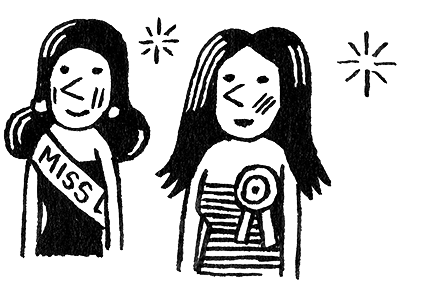
Les trans ne demandent rien d’inouï
Pierre-Henri Castel
Ce à quoi nous avons assisté au tournant des années 1990-2000 est en effet stupéfiant : le vœu de changer de sexe, chez un individu biologiquement normal, et qui se déclare absolument sûr que son sexe n’est pas le bon, qu’il ne s&rsq…
Genre
Éric Fottorino
Les frontières du sexe et du genre ne cessent de bouger. Dans ce domaine, pas de tracé intangible. Plutôt des territoires humains mouvants que le droit s’efforce de fixer. Début avril, la Haute Cour d’Australie a ainsi reconnu l’existence d’un tr…
Devenir MOI
Ollivier Pourriol
– Vous parlez comme un philosophe.
– Oui je suis, ou plutôt j’étais un philosophe qui répondait au nom de Gilles Deleuze. Mais vous dire qui j’étais… Je crois au secret, c’est-à-dire à la puissance …







