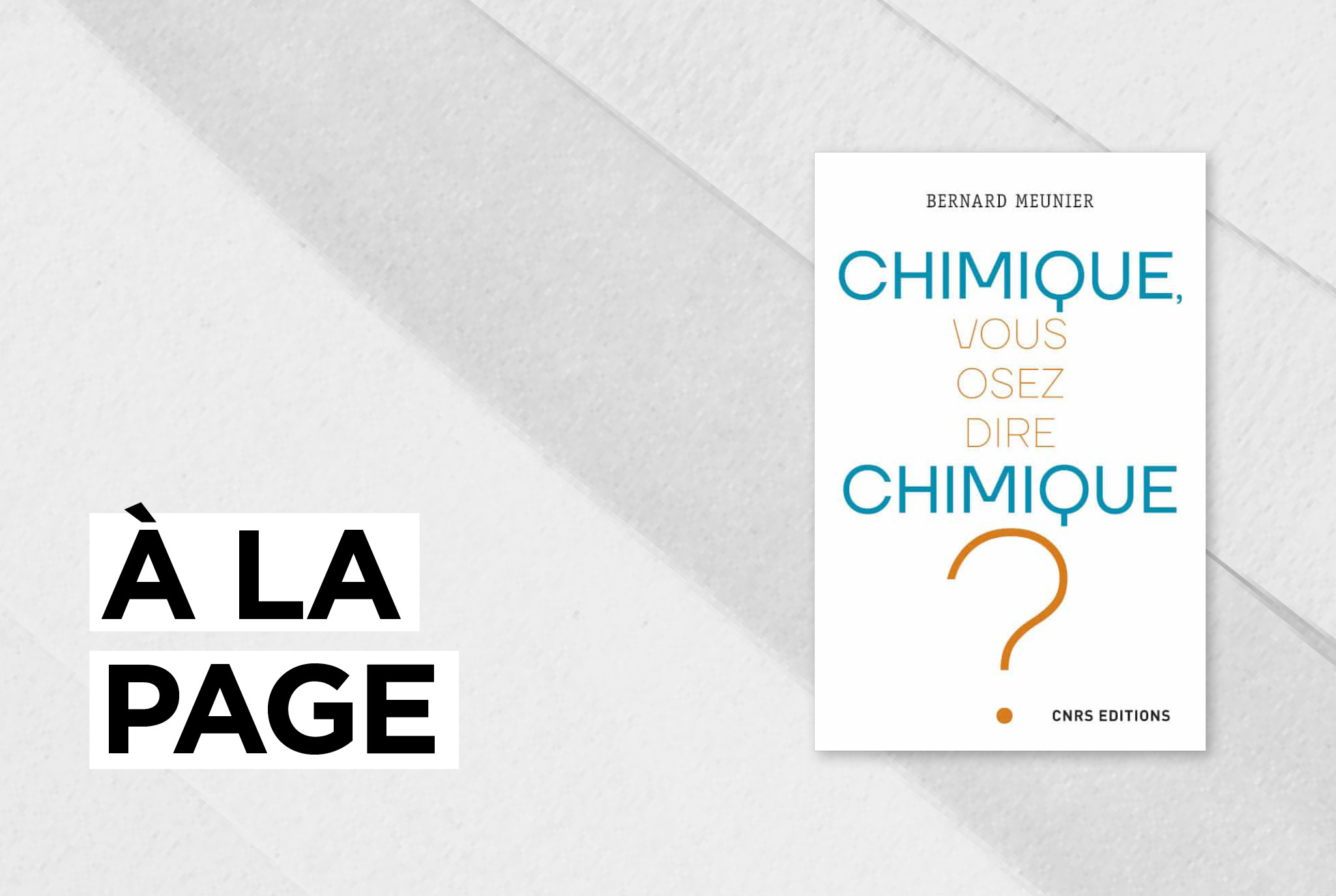À Pointe-Noire, les tribulations d’un trépassé du Frère-Lachaise
[Bonnes feuilles estivales 5/6] Tous les dimanches de cet été, le 1 vous fait découvrir les premières pages de romans de la rentrée littéraire. Aujourd’hui, Le Commerce des Allongés, d’Alain Mabanckou.

C’est depuis sa tombe, au cimetière du Frère-Lachaise de Pointe-Noire, au Congo, que se réveille Liwa Ekimakingaï. Il se découvre habillé d’un drôle d’accoutrement : une veste en crêpe orange, un pantalon à pattes d’éléphants violet et des chaussures vernies rouges. C’était la tenue qu’il s’était choisie pour cette soirée du 15 août où l’on fêtait l’indépendance du pays. Mais que fait-il donc dans ce cercueil ? Liwa parvient à se lever et à remonter le fil des derniers jours de sa vie...
Le Commerce des Allongés, fable politico-sociale d’Alain Mabanckou, est paru le 19 août aux éditions du Seuil. En voici les premières pages.
Nouvelle vie
Tu ne cesses de te le répéter au point d’en être désormais convaincu : une nouvelle vie a débuté pour toi il y a moins d’une heure lorsqu’une secousse a écartelé la terre alentour et que tu as été comme aspiré par un cyclone avant d’être projeté là où tu te retrouves maintenant, au-dessus d’une éminence de terre dominée par une croix en bois toute neuve.
— Je respire ! Je vis ! t’étais-tu à ce moment-là murmuré en signe de victoire.
Mais à présent, alors que la clarté du jour pointe à l’horizon, tu n’es plus du tout habité par cette certitude. Les images qui te hantent sont plutôt celles de tes dernières heures, celles d’un trépassé cloîtré dans un cercueil et conduit en grande pompe dans sa demeure finale, ici, au cimetière du Frère-Lachaise.
Tu ne parviens donc pas à te détourner de ces réminiscences, et revois le long cortège t’accompagner dans les principales artères des quartiers de Pointe-Noire. Cette promenade de cadavre qui précède l’enterrement est une pratique courante dans la ville, la population l’accueille tel un hommage à la mémoire du défunt qui s’en irait avec des images d’allégresse. Tu es ainsi porté par six colosses à la musculature saillante, aux épaules carrées, et vêtus de costumes blancs avec des chaussures vernies noires à bout pointu. Ils exécutent une commande et ne sont pas là pour comprendre les raisons de la disparition de l’individu qu’ils colportent. Ils s’en tiennent à l’itinéraire indiqué par les familles éprouvées, personne n’entendra leur voix tout au long de la procession.
Tu as déjà assisté aux défilés funéraires de ce genre dont certains transitaient par la rue du Joli-Soir où tu as habité avec ta grand-mère jusqu’à ta mort
Calé dans le cercueil, pendant qu’on te balade à travers les ruelles les plus tortueuses, tu anticipes ce qui adviendra au terme de ce périple. Tu as déjà assisté aux défilés funéraires de ce genre dont certains transitaient par la rue du Joli-Soir où tu as habité avec ta grand-mère jusqu’à ta mort. Tu es de ce fait conscient qu’à la fin on te conduira au Frère-Lachaise où tu ne seras plus qu’un disparu parmi des milliers et des milliers d’autres. Si tu as de la chance tu recevras chaque année d’autres visites que celles de ta grand-mère Mâ Lembé. Tu découvriras de jolis bouquets de fleurs au-dessus de ta tombe les jours de la Toussaint, ou de la fête de l’Indépendance, quoique dans ce dernier cas ce serait une sorte d’ironie du sort puisque la cause de ta disparition est liée à la célébration de cet événement national. Puis, une fois que tu auras été enseveli, le temps s’immiscera dans l’affaire, l’oubli recouvrira la détermination de ceux qui te connaissaient, jusqu’à cette période de la saison sèche où tu ne verras plus une seule âme s’aventurer devant ta tombe. Celle-ci sera prisonnière de mauvaises herbes et hantée en permanence par des espèces variées de lézards ou de serpents noirs qui, d’après les légendes de ton ethnie des Babembés, sont des « âmes sans domicile fixe », en un mot des défunts ayant tellement suscité de torts sur terre qu’ils auraient été métamorphosés pour de bon en reptiles de cimetière…
Tu aurais pu te laisser décourager par ces pensées déprimantes. Au contraire tu les chasses d’un revers de main et cherches d’arrache-pied d’autres moyens de te convaincre que tu bénéficies bien de cette nouvelle vie qui te permettra de te rendre dès que possible en ville afin de régler un certain nombre de choses.
Tu décontractes tes jambes, tu étends tes bras en croix dans le dessein de t’émanciper de la posture fœtale que tu avais prise par instinct en guise de protection au moment où tu étais persuadé que les détritus végétaux expectorés par la secousse terrestre et projetés avec furie par le cyclone échouaient de toutes parts sur toi. Tu fais craquer tes doigts les uns après les autres comme si l’éclatement des microbulles dans tes articulations était la confirmation irréfragable de cette existence.
C’est la première fois que tu te mettras debout depuis que tu as surgi de la tombe
Tu souhaites maintenant vérifier que tu es capable de saisir les objets. Tu réussis à mettre la main sur un petit caillou aussi rond qu’une bille. Tu le fais tournoyer entre ton pouce et ton index, tu apprécies la sensation relaxante du toucher avant de l’enfermer dans ta paume et, de toutes tes forces, sans te relever, les dents serrées, les yeux fermés, de le projeter dans le vide.
Il y a d’abord un silence qui te paraît interminable, tu entends par la suite la petite pierre rebondir à plusieurs reprises contre le marbre d’une tombe, à trois ou quatre allées de la tienne. Tu l’avais lancée très haut dans le vide, ce qui en soi était une véritable prouesse.
Un large sourire de contentement détend tes lèvres, tu estimes désormais avoir assez de raisons de ravitailler ton humeur joyeuse et de contrer pour de bon la chaîne de ces images de tristesse qui avait obstrué jusque-là tes pensées.
Revigoré par ton euphorie, tu décides enfin de te lever. C’est la première fois que tu te mettras debout depuis que tu as surgi de la tombe. Tu prends appui sur la croix en bois et réussis cahin-caha à te dresser sans la casser. Tu es indifférent aux grincements des articulations de tes coudes chaque fois que tu ôtes la terre rougeâtre sur tes habits. Tu portes une veste orange en crêpe et à larges revers, une chemise verte fluorescente, nantie d’un grand col à trois boutons et aux poignets mousquetaires arrondis. Le nœud papillon blanc est un peu de travers, tu le rajustes en pensant à ta grand-mère Mâ Lembé qui, les jours d’église, ne supportait pas qu’il penche d’un côté. Tu as le sentiment que tu as reçu de l’eau ici et là, ta chemise est en effet humectée au niveau des aisselles, dans le dos et à la hauteur du bas-ventre. Tu as dû transpirer dans le confinement de ta bière, te dis-tu.
Tu observes à présent d’un air admiratif ton pantalon violet à pattes d’éléphant, également en crêpe, puis ces chaussures Salamander rouges vernissées et pourvues de lacets blancs. Puisque ces pompes risqueraient d’entraver ta mobilité, tu te résous à les enlever et à les balancer de part et d’autre de la tombe, lorgnant avec stupéfaction leurs semelles compensatoires démesurées alors que tu n’es pas du tout déshérité de taille.
Chaque jour les Ponténégrins se ruent sur les ballots de vêtements et les cartons de chaussures provenant de France
Il n’y a pas de doute, te dis-tu, ces chaussures t’ont été recommandées à la hâte par un commerçant dans les environs de ton lieu de travail, le Victory Palace. C’est dans les parages de cet hôtel français, à la hauteur du rond-point Patrice-Lumumba, qu’on tombe sur le Grand-Marché où chaque jour les Ponténégrins se ruent sur les ballots de vêtements et les cartons de chaussures provenant de France, en particulier de Marseille, de Bordeaux ou du Havre. Les jeunes ont d’ailleurs donné un nom à ces friperies : « sola », qui signifie « choisir » en munukutuba. Les habits arrivent au port de Pointe-Noire, compressés, emballés dans du plastique et bien scellés afin de se prémunir contre les vols. Les chaussures sont rangées dans des sacs épais en tissu, également scellés. Les grands commerçants (les Libanais, les Sénégalais ou les Maghrébins) les achètent en gros, les revendent aux petits commerçants (les Ponténégrins) qui, eux, les liquident au détail. Après que les ballots, les sacs ont été ouverts puis démêlés, les chaussures et les habits sont mis en plusieurs tas sur des bâches déployées à même le sol au cœur du marché par les petits commerçants. Les clients les reniflent tels des canidés, les essayent sans se soucier des gens qui les voient se dévêtir en public. Ils mettent leur choix de côté, entre leurs jambes, ne décident de passer à la caisse qu’après avoir obtenu un rabais considérable, surtout s’ils ont détecté un fil qui déborde, un bouton qui manque, une étiquette mal arrachée ou une tache, même la plus microscopique. Peu importe que celle-ci ne soit visible qu’aux yeux de l’acheteur, le client est roi, c’est ce qu’il voit qui compte. Aucun prix n’est taillé sur du marbre, tout est « à débattre ».
C’est une autre odeur qui domine, celle de l’eau de toilette Mananas que l’on répand d’ordinaire sur les cadavres
Si tu sens sur toi l’odeur des sola, qu’ils aient été achetés en ballots ou alors, toujours dans ce Grand- Marché, mais dans la boutique de ton commerçant préféré Abdoulaye Walaye, hypothèse qui te paraît la plus vraisemblable, c’est une autre odeur qui domine, celle de l’eau de toilette Mananas que l’on répand d’ordinaire sur les cadavres et qui se vend dans les échoppes des Libanais. Le Mananas, personne à Pointe-Noire ne s’en aspergerait, autrement ceux qui le croiseraient le prendraient pour un revenant, voire pour quelqu’un qui travaille dans un cimetière ou à la morgue.
Tu ne te rappelles pas pour l’heure à quel moment cette senteur s’est retrouvée sur tes vêtements. Tu as néanmoins le souvenir que tu n’as pas changé cet accoutrement depuis presque cinq jours, ce qui signifie que tu as été enterré avec les mêmes habits…
Monde à l’envers
Tu inspectes avec appréhension les parages.
Le silence et le brouillard matinal qui perdurent atténuent l’exultation qui t’avait gagné jusque-là. En fait, rien ici ne semble avoir été chamboulé ou remué de fond en comble comme tu l’aurais pensé : la terre ne porte aucun stigmate de choc sismique, à se demander si cette secousse que tu as prétendu ressentir il y a maintenant trois heures et ce cyclone qui t’aurait aspiré puis catapulté au-dessus de ta tombe ne seraient pas les fruits avariés d’une imagination dont tu n’aurais plus aucun contrôle.
Par ailleurs, sortir d’ici n’est pas une mince affaire pour toi. Non pas que quelqu’un t’en empêcherait manu militari mais parce que tu sens que quelque chose ne tourne pas rond et qu’il ne suffit pas de se ruer dehors sans mesurer le pour et le contre ou sans avoir entendu les mésaventures de ceux qui t’ont précédé. C’est pour cela que tu es immobile devant ta tombe, les bras le long du corps. En face de toi, à peut-être trois cents mètres, tu aperçois un croisement de plusieurs allées avec une immense fontaine d’eau au milieu. Tu hésitais tout à l’heure sur laquelle de ces allées emprunter. L’une d’elles, la plus large, celle que tu étais tenté de suivre, te paraît infinie, avec pour perspective lointaine une minuscule demeure ronde, ou plutôt une sorte de petite case surplombée d’une croix sur laquelle trône un corbeau géant tandis que d’autres, moins impressionnants, posés sur la toiture, coraillent ou somnolent sur une patte.
Le ciel ? Ne le cherche plus en haut, il est là, en bas
Au-delà de tout, ce qui t’alarme le plus c’est ce dont tu viens de te rendre compte : en réalité tu perçois les choses à l’envers, avec la sensation que tu as la tête en bas, les pieds en haut et que la case lointaine que tu distingues au bout de la grande allée est, elle aussi, renversée. En somme, ce que tu entrevois devant toi est dans ton dos, et ce qui est dans ton dos est devant toi.
Peut-être que c’était ainsi dès le départ, que c’était pour cela que tu avais ressenti le tremblement de terre et le cyclone, mais dans ta gaieté absolue, au lieu de prêter attention, tu as préféré d’abord te persuader que tu étais vivant, que tu pouvais respirer, saisir les objets, projeter un caillou, alors que les repères n’étaient plus les mêmes qu’auparavant.
Ne te frotte pas les yeux, rien n’y changera.
Le ciel ? Ne le cherche plus en haut, il est là, en bas. La terre ? Ne la cherche plus en bas, elle est en haut.
Les multiples allées en face de toi, y compris la plus large qui t’intrigue, deviennent des lignes distordues, mouvantes, voire circulaires et scintillantes. Elles s’entremêlent les unes aux autres, corrompent ta vue, te causent des céphalées et des douleurs abdominales. Ces étourdissements s’accroissent quand tu vois des avions voler en bas et non en haut, te donnant l’illusion que tu pourrais t’écraser sur eux. Par instinct tu te casses en deux à leur passage. Tu sais à présent que si tu souhaites avancer, tu dois reculer ; et si tu souhaites reculer, tu dois avancer. En fait, tu es moins indisposé par ce qui se déroule en haut (c’est-à-dire sous tes pieds), que par le trafic aérien d’en bas (c’est-à-dire sous ta tête). Tu ne t’étonnes plus que tes empreintes sur le sol soient retournées, comme si tes yeux et tes pieds s’étaient querellés et, dans leur désaccord absolu, avaient décidé d’emprunter des chemins différents sans solliciter ton approbation…
Tu t’efforces néanmoins d’avancer, déterminé, avec à l’esprit la sagesse traditionnelle du caméléon
Puisque tu as désormais de la peine à détacher tes pieds du sol, chaque pas te recommande un effort plus qu’herculéen, et dès que tu arrives enfin à l’exécuter, ce pas résonne dans ta tête tel un tremblement de terre qui te replonge dans la secousse terrestre que tu crois avoir vécue quelques heures plus tôt. Tu t’efforces néanmoins d’avancer, déterminé, avec à l’esprit la sagesse traditionnelle du caméléon, celle que tu avais apprise sur les bancs de l’école primaire du quartier Trois-Cents. Monsieur Malonga, votre instituteur, vous racontait la parabole de ce reptile vénéré par les peuples en Afrique. Quand le caméléon prend une direction, il ne tourne pas la tête mais plutôt son œil afin de ne pas s’écarter de son objectif. Quand il bouge vers l’avant, c’est avec prudence : il regarde d’abord en haut, puis en bas dans le dessein de se renseigner avant de se fondre dans le décor.
Tu entends l’instituteur Malonga parler de sa voix grave, saluer cette sagesse des temps anciens, celle que tu souhaiterais aujourd’hui convoquer dans l’espoir de te retrouver dehors.
Tu te le répètes : prendre une direction, ne pas tourner la tête, mais ton œil ; regarder en haut, regarder en bas jusqu’au moment où tu dénicheras cette issue qui te permettra de te retrouver de l’autre côté et de descendre en ville pour en finir avec ce qui t’alourdit le cœur.
Et tu te donnes du courage en te murmurant : « Moi, Liwa Ekimakingaï, je suis un caméléon, un vrai caméléon. Oui, je le suis… »
Hélas, à la différence du caméléon qui, lui, avance, toi tu tournes en rond depuis des heures avec l’idée erronée que tu as beaucoup marché, que tes pieds, engourdis, exploseront bientôt. La distance d’une tombe à l’autre te paraît abyssale. Ta respiration est saccadée alors que tu n’as pas le souvenir d’avoir hâté le pas ou entrepris des foulées. Tu as la gorge sèche, tu donnerais ce que tu as de plus cher, donc ton âme, pour boire de l’eau fraîche que tu devines provenant d’une rivière limpide bordée d’arbres fleuris d’où te parviendrait le ramage le plus mélodieux d’espèces d’oiseaux que tu découvrirais pour la première fois pendant que tu serais assis sur une pierre, contemplant avec émerveillement le courant majestueux de l’onde et les cabrioles des poissons aux écailles les plus flavescentes.
Ce que tu aperçois et dont tu voudrais te rapprocher s’éloigne au rythme de chacun de tes pas, et quand tu penses y être parvenu, le tout se retrouve derrière alors que c’est devant toi. Tu baisses les yeux, tu relèves avec déception que si tu t’es de temps à autre déplacé, ce n’était qu’autour de ta tombe, ou deux ou trois tombes plus loin, mais jamais au-delà, et que ta croix en bois est plantée là, que tu ne portes que des chaussettes, que tes chaussures Salamander sont éparpillées çà et là, que ta veste orange en crêpe à larges revers que tu as tombée traîne à côté, que ta chemise verte fluorescente au grand col à trois boutons et aux poignets mousquetaires arrondis n’est plus humectée au niveau des aisselles, dans le dos et près du bas-ventre grâce au soleil qui s’est levé et qui a vite absorbé cette humidité sans néanmoins venir à bout de ces taches récalcitrantes qu’on prendrait aisément pour les contours de quelques contrées du monde crayonnées par un talentueux cartographe.
Tu as toujours ton pantalon violet à pattes d’éléphant, tu sens une forte odeur de Mananas – mais ici cela ne surprendra personne.
L’angoisse et la prostration que tu avais réussies à juguler au départ te gagnent de nouveau. Tu t’affales sur ta tombe, au même endroit où tu t’étais déjà péniblement mis debout. Tu comprends que tu ne pourras pas brûler les étapes, qu’il y a des éléments qui échappent encore à ta volonté.
Tu entends le bruit des feuilles d’un arbre que secoue la brise. C’est un manguier dont tu n’avais même pas noté jusqu’à présent qu’il était à côté de ta tombe. Tu devrais t’en réjouir car tu es le seul à bénéficier du privilège de reposer au pied d’un arbre fruitier. L’air que celui-ci dispense grâce à la connivence de ses feuilles avec le vent te procure un calme, comme si des forces invisibles te berçaient et te consolaient.
Te voilà accoutumé à cette agréable indolence, et tu tombes peu à peu dans un profond sommeil, sans te rendre compte que tu es entré dans le rêve le plus long de ta mort…
Le Commerce des Allongés, Alain Mabanckou, Seuil, 19 août 2022, 304 pages, 19,50 €
Bio express
Né au Congo en 1966, Alain Mabanckou arrive en France à l’âge de 22 ans pour poursuivre ses études de droit à Nantes, puis à Paris. Romancier, poète et essayiste, il est également professeur de littérature francophone à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). On lui doit une trentaine de livres, dont Lumières de Pointe-Noire (rééd. Points, 2018), Le Sanglot de l’homme noir (id., 2017) ou encore Mémoires de porc-épic (id., 2017), qui lui a valu le prix Renaudot en 2006. Son dernier roman, Le Commerce des Allongés, est paru le 19 août 2022 aux éditions du Seuil.