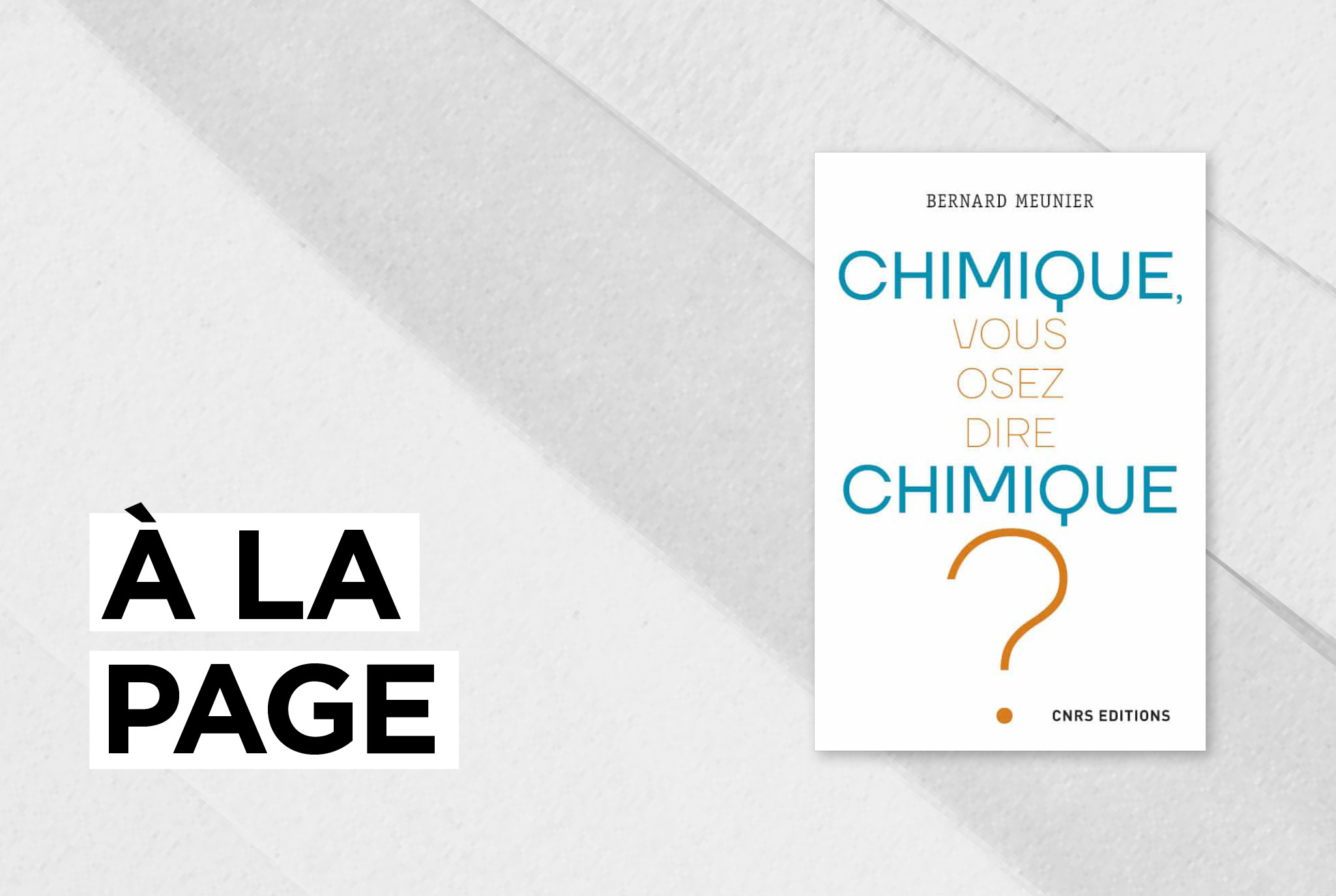« La sensation du couteau » : histoire d'une enfance trouble
[Bonnes feuilles estivales 1/6] Tous les dimanches de cet été, le 1 vous fait découvrir les premières pages de romans à paraître à la rentrée littéraire. Aujourd'hui, Vers la violence, de Blandine Rinkel (Fayard).

Ces auteurs signent régulièrement des textes dans le 1 : nous vous proposons de découvrir comment débutent leurs romans à paraître à la rentrée littéraire. Aujourd'hui, Vers la violence, de Blandine Rinkel (Fayard, 17 août), retrace l'histoire d’une enfance trouble, dans ces paysages de l’ouest français où la mer et la forêt se confondent.
***
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, le loup avait tout à fait disparu de France. À partir de 1937, on n’en trouvait plus un seul dans le pays.
« En tant qu’espèce à population reproductrice identifiée, le loup est désormais éradiqué du territoire », affirmait l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Pourtant, une semaine après Noël, en 1954, un animal mettait en émoi tout le Bas-Dauphiné. Entre Bourgoin et Morestel, on commençait à retrouver des chiens à demi dévorés. Les jours passèrent, les ravages se répétèrent et les traces s’accumulèrent. Le loup de Sermérieu était de retour.
D’où venait-il ? Comment avait-il fait pour survivre aux brûleurs de loups, tels qu’on appelait alors les habitants du Vasselin pour saluer les fosses qu’ils creusaient afin de piéger les loups, ensuite brûlés vifs dans une terre qui les voyait agoniser ? Et comment survivait-il, désormais, seul ?
En dépit des idées reçues, les loups solitaires sont rares. S’ils existent, c’est d’avoir été chassés de la meute après un conflit dont ils sont sortis affaiblis, blessés, sanglants. S’ils existent, c’est d’être prêts à affronter la fin. Ou bien, c’est d’être demeurés inconsolables après avoir perdu une compagne ou des louveteaux. De s’être isolés, volontairement, au risque de la vulnérabilité. Le loup de Sermérieu s’était-il ainsi mis en danger ? Chassé des Carpates par un hiver rigoureux, avait-il, comme on le croit, trouvé dans la région de la Drôme un ultime refuge, se nourrissant, dans la forêt, de gibier trouvé au hasard ?
Le 12 janvier 1954, quarante chasseurs s’élancèrent pour sept heures de battue
Dix-huit ans après la disparition supposée de Canis lupus, en tout cas, la neige fut tachée de sang. Et bientôt, en réaction, la traque du nouveau loup de Sermérieu orchestrée.
Le 12 janvier 1954, quarante chasseurs s’élancèrent pour sept heures de battue et finirent par abattre la bête au bas de la côte du Turc, à Vignieu – où sa dépouille est toujours exposée en mairie aujourd’hui.
Le 12 janvier 1954, le premier loup d’après-guerre entrait dans la légende.
Le même jour, Gérard naissait.
I. La sensation du couteau (2000)
« Ce qu’il y a de terrible, sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons. »
Jean Renoir, La Règle du jeu
1
Il me tient par le menton et j’ai peur de mourir.
Gérard a posé son pouce sur ma mandibule, son index et la tranche de son majeur dans le creux de ma gorge. Il tient mon os avec trois doigts robustes quand, en retour, j’ai apposé ma main contre sa mâchoire carrée, la serrant de toutes mes forces pour qu’elle ne m’échappe jamais. Dans un western familial improvisé, nous nous tenons face à face, assis à la table de la cuisine, à explorer le noir commun de nos yeux.
Et si nos regards se sourient, le bas de notre visage, lui, ne cille pas.
Au fond du regard de cet homme, je décèle de la tendresse, mais, d’instinct, je sais que celle-ci ne protège de rien
Nous venons de manger ensemble, tu me tiens, je te tiens, nous avons chanté la chanson et le premier de nous deux qui rira sait à quoi s’attendre. La dernière phrase de la comptine, pourtant, me fait frémir. C’est que, de Gérard, je n’imagine pas la possibilité de tapettes, mais seulement de tapes, viriles et vraies, de celles que je l’ai vu administrer à Ardent, notre chien, et l’idée qu’il puisse m’en mettre une me glace et me défie. Au fond du regard de cet homme, je décèle de la tendresse, mais, d’instinct, je sais que celle-ci ne protège de rien. Il me faut donc apprendre le sérieux : respecter les règles est ma seule chance de l’emporter, alors je me concentre du plus fort que je peux ; sous la table, je contracte mon petit poing resté libre, et malgré les grimaces irrésistibles de mon père, malgré l’humour dans ses yeux et ses parades de déconcentration, oui, malgré ses efforts pour m’amadouer, la peur m’apprend à ne pas flancher.
Plus tard, je saurai du jeu de la barbichette qu’il est une variante du pince-sans-rire, consistant à l’origine, pour un joueur, à subir des pincements sur tout le visage par des doigts enduits de cendre – la dérive d’un jeu d’humiliation. Plus tard, je ne craindrai pas qu’on m’abaisse et j’excellerai à toutes les activités reposant sur un impératif de concentration. Plus tard, on dira de moi que je suis une terrible pince-sans-rire, une joueuse de poker spartiate et une infatigable travailleuse. Adulte, je tirerai de ces jeux d’enfant ma fièvre et mon parti, mais pour le moment, le premier de nous deux aura une tapette, alors j’essaye de ne pas être celle qui rira : je fixe Gérard avec toute l’intensité dont une fillette de 6 ans est capable et, en secret oui en un terrible secret, je souhaite sa perte.
2
Petite, j’étais amoureuse de mon père ; insister sur cette phrase, lui redonner lumière et gravité. Dès 4 ou 5 ans, je voulais épouser Gérard, persuadée qu’il irait bien mieux avec moi qu’avec Annie, ma mère, qu’instinctivement je trouvais mal assortie à lui, petite et peureuse quand il était grand et vaillant. Ce mariage, Gérard m’avait promis que nous pourrions le célébrer quand j’aurais l’âge légal. Notre différence de trente-huit ans n’était pas plus un obstacle que notre lien filial. À l’entendre, il n’y aurait aucun problème. Je peux aujourd’hui en rendre compte : Gérard, mûr et expérimenté dans la vie d’homme et de père, était tout à fait favorable à ma demande. Sans ambiguïté, il m’avait dit oui. Il m’avait promis. Mais quand nous serions adultes tous les deux, seulement à ce moment-là. À ça il tenait : seuls les adultes consentants peuvent s’épouser. C’est donc en toute chasteté que nous vivions sous le même toit (et sous le regard de ma mère, que cela faisait rire), dans l’attente de notre union à venir. Un jour, nous partirions ensemble, nous nous émanciperions du foyer et irions conquérir le monde.
Gérard, de son côté, avait commencé à explorer. Il m’avait dit je prends de l’avance : tu me rejoindras dès que tu le pourras. Il partait en éclaireur, pour notre vie d’après.
Avec lui, les plus beaux de mes souvenirs sont bleus
De fait, il était policier en Vendée huit mois par an et formateur dans les DOM-TOM les quatre autres. C’était un père absent, qui multipliait les voyages et les rencontres pour notre vie future. Deux mois en Guadeloupe quand j’avais 3 ans, un mois en Guyane l’année suivante, puis des semaines à Mayotte, à Saint-Martin, en Polynésie française. Cela variait, tournait, il faisait des boucles, repassant aux mêmes endroits. Durant chacune de ses escapades, mon amour pour lui avait le temps de se préciser et de se cristalliser. À partir des bribes d’informations que me donnait ma mère sur son métier et des mensonges magnifiques qu’il me rapportait, j’imaginais sa vie. Une vie faite de dangers, de courses-poursuites infernales, de repas hilares au soleil couchant, d’alcools orange fluorescent et de rendez-vous avec tous les plus grands de ce monde. Pendant ses absences, je l’attendais en fantasmant ses exploits.
Avec lui, les plus beaux de mes souvenirs sont bleus.
C’était la tasse brûlante, la tartine chaude et coulante de beurre qui réconforte après la natation, les yeux rougis par le chlore en hiver, les cheveux qui, littéralement, gelaient au sortir de la piscine, si bien que, passant sa main sur sa tête, on pouvait récupérer un petit copeau d’eau glacée. L’été, c’étaient les combats que nous menions contre les vagues les plus athlétiques et inquiétantes de la côte, ces vagues qui d’ailleurs n’en étaient pas, qui étaient plutôt des projectiles envoyés par Amphitrite, déesse des océans, et par ses sbires, les poissons-loups.
– Tu sais que nous sommes sur écoute, ici ? demandait Gérard chaque fois que nous nous retrouvions seuls dans l’eau, la nuque tout juste mouillée pour éviter l’hydrocution.
– Oui, je sais, il faut faire attention, répondais-je, grave.
– Attention à ce que tu pourrais dire contre l’océan. Pourquoi déjà ?
– … tout ce que je dirai pourra être retenu contre moi.
– Exactement. Tu ne parles qu’en présence de ton avocat.
Et Gérard, alors plus enfant que moi, souriait. Il avait le sourire carnassier : non seulement, au détour d’une blague, découvrait-il l’étendue de ses trente-deux dents, mais toute l’étendue de ses gencives rougies, toute la circonférence de sa mâchoire y passait. Il avait le sourire d’un cheval sauvage. Une bonhomie communicative, que j’adorais retrouver.
Agité, l’océan Atlantique qui bordait notre commune était surtout sale. On y trouvait des mégots de cigarettes, des emballages plastique de gâteaux divers – parfois même une seringue. Comment une ville par ailleurs si peu habitée pouvait-elle sécréter tant de déchets ? La crasse tenait aux yeux de mes parents du miracle, c’est pas possible, les gens se donnent rendez-vous pour saloper la plage ou quoi ? Quand il était triste, Gérard se désolait de cette saleté avec un râle dans la voix qu’il n’avait pas d’ordinaire, gueulant contre les connards qui se croyaient tout permis, arguant que personne ne pourrait jamais nettoyer la mer. L’état des côtes le déprimait, mais, finissait-il, tant qu’on arrivait encore à capter les missives du monde marin, c’est que tout n’était pas perdu.
– Attention, soldat, je viens de recevoir un mot d’Amphitrite ! me disait-il dans l’eau, tenant dans sa main une algue attrapée à la surface.
– Qu’est-ce que ça dit, qu’est-ce que ça dit ? demandais-je, trépignant.
– Ça dit que… C’est difficile à lire, je ne sais pas si je vais y arriver…
Gérard plissait les yeux, le regard tout à l’étude du spécimen marin et marron, une grosse algue faite de centaines de branches ramifiées, pareille à un albizzia miniature, un arbre aplati et mou.
– Je crois que ce n’est pas un message d’Amphitrite, nuançait mon père.
– Mais de qui alors ?
Et, impatiente, je tapotais la surface de l’eau de ma main, créant des clapotis nerveux.
– C’est un message anonyme pour nous prévenir qu’Amphitrite nous envoie plusieurs projectiles dessus, apparemment elle est très bien armée aujourd’hui, il va falloir retenir sa respiration… Tu es prêt, soldat ?
Solennelle, je faisais signe que oui.
– Attention, ÇA ARRIVE ! criait soudain Gérard, son corps à moitié dans l’eau, torse bombé vers l’horizon.
Nous, les résistants, les vaillants et les aventureux : nous, la fille et son père
Il désignait alors du doigt la vague immense qui se ruait sur nous comme un cheval piqué par une abeille et, avant qu’elle ne nous engloutisse, il avait le temps de compter. « 3, 2, 1… ON Y VA ! » Nous plongions dans l’eau à la verticale, tête la première, le pouce et l’index pinçant le nez pour éviter de boire la tasse, les paupières contractées, tous les muscles tendus, concentrés, pour que rien de cet ennemi envoyé par la déesse ne puisse pénétrer en nous. Nous, les résistants, les vaillants et les aventureux : nous, la fille et son père.
Parfois, je ressortais des vagues la tête flageolante, mes doigts avaient cédé à la pression, j’avais pris de l’eau dans les narines et c’est comme si elle inondait mon esprit, mais je me gardais bien de le signaler au lieutenant. Il fallait maintenir l’allure.
– Tout va bien moussaillon ?
– 5/5 ! répondais-je, dessinant un O en arrondissant tous les doigts de ma main contre la phalange de mon pouce, comme me l’avait appris mon père (« Sous l’eau, si tu fais un pouce en l’air, on croira que tu veux remonter, pas que ça va, tu comprends ? »).
– Prêt à partir en guerre contre Amphitrite ?
– Plus que jamais.
– Tu continueras quand je ne serai plus là hein, moussaillon ? C’est la guerre d’une vie !
– Je continuerai toujours, assurais-je, et nous nous engagions dans un concours de brasse coulée visant à prendre d’assaut la bouée jaune qui, au loin, marquait le début du territoire de l’épouse de Poséidon.
Parfois les courants, trop forts, finissaient par nous décourager et Gérard admettait que la mère des phoques et des dauphins avait gagné une bataille (« mais pas la guerre ! »). D’autres fois, nous atteignions notre objectif et mon père, dont les muscles étaient plus aguerris que ceux de sa fille, touchait la pyramide fluorescente en premier, puis m’attendait, la main sur son trophée – un trophée assailli de tous bords par des algues verdâtres, des coquillages, des balanes et des milliers de bactéries aquatiques, mais tout de même un trophée, une capture importante, essentielle même : la balise du territoire des dieux.
– Tu sais ce qui va arriver, si on s’avance encore dans leur empire ? demandait le père.
– Il va y avoir les sirènes ? tentais-je, me souvenant de la leçon.
– Non seulement il va y avoir les sirènes, mais il y aura peut-être même les dauphins. Tu sais qu’Amphitrite, fille de Nérée, est la déesse des monstres marins…
– Alors il y aura aussi les monstres !
Et j’agrippais alors mes deux bras à la bouée jaune pour reprendre ma respiration.
– C’est le problème. Il y aura les dauphins, mais il y aura aussi les monstres, et je ne sais pas si tu es capable d’affronter les monstres… L’expression de Gérard était alors teintée de rires et de regrets – et je me désolais d’être encore trop jeune pour assurer à mon père combien j’étais capable d’affronter les créatures des abysses et d’ailleurs. À quoi pouvaient-elles bien ressembler ? Je me figurais des hippocampes à dents de hyène, des méduses acides et des crabes gigantesques, des créatures carnivores que, dans mon for intérieur, je ne me sentais pas tout à fait de combattre là, à moitié étourdie par toute la natation qu’il avait fallu enchaîner pour parvenir à l’entrée du territoire des dieux.
Des mondes imaginaires comme celui-ci, mon père et moi en partagions une dizaine
De fait, nous ne les affrontions jamais. Après avoir repris notre souffle auprès du plastique jaune, nous regagnions la côte, nous promettant que la prochaine fois – il y aurait, c’était sûr, toujours une prochaine fois – nous irions explorer le monde au-delà des balises.
Des mondes imaginaires comme celui-ci, mon père et moi en partagions une dizaine. Dans le tiroir de la cuisine, une collection de vignettes de bière faisait de nous des cavistes du dimanche, détenteurs d’un coin bouchonnerie où troquer le meilleur liège de la région, quand un morceau de tapisserie arraché dans le salon, semblable à un visage de femme, avait fait émerger le personnage d’Anne Franche, vétérinaire sévère mais juste dont Gérard me comptait régulièrement les déboires professionnels. Il y avait aussi Pluie, un cheval méphistophélique que je n’avais jamais vu, mais dont mon père me racontait qu’il par courait les rues la nuit, avalait les pigeons et attaquait des chiens, un cheval que Gérard rendait responsable, au petit matin, des poubelles renversées et des arbres déracinés. Cette prolifération de légendes exaltait notre vie.
Mais il y avait autre chose : avec toutes ces histoires, discrètement, s’était mis en place ce qu’on pourrait décrire comme un pacte d’imaginaires. Gérard et moi nous étions associés dans diverses missions invisibles et infinies, infinies parce qu’invisibles, et à partir de ce duo dans l’action, comme deux espions développent une complicité tenace à prendre des risques ensemble, une indestructible alliance s’était tissée. Il y avait désormais entre nous ce lien de la mer, qui maintient l’union des cœurs pendant les longues périodes de séparation.
À force de prendre part aux histoires de Gérard, je m’étais secrètement engagée à les protéger toute ma vie. Membre d’une DGSI minuscule, je défendrais pour toujours les intérêts du gouvernement. C’était une de ces loyautés tacites, les plus solides, qui naissent pendant l’enfance et dont on ne se défait jamais tout à fait.
Une loyauté qui peut expliquer qu’aujourd’hui encore, en dépit de tout ce que je sais et de tout ce que j’ignore sur lui, je suis incapable d’en vouloir à mon père.
Vers la violence, Blandine Rinkel, Fayard, à paraître le 17 août 2022, 378 pages, 20 euros