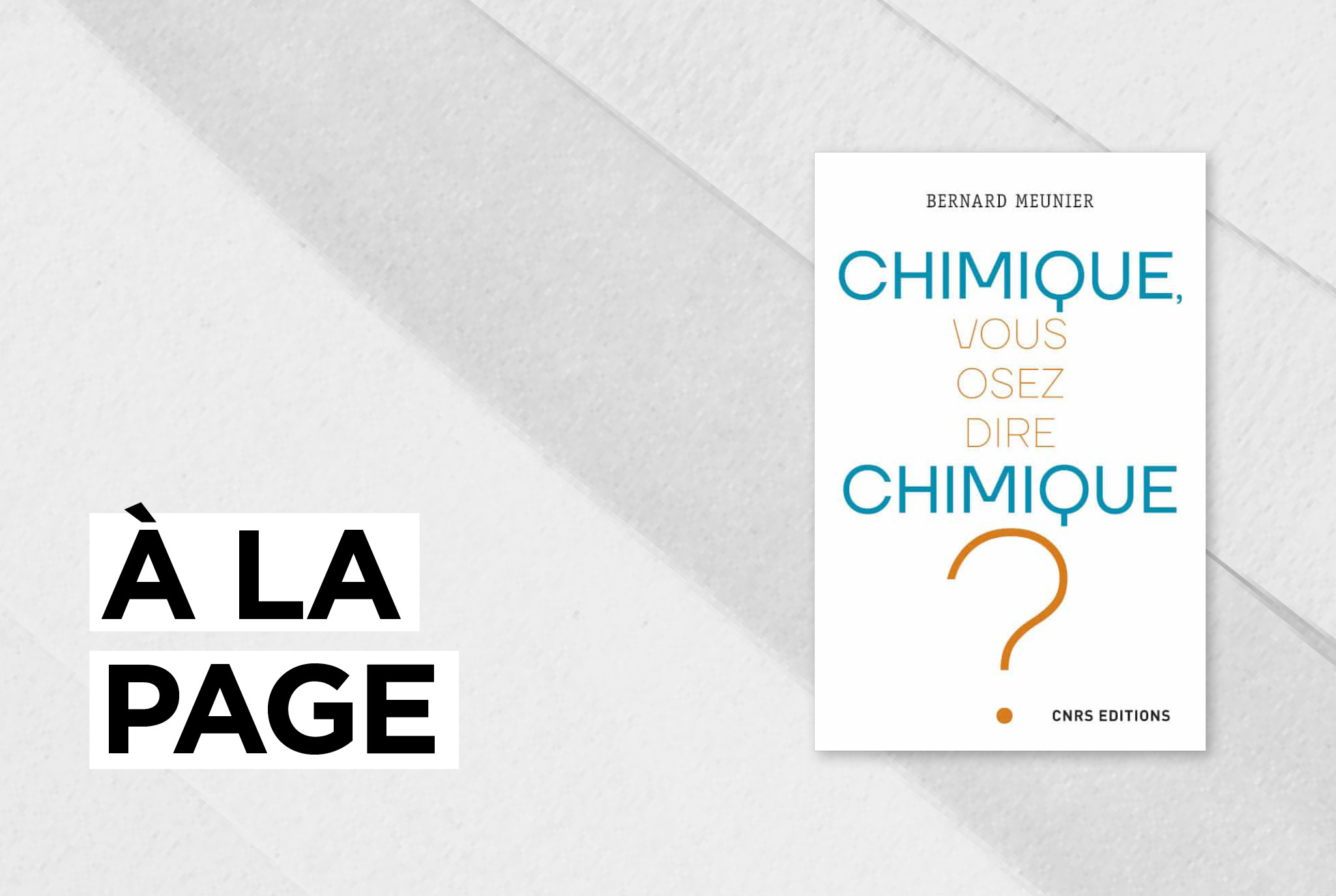« C’est la zone ! » : à l’origine de l’expression, une histoire méconnue
Au XIXe siècle, la Zone renvoyait à un territoire entourant les fortifications de Paris. C’est l’objet de l’essai Les Sauvages de la civilisation de Jérôme Beauchez (éditions Amsterdam) dont le 1 publie les bonnes feuilles, avec leurs illustrations.

On le dit d’un endroit laissant à désirer : « C’est la zone ! » Mais avant d’être utilisé dans cette expression, ce mot renvoyait à un lieu bien spécifique. Ainsi, la Zone (avec une majuscule) a d’abord été le nom d’un territoire ceinturant les fortifications de Paris, une bande de terre initialement réservée aux manœuvres militaires et non constructible. Y survivait une population marginalisée, exclue du centre bourgeois comme de la banlieue ouvrière. La Zone a vivoté pendant plus d’un siècle, entre le milieu du XIXe et celui du XXe, avant d’être démantelée puis de laisser place au périphérique que l’on connaît aujourd’hui.
Sociologue et anthropologue, professeur à l’université de Strasbourg, Jérôme Beauchez analyse dans Les Sauvages de la civilisation. Regard sur la Zone, d’hier à aujourd’hui (éditions Amsterdam, paru le 3 juin) les représentations collectives de ce peuple des marges. Il étudie aussi la violence qu’on leur prête, souvent pour mieux cacher celle qu’on leur fait. Extrait de l’introduction.
Aux origines d’un monde liminaire
« Il ne suffit pas de savoir comment sont les choses, encore faut-il savoir comment elles sont venues à être ce qu’elles sont. »
Franz Boas, « The Methods of Ethnology »
Si la Zone a fait de moi un chercheur – d’abord de mes limites, puis d’autre chose –, j’ai écrit ces pages à son image : dans les chemins de traverse d’une indiscipline qui est à la fois une manière de vivre et une façon de penser. Elle m’a été apprise dans la rue, pendant quelques années de formation aux usages de ce monde liminaire dont j’écris le nom avec une majuscule. Parce que la Zone – celle que je n’ai pas connue – a d’abord été le toponyme d’un territoire annulaire ceinturant les fortifications de Paris. Peu après leur érection au cours de la décennie 1840, La Zone a pris forme telle une fille illégitime de cette enceinte dont elle a usurpé (on dirait aujourd’hui « squatté ») une bande de terre initialement réservée aux manœuvres militaires (fig. 1).
Figure 1. Carte des fortifications de Paris (1841)
N. B. : La zone non aedificandi apparaît sur le bord extérieur des fortifications. Gilbert Andriveau-Goujon, éditeur de cartes et d’atlas. Bibliothèque nationale de France.
Dans les interstices de Paris
Au fur et à mesure des installations illégales, cette zone d’abord déclarée non constructible (non aedificandi) par les autorités est devenue « la Zone » tout court – une absolutisation par le langage populaire intervenue comme un effet de sa notoriété crapuleuse, déjà bien assise dans les années 1890 (1). Au même moment, le vocable « zonier » est couramment employé pour désigner ses habitants. En 1907, un certain docteur Courget trace leur portrait dans les Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris. Il note : « Nous avons décrit autrefois les huttes habitées des environs de Paris ; ces ramassis de cabanes, de voitures de nomades usées, de wagons déclassés […] habités par des chiffonniers, des mendiants, des indigents, des miséreux. […] Ce sont ni plus ni moins, pour la plupart, que les locataires du ministre de la Guerre. Ils habitent la zone militaire […], une curiosité mais aussi une honte de Paris » (2) (fig. 2 et 3).
Figure 2. Zoniers d’Ivry, deux enfants près de roulottes (1913). Photographie de l’agence Rol. Bibliothèque nationale de France.
Plus qu’un terrain vague, le territoire interlope de la Zone a longtemps été parsemé de bars clandestins et de toutes sortes de cahutes que l’on disait volontiers « lépreuses ». Si bien que cet inframonde parisien, fruit amer d’une modernité qui aurait déposé là toutes ses misères, passait pour une sorte de capitale des « classes dangereuses ». Dans le regard de ceux qui les ont nommées ainsi, savants ou politiques issus de la bourgeoisie, pauvreté et criminalité y partageaient la même couche. De telle sorte qu’elles y auraient enfanté des générations de « sauvages de la civilisation ».
L’expression est plus ancienne que la description des zoniers par le docteur Courget. Ainsi la trouve-t-on sous la plume d’Alfred Delvau (3). Écrivain et journaliste républicain, il a pris part à la révolution de 1848. Son idée d’une sauvagerie tapie dans l’ombre de la modernité s’est formée au cours de la décennie suivante. C’est alors que Delvau décrit les « dessous de Paris », dont participe l’underground déposé en contrebas de la grande urbs qui se concevait comme un phare de la civilisation. Delvau a lui-même écrit que « Paris n’est pas une ville, c’est la ville par excellence, – comme autrefois Athènes et Rome. » (4) Par-delà les éboulis d’une révolution manquée, ce phare en cours de rénovation brillait de tout le clinquant d’une promesse : celle que réaliseraient bientôt les grands travaux destinés à projeter le nouvel éclat de la capitale française sur une modernité qu’elle se devait d’incarner. Une vaste entreprise que le baron Haussmann a dirigée pendant près de vingt ans (1853-1870). Immortalisée par son photographe officiel, Charles Marville, cette démolition-reconstruction s’efforce d’inscrire dans l’architecture des immeubles et l’ouverture des grandes avenues le pouvoir d’un empire français dont la Babylone moderne comptait aussi ses oubliés, ou ses condamnés, à la marge du « progrès ».
Figure 3. Zone à Issy (vue d’ensemble) (1913). Photographie de l’agence Rol. Bibliothèque nationale de France.
C’est à ces « sauvages de Paris » qu’Alfred Delvau a dédié quelques pensées ; non peut-être sans une dose de compassion, mais diluée dans beaucoup de cynisme postrévolutionnaire. Intellectuel désargenté, issu du peuple et participant de la haute bohème des lettrés (il était un ami proche d’Auguste Poulet-Malassis, l’éditeur de Charles Baudelaire), Delvau s’est constitué en descripteur de ces altérités plébéiennes : celles d’une basse bohème composée de celles ou ceux – truands, mendiants, voleuses et prostituées – qu’aucune cause à part la leur ne pouvait rallier. S’il paraissait donc irrécupérable, ce peuple des « bas-fonds » semblait aussi ingouvernable que rétif à toute forme d’autorité ou de vie un tant soit peu instituée par autre chose que les codes de leur monde, a priori étranger à celui de la majorité des « civilisés » (fig. 4).
Figure 4. La Rue de la Vieille-Lanterne (1860). Leopold Flameng, eau-forte parue dans Paris qui s’en va et Paris qui vient (publication artistique dessinée et gravée par Léopold Flameng ; texte par Arsène Houssaye, Théophile Gautier, Paul de Saint-Victor, Henri Murger, Champfleury, Charles Monselet, et al.), vol. 1, no 3, janvier 1860, p. 1-4. Bibliothèque nationale de France.
Dans les tableaux qu’en brosse l’écrivain, cette étrangeté est doublement mise en scène. Car ces « autres » sont assimilés aux sauvages d’un lointain situé tout à la fois dans l’espace et dans le temps. Tantôt « Peaux-Rouges du Paris moderne » dont les « wigwams » s’accumulent dans les interstices de la capitale, ils apparaissent aussi à leur chroniqueur comme une survivance de la gueuserie médiévale : celle des Coquillards (des bandits de grand chemin) célébrés par François Villon, comme celle de la Cour des miracles telle que Victor Hugo a pu la romancer (5). Quoi qu’il en soit de leurs provenances, toutes les incarnations de cette engeance s’accrochent aux ruelles comme autant de « scories de la grande capitale en ébullition de progrès ». Aussi sont-elles rassemblées par Delvau au sein d’une même « race prolifique et tenace », sur laquelle notre civilisation et sa bourgeoisie n’auraient aucune prise. Il en veut pour preuve que rien n’en est jamais venu à bout : « ni le canon, ni la peste, ni la famine, ni la misère, ni la débauche, – ni l’école mutuelle… » Quant à leurs véritables origines, ces gens-là ne se soucieraient pas de les connaître, en tout cas « pas plus que les petits des vipères, qui ne connaissent ni leur père ni leur mère, – les premiers étant tués par les secondes dans l’accomplissement de leurs devoirs maternels » (6). En plus de l’absence de toute reconnaissance – pas même celle du ventre –, on rajoute ainsi une couche d’animalisation reptilienne et, par-là, de vilénie à tous les ensauvagements qui précédaient.
La Zone « a subsisté aux portes de Paris pendant plus d’un siècle, à cheval entre le milieu du XIXe et celui du XXe »
Si elle trouve son lieu de prédilection autour de la place Maubert, qui a longtemps subsisté comme une enclave de pauvreté au cœur de la capitale, cette disqualification descriptive du « bas peuple » parisien a été maintes fois reproduite dans des termes très approchants lorsqu’il s’est agi de dépeindre les visages comme le quotidien de la Zone. Celle-ci a subsisté aux portes de Paris pendant plus d’un siècle, à cheval entre le milieu du XIXe et celui du XXe, avant que son démantèlement ne l’efface comme une « tache de graisse » (l’expression est de Jean-Paul Clébert, fin connaisseur de la place Maubert) (7) dont les dernières auréoles ont été bitumées. Après ceux de la décennie 1850, d’autres grands travaux ont réalisé ce recouvrement. Entamés dans les années 1950, ils ont tracé l’autoroute du périphérique urbain en lieu et place de la Zone. À sa manière, elle a tout de même résisté à cet effacement par les non-lieux d’une modernité qui s’est accélérée ; l’antre des refus de la norme se voyant ainsi reconverti en espace normalisé par la circulation automobile (8).
C’est à compter de ce moment que, dans le langage courant, la Zone s’est elle aussi mobilisée, ou déplacée et reconstituée autour d’une signification aussi nouvelle que dérivée de l’ancienne. Au cours des années 1970, ses usages populaires ont achevé de la redéfinir en nom des marges, répandu bien au-delà de ses premières localisations parisiennes. Tandis que c’en était fini du territoire annulaire des zoniers, les « zonards » sont apparus comme une nouvelle manière de désigner celles ou ceux qui portent les stigmates d’une Zone désormais dématérialisée. Hors-lieu des transgressions et des atmosphères louches, au tournant de la décennie 1980 elle a également désigné ces espaces d’abandon dénués d’aménités qui – en banlieue ou ailleurs – paraissent sans couleur, comme emmurés dans la grisaille d’un béton plus décati d’année en année.
La Zone comme mot de passe
C’est à l’entrecroisement de toutes ces significations que ces pages ont été écrites. Elles constituent autant de feuillets d’une stratification marginale au cœur de laquelle la Zone apparaît comme un mot de passe dans l’étendue des expériences et l’épaisseur du temps. J’ai inscrit son étude dans une durée qui va d’une fin de siècle à l’autre, ou de la décennie 1880 aux années 1980. Il s’agit de repères bien plus que de bornes temporelles au sens strict. Quelquefois, le propos passe en deçà ou au-delà, selon les besoins de l’explication ; remontant aux origines des « classes dangereuses » (l’expression date du premier XIXe siècle), le troisième chapitre en donne une excellente illustration. Reste que l’essentiel du livre se concentre sur ces cent ans d’histoires au cours desquels la mauvaise réputation de la Zone s’est d’abord inscrite dans le sol et la culture populaire de Paris, avant de s’en effacer progressivement pour mieux s’étendre à de nouveaux usages qui ont à la fois réinvesti et redéfini son nom, passé de toponyme vernaculaire à signifiant des marges.
« Les “zonards” sont apparus comme une nouvelle manière de désigner celles ou ceux qui portent les stigmates d’une Zone désormais dématérialisée »
Les réflexions qui structurent ce livre autour des implantations, puis des disséminations, de la Zone marquent ces transformations autant qu’elles les inscrivent dans des temporalités dont le compte rendu ne saurait être simplement factuel. Car les fins de siècle qui cadrent le récit indiquent aussi deux situations de crise dont les effets sont palpables dans la formation comme dans les reconfigurations de la Zone. Parmi d’autres, un ouvrage classique de Peter Wagner m’a inspiré dans l’idée de ces connexions (9). Au cours des dernières décennies du XIXe siècle, la modernité occidentale apparaît en effet comme marquée par la scansion d’une crise renforçatrice des inégalités (10). Un temps bousculée, l’organisation économico-politique du capitalisme industriel réifie les frontières entre les classes sociales. L’une des conséquences de cette frontiérisation, bien observable dans le grossissement des implantations zonières aux portes de Paris tout au long des années 1880, est la production renforcée de tout un volant de « surnuméraires » ; ceux-là mêmes que Karl Marx a regroupés, quelques décennies plus tôt, dans son idée d’un lumpenprolétariat associé aux « classes dangereuses » (11). Quant à la fin du siècle suivant, Wagner souligne qu’elle annonce une nouvelle scansion en matière de crise : celle d’un capitalisme entré dans une ère postindustrielle (ou postmoderne) mettant à mal la structuration des sociétés fondées sur le modèle de la nation et la reproduction des classes sociales. Là encore, les disséminations de la Zone, amorcées dès la décennie 1930, mais pleinement réalisées au cours de la décennie 1950 et jusque dans les années 1980, paraissent faire symptôme de ces bouleversements majeurs. Selon certains, ils ont (re)posé la question – jamais résolue depuis – de l’avenir d’un système-monde principalement basé sur le profit (12). Parmi ses exclus relégués aux coulisses de nos sociétés, les zonards dont les hors-lieux apparaissent dans ce livre présentent quelques visages des « nouvelles classes dangereuses » issues de la désindustrialisation.
Les Sauvages de la civilisation. Regard sur la Zone, d’hier à aujourd’hui, Jérôme Beauchez, éditions Amsterdam, paru le 3 juin 2022, 464 pages, 25 euros
- James Cannon, The Paris Zone. A Cultural History, 1840-1944, Londres et New York, Routledge, 2016.
- Courget (prénom non indiqué), « Agglomérations nouvelles autour de Paris. Leur origine. Leurs conditions hygiéniques », Bulletins et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, Ve série, t. 8, 1907, p. 365-366*.
- Alfred Delvau, Les Dessous de Paris, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860, p. 74*.
- Alfred Delvau, « Coup d’œil rétrospectif sur Paris », Paris qui s’en va et Paris qui vient (publication artistique dessinée et gravée par Léopold Flameng), vol. 1, no3, janvier 1860, p. 1*.
- Sous l’Ancien Régime, la Cour des miracles désignait l’ensemble des espaces de non-droit où se réunissaient les mendiants et les truands de la capitale. En 1831, Hugo la met en scène dans Notre-Dame de Paris. Quant aux écrits de Villon, voir notamment : Ionela Manolesco, « Quatre Ballades de Villon en jargon traduites en français moderne », Études françaises, vol. 16, no1, 1980, p. 71-107.
- L’ensemble des citations guillemetées dans ce paragraphe provient des Dessous de Paris, cit., p. 73-74.
- Jean-Paul Clébert, Paris insolite, Paris, Denoël, 1981 [1952], p.54.
- J’emprunte cette idée des non-lieux à l’anthropologue Marc Augé, qui les définit essentiellement comme des espaces de passage où les sociabilités ne parviennent plus à se fixer. Voir Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992.
- Peter Wagner, Liberté et discipline. Les deux crises de la modernité, trad. fr. – B. Grasset, Paris, Métailié, 1996 [1994].
- Il s’agit de la première « grande dépression » de l’économie de marché, que la plupart des historiens situent entre 1873 et 1896 ; à propos du contexte français, voir : Hubert Bonin, « La Grande Dépression française à la fin du xixesiècle. Réflexion sur sa datation et sa fonction », Histoire, économie et société, vol. 6, no 4, 1987, p. 509-533.
- Voir Karl Marx, Les Luttes de classes en France, trad. fr. M. Rubel et L. Janover, Paris, Gallimard, 1994.
- Voir notamment Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Giorgi Derluguian et Craig Calhoun, Le Capitalisme a-t-il un avenir ?, trad. fr. Saint-Upéry, Paris, La Découverte, 2016 [2013].