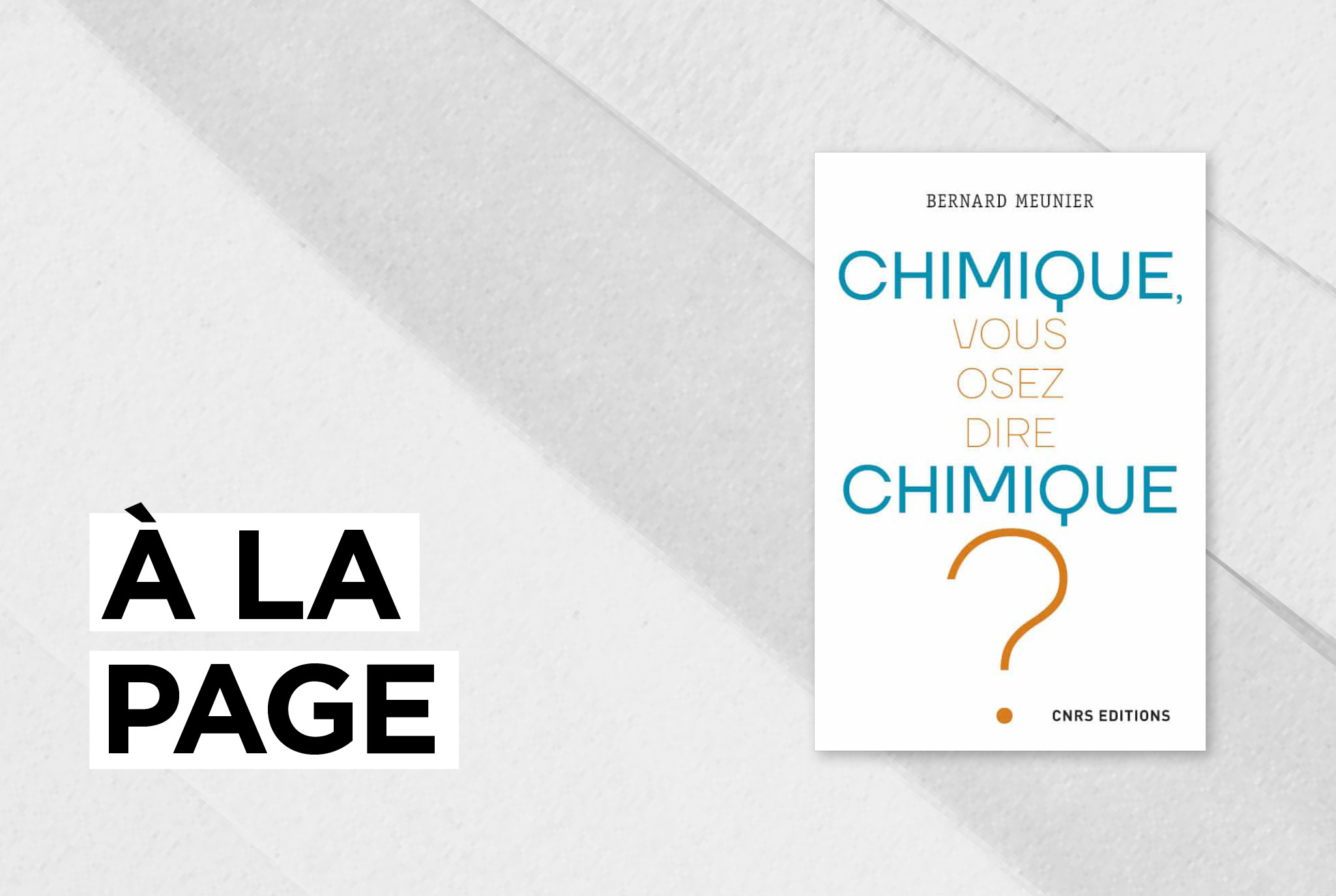Au pays des fictions, Alice Zeniter cherche les femmes
[Bonnes feuilles estivales 6/6] Tous les dimanches de cet été, le 1 vous fait découvrir les premières pages de livres à paraître à la rentrée littéraire. Aujourd'hui, Toute une moitié du monde, d’Alice Zeniter.

« J’ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice. » Dans Toute une moitié du monde (id., 2022), Alice Zeniter s’interroge sur la place de la femme dans la littérature. Lorsqu’elle était enfant, elle préférait ainsi s’identifier aux personnages qui agissaient – les hommes – plutôt qu’à ceux qui subissaient – les femmes, au choix prisonnières, recluses ou ballottées.
Extrait de son ouvrage, à mi-chemin entre un essai et une « rêverie autour de la fiction », à paraître le 31 août chez Flammarion.
Une moitié du monde
En 2010, j’étais en couple avec un Anglais et, comme lui, je lisais le Guardian – ce qui me paraissait être extrêmement élégant, d’autant plus que j’avais découvert qu’on ne prononçait pas le « u », détail dont je tirais une satisfaction disproportionnée. C’est dans ce journal que j’ai appris l’existence du test de Bechdel, à l’occasion d’un article sur les sorties au cinéma pendant le week-end de Thanksgiving – un moment crucial pour les productions puisqu’il lance le début des cinq semaines pendant lesquelles les films font le plus d’entrées partout dans le monde. Or, m’apprenait l’article, la plupart des grosses productions hollywoodiennes ne passaient pas ce test dont jusque-là j’ignorais l’existence. Ce n’est peut-être pas votre cas aujourd’hui mais je vais tout de même le présenter rapidement. Le test de Bechdel (ou Bechdel-Wallace), qui apparaît dans la bande dessinée d’Alison Bechdel L’Essentiel des gouines à suivre publiée dans les années 1980, a permis de mettre en avant l’absence ou la faible présence des femmes au pays des fictions. Redoutablement facile à utiliser, il ne contient que trois critères :
1. Il doit y avoir deux femmes nommées dans l’œuvre.
2. Ces femmes parlent ensemble.
3. Elles parlent d’autre chose que d’un homme.
Ce test a donné lieu à de nombreuses variations ces dernières années, dont une que j’aime beaucoup, proposée par la scénariste américaine Kelly Sue DeConnick : le test de la lampe. Plus lapidaire encore que le test de Bechdel, la version de DeConnick ne contient qu’une question : « Peut-on remplacer le personnage féminin par une lampe sans que l’histoire soit modifiée ? » La formule me fait beaucoup rire ; le fait que la réponse soit « oui » dans un certain nombre de productions contemporaines, beaucoup moins.
« Peut-on remplacer le personnage féminin par une lampe sans que l’histoire soit modifiée ? »
Le test de Bechdel (ou certaines de ses variantes) est repris de plus en plus couramment dans la presse pour traiter des films et des séries mais il est assez peu utilisé dans le domaine de la critique littéraire, du moins française. Il révélerait, pourtant, un déséquilibre flagrant entre les personnages masculins et les personnages féminins dans ce qu’on pourrait appeler le « corpus canonique », à savoir les livres voués à être mis dans nos mains par les parents, le corps professoral, les connaissances cultivées, les listes des romans incontournables publiées par des magazines de référence – bref, une sorte de socle culturel commun, valorisé et trans- mis de génération en génération. À la suite du lycée, j’ai fait une hypokhâgne, puis deux khâgnes, afin de passer le concours de Normale Sup. J’ai donc lu pendant longtemps au sein de ce corpus canonique (1). Et une fois entrée à Normale, j’ai étudié le théâtre pendant deux années de master et trois années de thèse, ce qui veut dire que j’ai lu peu de romans pendant cinq ans – retardant encore l’occasion de sortir un peu du corpus-carcan qui a façonné toute une partie de ma vie de lectrice.
Comment pourrais-je dire que je m’identifie à elles ? Ou bien que je préfère telle kidnappée à telle pendue ?
Plusieurs fois, lors d’entretiens ou de rencontres, on m’a demandé à quel personnage féminin célèbre de la littérature je m’identifiais ou lequel je préférais. C’est une question qui me fait bégayer, à chaque fois. Car lorsque je repense à plus de vingt ans de lectures, mes souvenirs ne me présentent pas une frise de personnages féminins aimables, surprenants ou forts parmi lesquels faire mon choix. Au contraire, ils font dérouler une kyrielle de figures de second plan, objets de désir d’un héros masculin, éléments souvent passifs, propres à être enlevés, séquestrés, empoisonnés (parfois les trois consécutivement), une myriade de silhouettes alanguies, au teint pâli par des amours malheureuses, visage collé à la fenêtre, quelques folles enfermées ici ou là, des princesses cornéliennes mourant comme foudroyées par l’intensité d’un chagrin d’amour, des princesses raciniennes se suicidant pour éviter la disgrâce d’un désir scandaleux, des femmes d’âge mûr ou des petites filles abusées et violées, et, bien sûr, une cohorte d’épouses souvent délaissées, forcément domestiques et tristement adultères. Comment pourrais-je dire que je m’identifie à elles ? Ou bien que je préfère telle kidnappée à telle pendue ?
Il n’est évidemment pas question pour moi, lorsque je fais cette liste de personnages féminins passifs, de blâmer les auteurs qui les ont créés pour leur manque d’imagination. Eux, comme leurs écrits, sont les produits de leur époque et ils n’y peuvent pas grand-chose si, pour reprendre l’expression difficilement traduisible de l’universitaire américaine Kathryn Rabuzzi, les femmes, historiquement limitées à la sphère domestique, ont très majoritairement connu des « expériences nonstoried », c’est-à-dire qui ne sont pas racontées mais aussi qui ne sont pas facilement racontables, qui ne se présentent pas sous la forme d’une histoire. Ou peut-être, pour le dire autrement, que ce que nous avons accepté comme étant une histoire (une bonne histoire) inclut difficilement une majorité d’existences féminines qui, au cours des siècles passés, ont été marquées par leur absence ou leur manque d’agentivité – terme que j’emploie ici à la fois dans son sens de puissance d’agir mais aussi de capacité à se percevoir comme actrice ou force motrice de sa portion du monde. La narratrice de Sans alcool, une nouvelle de l’autrice suisse Alice Rivaz, écrite dans les années 1960, pense ainsi qu’elle aurait aimé « la grande vie », mais, vieille fille et tout récemment orpheline, elle n’a pas d’autre ambition que d’essayer tous les restaurants végétariens et sans alcool de sa ville – seuls lieux de sortie convenables pour une femme seule. Elle se demande anxieusement, à quarante ans passés, s’il y a des vies qui sont « comme des maquettes, des vies qui seraient encore à vivre, une fois la dernière page tournée ? Et moi j’en serais justement un exemple ? ». Cette vie non vécue qu’elle craint, pourtant, d’avoir vécu, elle la compare à des pages blanches, « et par blanches, je veux signifier vides ». Il n’y a pas d’histoires, ici, rien dont faire un livre en somme.
Comme le note Susan S. Lanser au début de son article intitulé « Vers une narratologie féministe », publié au milieu des années 1980 : « La question la plus évidente que le féminisme puisse poser à la narratologie, c’est tout simplement celle-ci : sur quel corpus et quelles définitions du récit et de l’univers de référence les avancées de la narratologie se sont-elles fondées ? » Sa réponse est sans appel : les travaux de narratologie n’ayant jamais pris en compte la question du genre au moment d’établir un canon ou les outils employés pour l’étude d’une œuvre, « tous les récits qui ont contribué à fonder la narratologie ont été des textes d’hommes ou des textes traités comme des textes d’hommes ». Certaines notions s’avèrent de fait très limitées, voire inopérantes dès qu’on les applique à un corpus de textes plus large, notamment la notion d’« intrigue » (plot, en anglais), qui repose sur un enchaînement d’actions accomplies intentionnellement par les protagonistes et « implique donc un pouvoir, une capacité qui peuvent s’avérer éloignés de ce que les femmes ont connu, de leur expérience historique ou textuelle, et peut-être même éloignés des désirs de ces femmes ». Les critiques littéraires, seraient-elles féministes, se retrouvent obligées d’appliquer régulièrement aux textes de femmes le terme « plotless » (sans intrigue), et à approcher ces œuvres par la négative, les désignant par ce qu’elles n’ont ou ne sont pas avant de pouvoir dire ce qu’elles sont. Ce n’est sans doute pas le meilleur moyen de donner envie de les lire…
J’ai été Bastien Balthazar Bux, pas la Petite Impératrice, j’ai été d’Artagnan, pas Constance Bonacieux, j’ai été Jean Valjean et pas Cosette
Revenons-en à la question sur laquelle je trébuche : à qui me suis-je identifiée lors de mes lectures ? Avant d’être adulte, toujours aux personnages masculins : j’ai été Bastien Balthazar Bux, pas la Petite Impératrice, j’ai été d’Artagnan, pas Constance Bonacieux, j’ai été Jean Valjean et pas Cosette – pour la bonne et simple raison que la Petite Impératrice est prisonnière de sa tour d’ivoire, que Constance Bonacieux passe son temps à se faire enlever et que Cosette troque les maltraitances des Thénardier contre la surveillance des bonnes sœurs du couvent, toutes situations qui répliquaient (en les exagérant) l’état d’impuissance qui était le mien et dont je cherchais à m’échapper par la lecture. Je lisais enfermée dans une chambre dont mon petit corps et mon statut de mineure ne me permettaient pas de sortir, ou jamais assez loin, et les personnages féminins que je rencontrais lors de ces lectures étaient elles-mêmes des prisonnières, des recluses ou des ballottées par la volonté des forts (2). Forcément, je me projetais dans l’autre genre, celui qui agissait, celui contre qui les quatre murs d’une chambre ou d’une cellule paraissaient ne rien pouvoir. J’ai été un homme presque tout le temps de ma vie de lectrice. D’abord avec un immense plaisir et puis avec un certain agacement, dû à la lassitude, sans doute. J’ai été enchantée de découvrir, dans La Force des choses, la colère qu’avait ressentie Simone de Beauvoir à la lecture de Pour qui sonne le glas. Malgré mon amour pour ce roman, j’ai compris instantanément la détestation qu’elle éprouve pour les « complicités que nous propose Hemingway à tous les tournants de ses récits », complicités qui « impliquent que nous avons conscience d’être, comme lui, aryens, mâles, dotés de fortune et de loisirs, n’ayant jamais éprouvé notre corps que sous la figure du sexe et de la mort » et qui montrent assez à qui il s’adresse quand il écrit, quel lectorat il se souhaite. « Un seigneur s’adresse à des seigneurs. La bonhomie du style peut tromper, mais ce n’est pas un hasard si la droite lui a tressé de luxueuses couronnes : il a peint et exalté le monde des privilégiés », écrit Beauvoir.
C’était forcément une blague, ou une volonté de les humilier, sinon pourquoi leur faire lire des histoires de filles ?
Je me demande aujourd’hui si les garçons qui grandissaient à côté de moi ont pu connaître une expérience similaire : est-ce qu’une fiction leur a permis, au moins une fois, de s’identifier à une fille, à une femme ? Je n’en suis pas sûre (et serais ravie d’entendre les récits d’expériences enfantines qui me contredisent) tout simplement parce qu’ils n’ont pas eu à le faire, ils disposaient de tout un corpus qui leur permettait de suivre des personnages masculins. Un ami irlandais m’a raconté, il y a quelques années, la stupeur dans laquelle avait été plongée sa classe de garçons (il était scolarisé dans un lycée non mixte) lorsque leur professeur leur avait demandé de lire Orgueil et préjugés, de Jane Austen : c’était forcément une blague, ou une volonté de les humilier, sinon pourquoi leur faire lire des histoires de filles ? Dans « Sortir les lesbiennes du placard », un documentaire radio de Clémence Allezard, la réalisatrice Céline Sciamma déclare qu’elle tient délibérément les hommes hors cadre, hors champ et ajoute que ça permet aux spectateurs masculins de s’identifier aux personnages féminins qu’elle filme. Ce qui pourrait se présenter a priori comme une exclusion est en réalité le seul moyen de les inclure. Trop peu habitués à passer d’un genre à l’autre lorsqu’ils entrent dans une œuvre de fiction, les hommes se projetteraient toujours d’emblée sur les personnages masculins et il faudrait faire disparaître ceux-ci pour que les spectateurs puissent connaître ce que les spectatrices et lectrices pratiquent depuis toujours : une identification indépendante du genre.
(1) Je me souviens de ma professeure de lettres, en khâgne, qui nous avait recommandé de ne jamais citer d’œuvres contemporaines dans nos dissertations. Le temps, disait-elle, n’ayant pas encore fait son œuvre de filtre pour séparer «officiellement » les mauvais romans des bons, nous risquions de nous heurter aux goûts du correcteur. C’était s’exposer à l’échec. « À la rigueur, avait-elle concédé, vous pouvez tenter Truismes, de Darrieussecq, mais n’allez pas plus » En répondant aux questions de Laure Murat dans Relire, Julia Deck raconte une expérience similaire durant ses années d’études à la Sorbonne : « La littérature s’arrêtait à La Nausée de Sartre. »
(2) Fifi Brindacier, capable de porter son poney à bout de bras, a évidemment constitué une exception bienvenue. De même que Claude, dans Le Club des cinq, même si toute son agentivité semblait venir du fait qu’elle se comportait comme un garçon et se faisait, à maintes occasions, passer pour un garçon.
Toute une moitié du monde, Alice Zeniter, Flammarion, parution le 31 août 2022, 240 pages, 21 euros

Bio express
L’auteur de Sombre dimanche (Albin Michel, 2013) et de Juste avant l’oubli (Flammarion, 2015) a commencé à écrire dès l’enfance et publié son premier roman à 16 ans. Après avoir enseigné le français en Hongrie et donné des cours à l’université Sorbonne Nouvelle, elle a fondé la compagnie théâtrale l’Entente cordiale. Son roman L’Art de perdre retrace le destin d’une famille de harkis sur trois générations (id., 2017). Dans Toute une moitié du monde (id., 2022), elle partage ses pensées autour de la fiction.
Photo Pascal Ito / Flammarion