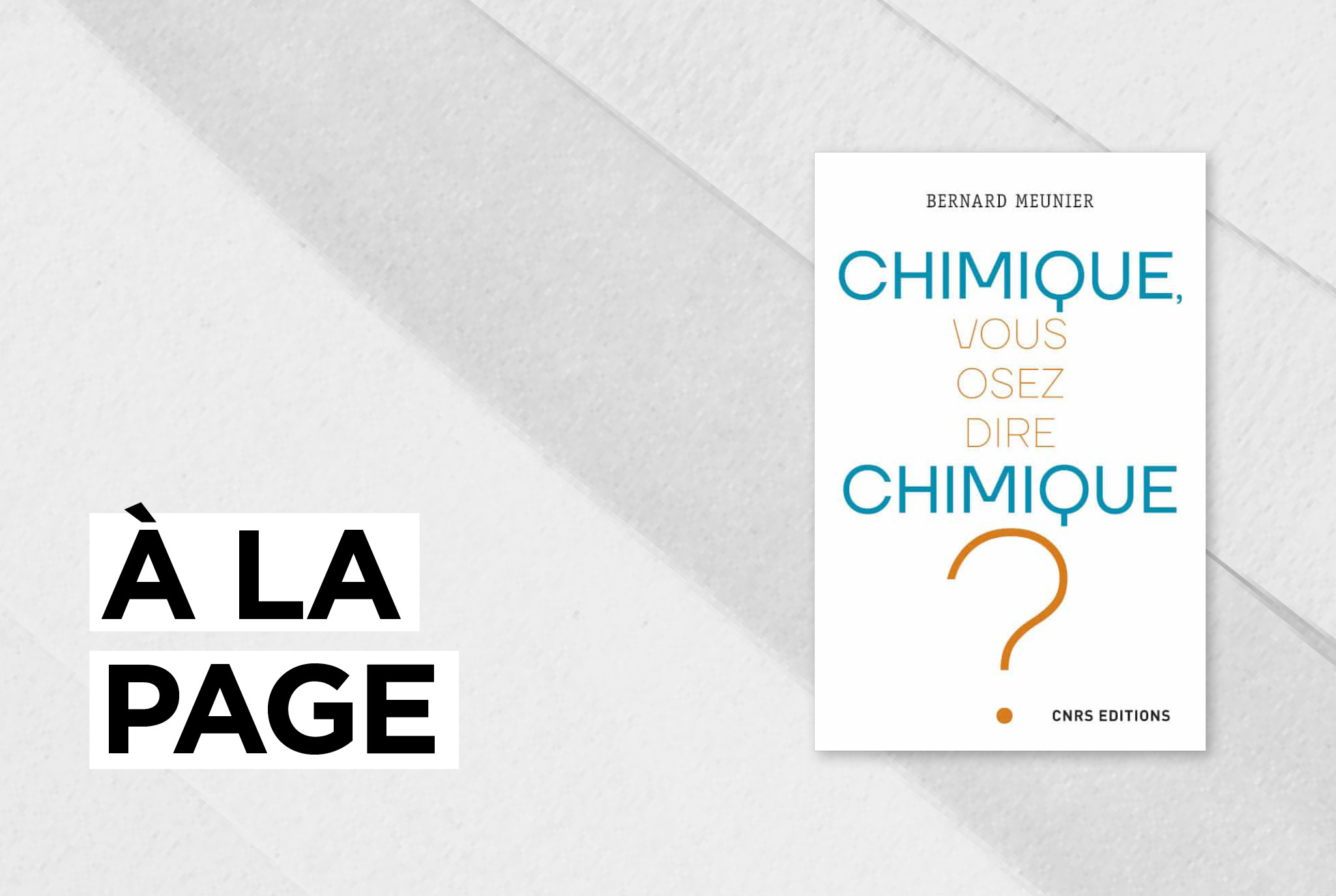« Un vent mauvais arriva du Sahara »
[Bonnes feuilles estivales 3/6] Tous les dimanches de cet été, le 1 vous fait découvrir les premières pages de romans à paraître à la rentrée littéraire. Aujourd'hui, Au vent mauvais, de l'écrivaine algérienne Kaouther Adimi.

Leila et Tarek sont mariés. Saïd, le frère de lait de Tarek, est devenu un écrivain à succès et choisit de dévoiler l'intimité du couple au public pour son premier roman. À travers ce qui est vécu comme une trahison, il enterre toute possibilité de retrouvailles avec Tarek et Leila.
Dans ce roman teinté de la poussière rouge du Sahara, l'écrivaine algérienne de 36 ans Kaouther Adimi retrace l'histoire de son pays sur un siècle ou presque, de la colonisation jusqu'au basculement dans la guerre civile, il y a trente ans. En voici les premières pages, avant sa parution le 19 août au Seuil.
L’écrivain
Dans la nuit du 22 septembre 1972, un vent mauvais arriva du Sahara et recouvrit Alger d’une poussière rouge, qui se déposa sur les façades des immeubles, les toits des voitures, les feuilles des palmiers et les parasols des plages.
Au petit matin, toute la capitale algérienne était teintée de cette étrange couleur et les écoliers s’amusaient à dessiner, avec leur index, des soleils sur les vitres poussiéreuses des automobiles garées un peu partout tandis que leurs aînés y inscrivaient des mots obscènes.
À la radio, un spécialiste affirma que ce sable contenait des traces des essais nucléaires effectués par la France moins de dix ans auparavant. Beaucoup d’auditeurs tournèrent le bouton à la recherche d’une autre station, espérant y trouver de la musique ou une émission de divertissement.
Saïd B. aurait pu voir dans ce vent un mauvais présage, mais il ne croyait ni au destin ni aux signes et c’est en sifflotant, le visage serein, qu’il quitta son appartement du centre‑ville ce matin‑là, après avoir embrassé sa femme et lui avoir rappelé qu’il l’attendait à la grande librairie de la rue Didouche‑Mourad, à six heures du soir précises.
Ce rappel était parfaitement inutile : en dix-sept ans de mariage, elle n’avait jamais rien oublié.
Il descendit à pied les neuf étages de l’immeuble – l’ascenseur était en panne depuis le départ des Français en 1962 –, salua un voisin adossé à la porte de l’entrée, qui le congratula en lui montrant le journal qu’il lisait et où la photo de Saïd s’étalait à la une.
Saïd B. aurait pu voir dans ce vent un mauvais présage, mais il ne croyait ni au destin ni aux signes
Arrivé devant la Maison de la radio, il s’arrêta quelques instants à côté du grand portail en fer forgé et observa un peintre qui s’appliquait à reproduire sur un mur les visages de Yacef Saâdi, de Hassiba Ben Bouali et d’autres héros de la guerre d’indépendance. L’artiste l’aperçut, lâcha son pinceau, traversa la rue pour le rejoindre et lui tapa amicalement sur le dos en s’exclamant :
– Félicitations, mon ami ! Bientôt c’est toi que je dessinerai sur les murs de la ville !
Saïd secoua la tête d’un air faussement modeste :
– Oh, ce n’est qu’un petit livre de rien du
– Un petit livre ? Un grand roman, tu veux dire ! Le plus grand roman algérien ! Tout le monde en parle ! Ah, mon ami, je suis si heureux pour
Saïd répondit avec un sourire gêné et contourna la barrière de sécurité après avoir présenté son badge au gardien qui ne fit pas attention à lui, occupé à suivre à la radio un match de football. À peine l’écrivain s’était‑il éloigné qu’il l’entendit pousser un cri de joie. L’Algérie venait de marquer contre la Turquie.
Avant d’entrer dans le studio d’enregistrement qui lui était réservé, Saïd tapa un pied contre l’autre pour se débarrasser de la poussière rouge. Il s’installa et fit signe à sa secrétaire qu’elle pouvait aller chercher le premier invité de la journée. Il s’agissait d’un chanteur andalou, le troisième qu’il recevait ce mois‑ci mais la liste des artistes « autorisés » par sa hiérarchie avait été considérablement réduite depuis l’arrivée au pouvoir de Houari Boumédiène en 1965.
Saïd, d’habitude affable et bienveillant, passa la journée dans un état d’agitation tel qu’il se montrait par moments impatient et brusque, et la secrétaire en était réduite à s’excuser platement en raccompagnant les invités.
Enfin, il fut temps de quitter la radio et de redescendre vers le centre‑ville jusqu’à la librairie qui le recevait pour une rencontre autour de son premier roman, publié un mois plus tôt.
Son cœur se serra comme à chaque fois qu’il avait eu l’ouvrage entre les mains, ces dernières semaines
Il était anxieux soudain, presque intimidé, et il se força à ralentir le pas pour ne pas donner l’impression qu’il se pressait. Il observa de loin les lecteurs arriver : des étudiants, une femme vêtue d’un élégant tailleur et même un homme d’un certain âge aux vêtements froissés. Il fut fier d’une telle diversité de public. « C’est que, moi, j’écris pour tout le monde ! » se dit‑il.
Il patienta encore quelques minutes avant de pénétrer à son tour dans la librairie bondée. Son livre s’affichait sur les étals, bien visible. La couverture bleue avait attiré son regard, de l’extérieur. Son cœur se serra comme à chaque fois qu’il avait eu l’ouvrage entre les mains, ces dernières semaines. En prenant place face à son public, il regretta de ne pas avoir exigé de son éditeur un autre choix pour l’illustration.
Perdu dans ses pensées, il n’entendit pas le libraire détailler son parcours, et ce ne fut qu’une fois les applaudissements terminés qu’il se força à se concentrer sur le moment présent. Il afficha un grand sourire, sortit de la poche intérieure de sa veste un stylo à plume qu’il posa sur la table et se racla la gorge bruyamment avant de prendre la parole :
– C’est un roman sur l’Algérie d’aujourd’hui. On y croise des personnages tous liés les uns aux autres. Ils sont nés dans le village d’El Zahra, qui ressemble à n’importe quel autre village du Leïla, une jeune fille des plus ordinaires, Tarek, un berger rustre mais attachant, et Safia qui fabrique des poteries, gardienne des lieux, constituent les personnages essentiels de cette vaste fresque. Leurs trajectoires sont déterminées par les bouleversements que notre pays a connus ces dernières années. Je sais que la fin de ce roman a déçu beaucoup d’entre vous, car vous avez vu dans le futur mariage de Leïla un renoncement et une victoire des traditions. Pour autant, ce livre, je l’ai écrit comme un hommage à Leïla, c’est‑à‑dire comme un hommage à toutes les femmes de ce pays, pour les encourager et les inciter à réclamer plus de liberté, à refuser les diktats de la société et à rêver à une vie différente.
Le public applaudit de nouveau. Le libraire rappela qu’il s’agissait là du tout premier roman algérien de langue arabe et plusieurs hommes dans l’assistance se levèrent pour acclamer Saïd.
Un photographe joua des coudes, se planta face à l’écrivain et appuya sur le bouton de son appareil, déclenchant un flash qui l’aveugla.
*
La photo est là, sur mon bureau. On y voit Saïd. Ses cheveux bruns, un peu longs, sont coiffés en arrière, un large sourire illumine son visage, ses yeux grands ouverts fixent l’objectif. Il porte une chemise blanche sous un pull en laine qui semble boulocher. Ses mains sont posées sur la table, bien à plat, soigneusement manucurées. Près de lui, les livres rangés sur les étagères de la librairie. Et se décline sur la photo une dizaine de fois la couverture et ainsi une dizaine de fois le dessin d’une femme aux longs cheveux séparés par une raie au milieu, les yeux en amande, un grain de beauté sur la joue. C’est Leïla. Elle porte une robe à pois, boutonnée jusqu’au cou. Une étoffe, comme un châle, est nouée autour de ses épaules. Si on observe attentivement la photo, derrière la vitrine, au loin, il y a une ombre un peu floue, c’est le dos d’un homme qui s’éloigne. Il s’agit de Tarek.
Tandis que la locomotive se mettait en marche, elle se fit la promesse de ne jamais remettre les pieds ici
La photo en noir et blanc a été soigneusement rangée dans une mallette en carton que Tarek a cachée dans la remise de son jardin. Il l’a coincée derrière des étagères encombrées de pots de peinture, avant de partir au petit matin avec Leïla et leurs enfants. Ils ne partent pas d’ailleurs, ils fuient, la tête recouverte par la capuche d’un burnous pour Tarek, par celle d’un haïk pour Leïla. Ensemble, ils ferment la porte à double tour, ajoutent un cadenas et abandonnent leur maison et leurs rêves.
Ils prennent le chemin de la gare, tenant chacun l’une de leurs filles endormies dans les bras. Ils marchent ainsi pendant deux kilomètres sous le soleil qui se lève à peine, sans échanger une seule parole, non pas qu’ils soient en colère l’un contre l’autre, mais ils ont longuement parlé et tout a été dit.
En montant dans le train, Tarek eut une pensée pour cette mallette. « Tout de même, ce n’est pas raisonnable de l’avoir laissée là, se dit‑il, mais qui irait fouiller une remise de jardin ? Et puis Safia veille ainsi qu’elle a toujours veillé sur nous. »
L’employé sur le quai siffla. Leïla ne jeta aucun regard par la fenêtre. Tandis que la locomotive se mettait en marche, elle se fit la promesse de ne jamais remettre les pieds ici.
Elle tiendra parole pendant vingt ans.
1
TAREK
Le berger
Le hameau d’El Zahra n’était connu pour aucun fait particulier. Au sud et au nord se trouvait une chaîne montagneuse. Les terres ne se cultivaient pas et le seul lac dans les parages était à plus de cent kilomètres. En hiver, la neige recouvrait tout, et en été, les feux étaient fréquents. Quel est le premier homme à avoir eu l’idée saugrenue de s’installer ici, nul ne saurait le dire. La région n’avait rien à offrir. Sa seule richesse était son ciel qui, la nuit tombée, s’illuminait de petits points dorés suspendus au‑dessus des têtes, et il n’était pas si rare en ce début de l’année 1922 d’y croiser des savants ou de jeunes étudiants en astronomie venus depuis les quatre coins de la France pour scruter les astres.
Les parents de Tarek se préoccupaient peu des étoiles ou de la lune, elles n’étaient qu’un indicateur de temps et de lieu, une manière de se repérer. Le reste comme on disait n’était que poésie. Et la poésie, ce n’était pas pour eux.
La nuit du 3 février 1922, Tarek s’apprêtait à venir au monde dans une minuscule maison en bois, un gourbi adossé au flanc de la montagne, à l’extrémité du village. Le sol en terre battue était glacial et le toit en paille laissait passer le vent et la pluie. L’accouchement durait depuis plusieurs heures déjà, le bébé se présentait par le siège. La future mère n’était pas seule. Safia, son amie et voisine, était arrivée dès le début des contractions. Elle portait une robe‑tablier rose qui lui donnait des allures d’infirmière, avait chaussé des sabots en bois et attaché ses cheveux bouclés. Elle massait le dos de la femme enceinte, et ne s’interrompait que pour verser de l’eau dans une bassine depuis un bidon que, prévoyante, elle était allée remplir au puits, la veille.
Elles se transmettaient des secrets et des remèdes depuis des générations
Elle épongea le front de la future mère et l’encouragea en lui répétant sur un ton calme et rassurant : « Tu vas y arriver, fais‑moi confiance. » Seule sa voix résonnait dans l’unique pièce de la maison et pour cause, la femme qui accouchait était muette. Elle ne pouvait que fixer Safia de ses grands yeux terrifiés. Cette dernière tenta de l’apaiser, le bébé allait se retourner, elle en était certaine. Elle‑même n’avait pas d’enfant, son mari étant mort très jeune, mais elle savait comment accompagner les bébés et les faire venir au monde. Sa mère était accoucheuse et la mère de sa mère l’avait été avant elle également. Elles se transmettaient des secrets et des remèdes depuis des générations.
Avec ses doigts agiles, brunis par le soleil, Safia décrivait des cercles sur le ventre tendu de la femme en murmurant des prières. Elle sentit enfin le bébé bouger. Il semblait chercher la chaleur des mains posées sur le ventre de sa mère.
Le futur père était à une dizaine de kilomètres de là. Il avait fait promettre à Safia qu’elle enverrait un gamin le prévenir, une fois le bébé né. Il était certain que ce serait un garçon et avait déjà fabriqué pour lui un berceau en bois. Il avait accepté de travailler sur un chantier difficile et de dormir dans un baraquement pendant un mois, pour pouvoir inviter tout le village à venir partager un couscous à la naissance de l’enfant.
Douze heures après le début du travail, Tarek vint au monde et poussa son premier cri, rassurant ainsi les deux femmes à la fois sur sa vitalité et sur sa voix. Sa mère le garda contre elle en dévisageant ce petit être qui d’un coup venait de transformer sa vie. Elle, qui avait toujours été effacée et timide, se redressa, un grand sourire sur le visage. Elle avait un fils.
Au vent mauvais, Kaouther Adimi, Seuil, parution le 19 août 2022, 272 pages, 19 euros.
Bio express
L’autrice de Des pierres dans ma poche (Seuil, 2016) et des Petits de Décembre (id., 2019) est née et a grandi en Algérie, avant de s’installer à Paris. Elle a obtenu le prix du Style et le Renaudot des lycéens pour Nos richesses (id., 2017), dans lequel elle retrace la vie d’Edmond Charlot, le libraire-éditeur algérois qui publia les premiers textes d’Albert Camus. Kaouther Adimi publie en août 2022 son cinquième roman, Au vent mauvais (id.).