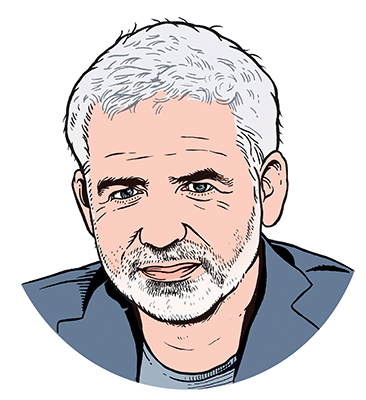L'image manquante
Temps de lecture : 5 minutes
Les violences causées par la mort du jeune Nahel, tué à bout portant par un policier le 27 juin à Nanterre, ont littéralement embrasé le pays. Ce drame et ses conséquences soulèvent de nombreuses questions, qui dépassent les seules violences policières pour interroger plus largement les racines de la violence en France. Après la crise des Gilets jaunes et les manifestations contre la réforme des retraites, les occasions d’en découdre avec l’État et les forces de l’ordre se multiplient, essentiellement dans les villes. Pourquoi ces tensions extrêmes ? Quels sont les maux profonds dont la France ne parvient pas à guérir ? Qu’avons-nous raté dans la politique des banlieues, dans l’éducation et, plus largement, dans le processus historique d’intégration ?
Depuis sa création il y a près de dix ans (avril 2014), le 1 s’est donné pour mission d’éclairer notre époque avec les regards les plus variés d’experts, d’intellectuels, d’écrivains et, bien sûr, de journalistes. Il s’efforce ainsi d’introduire des réflexions et des explications durables, dans une société sans cesse dominée par l’éphémère et une forme d’amnésie.
Éric Fottorino
La violence qui n’a pas d’histoire est terrifiante. Elle crée la peur et le sentiment d’insécurité. La violence qui n’a pas d’histoire est une anomalie, une incompréhension, un monstre que l’on ne peut que stigmatiser et condamner. Et la violence qui passe en boucle sur nos écrans n’a justement pas d’histoire, pas de passé, elle est simplement spectaculaire et télégénique. Sa force est sa faiblesse. Car elle ne peut alors faire que le jeu des populismes opportunistes qui ne manqueront jamais de qualifier les auteurs de cette violence de barbares, de crétins, d’imbéciles, de malades ou de voyous. Une information – et a fortiori une image – violente sans passé, sans mémoire et sans histoire est un espace vide de sens. Et puisque la nature a horreur du vide, le spectateur va le remplir ici avec ce qu’il peut : son angoisse. Car c’est ainsi que l’homme fonctionne face à ce qui l’effraie et qu’il ne comprend pas. Et l’angoisse ne peut alors s’apaiser qu’avec en retour un message de protection, comme le demanderait l’enfant qui a peur. La police, casquée, bottée et armée, est ce message. Le message opportuniste des politiques qui ont pourtant largement participé à construire ce désarroi et cette colère, cette histoire invisible sur laquelle s’est construite la violence. Ajoutons à ce terreau le sentiment si profondément ressenti du mépris et de l’ignorance.
Il faut accepter de se dire qu’une violence répond systématiquement à une autre violence.
Qui oserait penser que la violence d’un enfant n’est pas le fruit du dysfonctionnement de sa famille ? Qui oserait penser que son histoire et son lien avec ses parents ne comptent pas dans ce que l’enfant devient ? Personne. Ou bien ceux, pathétiques et tragiques, qui se cachent derrière le déni pour ne pas faire face à leur incapacité à se regarder en face. Ceux qui ne veulent rien déconstruire de leurs certitudes parce qu’ils ont peur, au fond, de l’abîme dans lequel leur propre vérité les plongerait. Il faut accepter de regarder ce qui dysfonctionne dans la famille pour comprendre la violence de l’enfant. Il faut accepter qu’une société regarde ce qui ne va pas chez elle pour comprendre la réaction d’une partie de sa population. Il faut accepter de se dire qu’une violence répond systématiquement à une autre violence.
Celle qui se décide notamment dans les cabinets ministériels ou à l’Assemblée nationale lorsque, depuis des dizaines d’années, des lois sont votées pour accompagner la violence des marchés financiers qui construit la désespérance des salariés du monde occidental. Il n’y a là aucune idéologie mais le simple compte rendu d’une réalité qui se résume par des courbes d’évolution de la répartition des richesses depuis quarante ans. Depuis que les États ont donné les clés du pouvoir aux marchés financiers. Et ce déséquilibre absolu de la répartition des richesses n’est-il pas une autre violence insupportable ? Mais cela ne crée pas d’images. Ou alors, comble du paradoxe, pour des émissions de reportages qui montrent au « petit peuple » comment vivent les plus riches. Ces plus riches dont l’argent vient en grande partie de la part toujours grandissante que le capital récupère sur la valeur du travail au détriment justement de ceux qui créent ces richesses, les salariés. Avec un impact mécanique sur les salaires et donc en premier lieu sur la consommation et ensuite sur l’équilibre des caisses de la Sécurité sociale dont les recettes ne dépendent justement… que des salaires. Réaction en chaîne aussi inévitable que celle de la fission nucléaire du plutonium qui mène à l’explosion atomique. Ajoutons-y la fraude fiscale qui est devenue structurante et sa petite sœur que certains appellent poliment l’optimisation fiscale.
Car l’image de la modification du calcul des APL ou de l’indemnisation de Pôle emploi est moins saisissante que celle de quelques vitrines cassées.
L’explosion de la colère qui surgit aujourd’hui prend racine dans cette histoire-là. Dans la violence de cette histoire-là. Deux violences qui se répondent, mais à la manière d’un catcheur qui se battrait contre l’homme invisible armé de fusils d’assaut. Une violence plus diffuse, moins spectaculaire et moins télégénique. Car l’image de la modification du calcul des APL ou de l’indemnisation de Pôle emploi, ou bien celle de la redistribution des bénéfices des entreprises aux actionnaires (la France est championne d’Europe de l’exercice), est moins saisissante que celle de quelques vitrines cassées. Mais force est de constater qu’il y a certaines casses qui se réparent beaucoup moins vite que d’autres.
Il s’agit alors pour celui qui est en charge de témoigner de l’événement d’en raconter aussi sa genèse. C’est sa responsabilité. Il ne peut pas se satisfaire du spectacle de l’accident. S’il le fait, il ment au réel, il ment à l’histoire, il ment à la mémoire. C’est l’indispensable mission du journalisme et du cinéma. Fabriquer inlassablement l’image manquante.
« Cette violence est devenue spécifiquement française »
Robert Muchembled
Comment qualifier les manifestations violentes que nous connaissons depuis plusieurs mois ?
Elles relèvent d’une forme récurrente de la démocratie française : dès qu’il y a un blocage des réformes sociales, ou un programme qui met en cause des acquis…
[Pacifisme]
Robert Solé
Oui, madame, je porte un gilet jaune. Oui, je suis en train de photographier une agence bancaire en flammes. Et alors ? On n’a même plus le droit de photographier maintenant ? Vous, les journalistes, vous feriez mieux d’aller interroger les CRS qui …
Les clés de la communication non violente
Manon Paulic
PARIS, XIe arrondissement. Comme chaque vendredi après-midi, Fanny Partiseti a légèrement modifié la disposition de son salon. Autour du tapis blanc cassé, elle a placé, en cercle, ses deux fauteuils v…