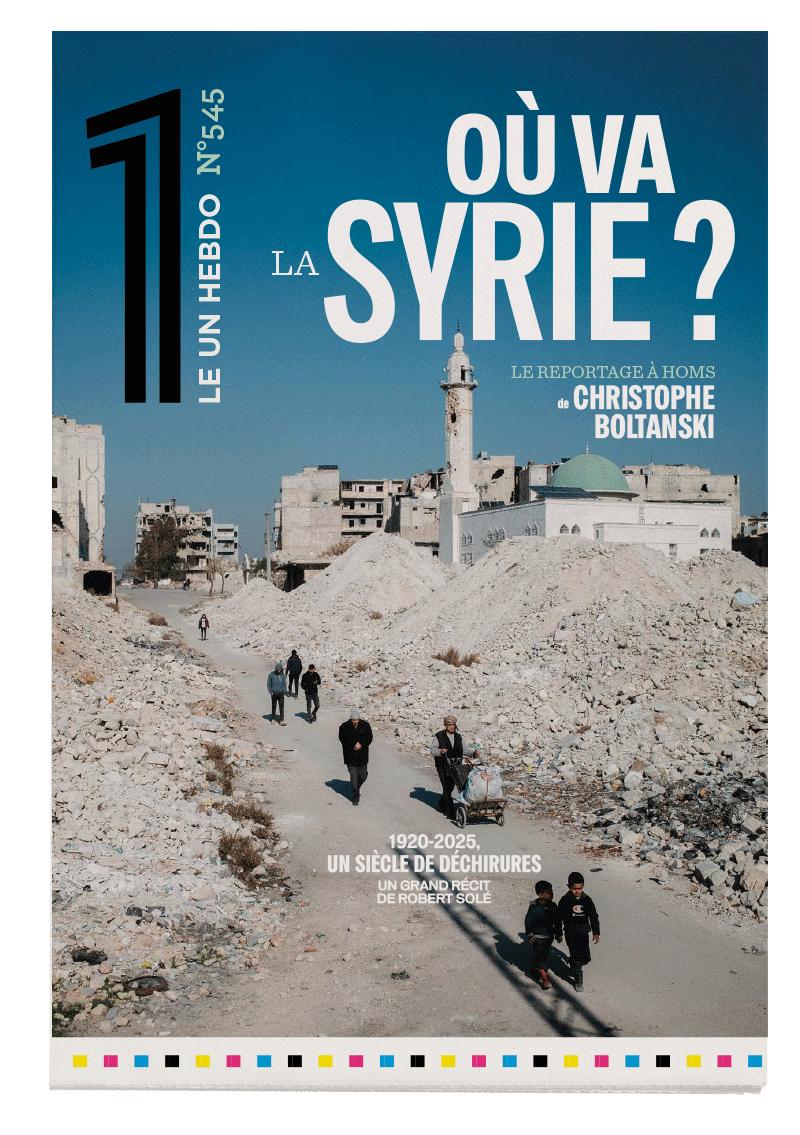« On a affaire à un phénomène générationnel au sens historique »
Temps de lecture : 9 minutes
En 2017, vous avez publié avec Serge Guérin La guerre des générations n’aura pas lieu. Cette affirmation est-elle toujours vraie, malgré le contexte de pandémie qui exacerbe les tensions sociales ?
Je le crois, oui. La guerre des générations est un scénario qui revient souvent, comme s’il nous permettait d’apprivoiser la complexité du réel – ce que promettent aussi à leur manière les récits complotistes. Comme si la lutte des classes, la guerre des sexes, des races ou des générations pouvaient tout expliquer, et donc tout résoudre. Or nous n’assistons à aucune bataille, les lieux de conflit n’existent pas et, au contraire, les signes de rapprochement intergénérationnel s’avèrent plus nombreux que les dérives. Il y a tant de mauvaises nouvelles en France qu’il est dommage de ne pas voir que les générations convergent de plus en plus.
Sur quel plan ?
Elles convergent tant en matière d’entraide que sur le plan des valeurs, qui sont de plus en plus partagées : tous aspirent à avoir un travail épanouissant, une famille d’individus où l’affection prime sur le devoir, et une spiritualité qui ne tombe pas du ciel mais suit un chemin personnel. Ce sont des valeurs plus individualisées que par le passé, mais que toutes les générations ont désormais largement en commun.
Pourquoi alors entretient-on si souvent cette idée de guerre des générations, et avec quels effets ?
Le seul risque véritable, c’est que les politiques prennent cette idée au sérieux et s’engagent dans une politique de Robin des Bois, qui enlèverait aux supposés favorisés pour donner aux prétendus maltraités. En réalité, chaque génération a de bonnes raisons de se croire victime de toutes les autres : les personnes âgées sont furieuses de vivre dans une époque où la vieillesse est ennemie ; les jeunes sont en colère de rencontrer autant d’obstacles dans l’accès à l’autonomie, à travers l’emploi ou le logement ; et les actifs peuvent se sentir écrasés par le double financement des études des jeunes et des retraites des vieux, alors qu’ils sont de moins en moins nombreux. Si on prenait cette analyse au sérieux, ce n’est pas une, mais de nombreuses guerres auxquelles nous devrions assister. Or on ne voit pas cela. Ce qu’on constate, c’est que les vieux se préoccupent généralement des jeunes et du cheminement existentiel difficile auxquels ils sont confrontés. Et que les jeunes ne soutiennent pas l’idée d’une société affranchie des aînés, surtout quand ceux-ci sont leurs grands-parents.
Les liens intergénérationnels sont-ils plus forts que par le passé ?
Je le pense, oui, car ce sont des liens désormais choisis et réfléchis, et non subis. On passe d’une solidarité mécanique, avec une logique de clan, à des liens reposant sur des éléments affectifs, dans lesquels l’attention et la transmission sont parmi les seules planches de salut à notre disposition pour donner du sens à nos vies. Le rapport à la grand-parentalité, notamment, s’est considérablement renforcé dans nos sociétés. C’est devenu un lien d’autant plus structurant qu’il relève de l’affinité élective. Les Français s’inquiètent aujourd’hui d’une détérioration du lien intergénérationnel. J’interprète cette inquiétude comme un signe très positif, qui traduit le caractère précieux de ce lien. Ce n’est pas seulement une contrainte familiale, mais une possibilité à l’égard de laquelle il faut être actif et attentif.
L’irruption de la pandémie, qui a conduit à diviser la population en strates, vient-elle mettre à l’épreuve ce lien ?
C’est incontestablement une épreuve. Et comme dans toutes les crises à travers l’histoire, ce sont d’abord les jeunes qui trinquent. C’était évidemment le cas en temps de guerre : il y a cent ans, on a réellement sacrifié notre jeunesse au nom du bien national. Là, ce n’est pas tout à fait la même chose. Mais il ne s’agit pas non plus de minimiser ce que la jeunesse traverse : on sait qu’il y a des mois clés au cours desquels beaucoup de choses se jouent, dans les rencontres amoureuses ou professionnelles, dans l’accès aux études, à l’emploi… Et quand la société se bloque, c’est infiniment plus douloureux pour la jeunesse. Ce n’est donc pas un choix de société, c’est, hélas, une loi de l’histoire. Mais il y a aussi de quoi ne pas être complètement pessimiste si l’on considère le fait que la période de la jeunesse dure aujourd’hui plus longtemps : ces moments charnières ne sont pas irrémédiablement perdus.
Mais cette jeunesse se sent aussi chargée d’un nouveau fardeau, celui de la crise économique et de la dette financière, qui s’ajoute à une facture écologique lourde à payer. N’est-elle pas en droit d’en vouloir à la génération de ses parents, qui n’a pas eu à affronter de telles difficultés ?
C’est un discours qui a été popularisé par la thèse de Louis Chauvel dans Le Destin des générations. Pour lui, les soixante-huitards appartiennent à une génération bénie, qui a bénéficié de conditions socio-économiques uniques et, à présent, d’une retraite confortable, en bouffant tout sur le dos des deux générations qui l’encadrent. C’est un schéma éclairant car il ouvre un impensé de l’État providence, conçu de façon statique et non dynamique. Mais il est aussi obscurcissant, car il implique l’idée d’une fracture nette, que symbolise une expression comme « OK boomers ! » : on oppose la génération des gentils jeunes écolos à celles des méchants vieux pollueurs. Or ce n’est pas ce qu’on peut voir. En réalité, l’ensemble des générations s’est converti au souci environnemental, cause qui réunit la société plus qu’elle ne la divise. Les comportements (tri, recyclage, changement de consommation…) ont évolué pour tous les âges. Et il n’y a pas davantage de fracture numérique béante puisque, là encore, c’est l’ensemble de la société, toutes générations confondues, qui est passé aux nouvelles technologies. L’apéro zoom fut « intergénérationnel ». Et s’il reste des clivages, ils sont plutôt sociaux ou régionaux.
L’évolution de la démographie, qui donne un poids plus important aux seniors aujourd’hui, peut-elle entretenir un sentiment d’inégalité parmi la jeunesse ?
C’est une position de repli qui peut être intéressante mais, à mon sens, pas tout à fait convaincante, car elle ne prend pas en compte l’évolution même des catégories d’âge. À l’état de nature, il n’y a que deux âges : l’enfance, où on ne peut pas procréer, et l’âge adulte. Les cultures humaines ont inventé deux nouveaux âges : la jeunesse, durant laquelle, quoique apte à procréer, on n’en a pas le droit ; et la vieillesse, un âge protégé. Avec la modernité, l’importance de ces deux âges a crû : l’enfance est de plus en plus brève, la période active est moindre et l’espérance de vie augmente. La vieillesse et la jeunesse sont donc aujourd’hui à la fois plus longues et plus variées, avec des individus aux comportements et aux usages différents. Il est vrai que le poids électoral des personnes âgées est plus important à présent, mais cette « vieillesse » n’est plus la même. Et surtout on aurait tort de croire que celle-ci ne voterait qu’en fonction de ses propres intérêts. Pour les vieux, la jeunesse est une cause importante, qu’il faut défendre. Je ne vois pas d’égoïsme de caste de la part des seniors sur ces enjeux.
Y a-t-il à l’inverse un égoïsme des jeunes ? Ceux-ci ont été beaucoup stigmatisés depuis le début de l’épidémie pour leurs conduites à risque…
Ces conduites ont en réalité été plutôt rares dans l’année écoulée. Bien sûr, chacun peut témoigner qu’une fête s’est tenue près de chez lui. Mais, dans l’ensemble, la jeunesse s’est montrée plutôt attentive au respect des règles. Il y a eu suffisamment peu de rave parties ou de fêtes clandestines pour qu’on en parle dans les journaux – s’il y en avait tout le temps, on cesserait d’en parler ! La jeunesse a fait ce qu’on pouvait attendre d’elle, avec ce qu’il fallait tout de même d’insouciance et de subversion, mais pas plus. Dans le marasme ambiant, cela mérite d’être salué ! La population française râle tout le temps, mais, dans cette crise, elle s’est montrée assez exemplaire.
Y aura-t-il une « génération Covid » ?
Je le crois, oui. On avait tendance, ces dernières années, à mettre du « génération » partout, dès que sortait un film, une série, une innovation technologique, et ce terme devenait un outil marketing. Avec le Covid, on a vraiment affaire à un phénomène générationnel au sens historique, soit le passage à l’âge adulte dans le cadre d’un événement tragique, qui est un marqueur durable. Cela relève d’une expérience commune, universelle.
Et cette expérience commune permet-elle de rapprocher les citoyens ou rend-elle plus difficile nos efforts pour faire société ?
C’est une expérience commune, mais vécue individuellement de façons extrêmement différentes, voire divergentes, avec un versant caricatural. Toutes les crises font ressortir de façon flagrante, voire hideuse, les situations de chacun, notamment les situations de fragilité ou d’insouciance. Celle-ci n’y échappe pas, et il y aura des gagnants et des perdants. Mais les choix de solidarité que nous avons faits, qu’on ne retrouve pas partout dans le monde, sont là pour tenter de limiter les dégâts. L’État s’est montré inefficace sur bien des aspects, il a parfois pris de mauvaises décisions, mais il a au moins montré son utilité concrète : des vies ont été sauvées, « quoi qu’il en coûte ».
Qu’est-ce que cette crise a révélé de l’état de nos sociétés démocratiques ?
On peut noter trois aspects principaux. D’abord, pour ce qui est de la partie décisionnelle, nous nous sommes collectivement montrés très imbus de nous-mêmes, avec une insouciance coupable, par rapport aux démocraties asiatiques, par exemple. On peut l’expliquer par le fait que nous nous étions déshabitués au tragique – ces situations qui obligent toujours à choisir entre une mauvaise et une très mauvaise option. Ensuite, sur le plan de la reddition des comptes – point qui me tient à cœur –, nous ne parvenons pas encore assez bien à tirer les leçons de nos erreurs ou de nos échecs. Rendre des comptes, en démocratie, ce n’est pas mettre les élus en prison, mais comprendre pourquoi il y a eu faillite collective. Or je ne vois pas aujourd’hui quels organismes font ce travail de manière assez poussée, et cela m’inquiète pour l’avenir. Enfin, la société française a témoigné de sa capacité à faire face. On pensait que les égoïsmes allaient se révéler, au lieu de quoi les Gaulois réfractaires se sont serré les coudes sous le bouclier de l’État. C’est un signe positif, fragile certes, mais qu’il faut saluer.
On a pourtant atteint de très hauts niveaux de défiance…
Si la confiance régnait en démocratie, il n’y aurait pas besoin de politique ! La méfiance, elle, est délétère, et il faut s’en garder, car elle détruit la vie commune. Mais il existe un régime de défiance raisonnable, qui mérite d’être entretenu. Je crois que c’est ce que nous observons dans cette crise.
Peut-elle finir par nourrir un ressentiment ?
On ne sait jamais exactement quel type de passion une crise touche de près. On peut imaginer qu’une fois celle-ci passée, on entre dans une période de type « Années folles », où ce n’est pas le ressentiment mais le sentiment de joie et de libération qui va primer. Surtout, contre qui pourrions-nous tourner ce ressentiment ? Il est difficile de haïr un virus. Ou de reprocher aux laboratoires de tirer des fortunes de vaccins qui vont peut-être nous sauver. Si on est de bonne foi, on est contraint de reconnaître qu’on est face à une réalité ambivalente. Et dès lors qu’il y a un doute, il n’y a pas lieu d’avoir de ressentiment.
Propos recueillis par Julien Bisson
« On a affaire à un phénomène générationnel au sens historique »
Pierre-Henri Tavoillot
« Il y a tant de mauvaises nouvelles en France qu’il est dommage de ne pas voir que les générations convergent de plus en plus. » Pour le philosophe, qui a cosigné avec Serge Guérin l’ouvrage La guerre des générations n’aura pas lieu, la crise sanitaire ne remet pas en cause le rapproche…
[Séniorité]
Robert Solé
IL N’Y A PLUS de vieux, et encore moins de vieillards. La France fourmille seulement de personnes âgées, de retraités, d’aînés, d’anciens, de vétérans… Et surtout de seniors, un terme jugé plus moderne, plus valorisant, puisque anglais, bie…
Faire front ensemble
Emmanuel Hirsch
Le 27 janvier, l’association des jeunes gériatres lançait un appel : « Covid-19 : mettons fin à l’épidémie d’âgisme. » La position de ces médecins honore les valeurs de notre démocratie. Ils dénoncent « fermement l’ensemble des déclarations passées et à venir qui introduisent l’idée de discrimina…