Des êtres de bonté
Dans La Faute de l’abbé Mouret, cinquième volume du cycle des Rougon-Macquart, le chef de file du naturalisme dépeint un prêtre aux élans mystiques, Serge Mouret, tiraillé entre sa vocation et son amour naissant pour Albine. C’est au milieu des arbres de la propriété du Paradou que le jeune ecclésiastique s’éveille à la sensualité, dans une atmosphère qui n’est pas sans évoquer le mythe d’Adam et Ève et le paradis terrestre.Temps de lecture : 4 minutes
C’était là certainement que devait se trouver l’arbre tant cherché, dont l’ombre procurait la félicité parfaite. Ils le sentaient proche, au charme qui coulait en eux, avec le demi-jour des hautes voûtes. Les arbres leur semblaient des êtres de bonté, pleins de force, pleins de silence, pleins d’immobilité heureuse. Ils les regardaient un à un, ils les aimaient tous, ils attendaient de leur souveraine tranquillité quelque aveu qui les ferait grandir comme eux, dans la joie d’une vie puissante. Les érables, les frênes, les charmes, les cornouillers, étaient un peuple de colosses, une foule d’une douceur fière, des bonshommes héroïques qui vivaient de paix, lorsque la chute d’un d’entre eux aurait suffi pour blesser et tuer tout un coin du bois. Les ormes avaient des corps énormes, des membres gonflés, engorgés de sève, à peine cachés par les bouquets légers de leurs petites feuilles. Les bouleaux, les aunes, avec leurs blancheurs de fille, cambraient des tailles minces, abandonnaient au vent des chevelures de grandes déesses, déjà à moitié métamorphosées en arbres. Les platanes dressaient des torses réguliers, dont la peau lisse, tatouée de rouge, semblait laisser tomber des plaques de peinture écaillée. Les mélèzes, ainsi qu’une bande barbare, descendaient une pente, drapés dans leurs sayons de verdure tissée, parfumés d’un baume fait de résine et d’encens. Et les chênes étaient rois, les chênes immenses, ramassés carrément sur leur ventre trapu, élargissant des bras dominateurs qui prenaient toute la place au soleil ; arbres titans, foudroyés, renversés dans des poses de lutteurs invaincus, dont les membres épars plantaient à eux seuls une forêt entière. […]
« Où sommes-nous donc ? » demanda Serge.
Albine l’ignorait. Jamais elle n’était venue de ce côté du parc. Ils se trouvaient alors dans un bouquet de cytises et d’acacias, dont les grappes laissaient couler une odeur très douce, presque sucrée.
« Nous voilà perdus, murmura-t-elle avec un rire. Bien sûr, je ne connais pas ces arbres. » […]
Cependant, ils marchaient toujours, d’un pas sans fatigue. Albine ne parlait que pour charmer Serge de la musique de sa voix. Serge obéissait à la moindre pression de la main d’Albine. Ils ignoraient l’un et l’autre où ils passaient, certains d’aller droit où ils voulaient aller. Et, à mesure qu’ils avançaient, le jardin se faisait plus discret, retenait le soupir de ses ombrages, le bavardage de ses eaux, la vie ardente de ses bêtes. Il n’y avait plus qu’un grand silence frissonnant, une attente religieuse.
Alors, instinctivement, Albine et Serge levèrent la tête. En face d’eux était un feuillage colossal. Et, comme ils hésitaient, un chevreuil, qui les regardait de ses beaux yeux doux, sauta d’un bond dans le taillis.
« C’est là », dit Albine.
Elle s’approcha la première, la tête de nouveau tournée, tirant à elle Serge ; puis, ils disparurent derrière le frisson des feuilles remuées, et tout se calma. Ils entraient dans une paix délicieuse.
C’était, au centre, un arbre noyé d’une ombre si épaisse, qu’on ne pouvait en distinguer l’essence. Il avait une taille géante, un tronc qui respirait comme une poitrine, des branches qu’il étendait au loin, pareilles à des membres protecteurs. Il semblait bon, robuste, puissant, fécond ; il était le doyen du jardin, le père de la forêt, l’orgueil des herbes, l’ami du soleil qui se levait et se couchait chaque jour sur sa cime. De sa voûte verte, tombait toute la joie de la création : des odeurs de fleurs, des chants d’oiseaux, des gouttes de lumière, des réveils frais d’aurore, des tiédeurs endormies de crépuscule. Sa sève avait une telle force, qu’elle coulait de son écorce ; elle le baignait d’une buée de fécondation ; elle faisait de lui la virilité même de la terre. Et il suffisait à l’enchantement de la clairière. Les autres arbres, autour de lui, bâtissaient le mur impénétrable qui l’isolait au fond d’un tabernacle de silence et de demi-jour ; il n’y avait là qu’une verdure, sans un coin de ciel, sans une échappée d’horizon, qu’une rotonde, drapée partout de la soie attendrie des feuilles, tendue à terre du velours satiné des mousses. On y entrait comme dans le cristal d’une source, au milieu d’une limpidité verdâtre, nappe d’argent assoupie sous un reflet de roseaux. Couleurs, parfums, sonorités, frissons, tout restait vague, transparent, innomé, pâmé d’un bonheur allant jusqu’à l’évanouissement des choses. Une langueur d’alcôve, une lueur de nuit d’été mourant sur l’épaule nue d’une amoureuse, un balbutiement d’amour à peine distinct, tombant brusquement à un grand spasme muet, traînaient dans l’immobilité des branches, que pas un souffle n’agitait. Solitude nuptiale, toute peuplée d’êtres embrassés, chambre vide, où l’on sentait quelque part, derrière des rideaux tirés, dans un accouplement ardent, la nature assouvie aux bras du soleil. Par moments, les reins de l’arbre craquaient ; ses membres se roidissaient comme ceux d’une femme en couche ; la sueur de vie qui coulait de son écorce pleuvait plus largement sur les gazons d’alentour, exhalant la mollesse d’un désir, noyant l’air d’abandon, pâlissant la clairière d’une jouissance. L’arbre alors défaillait avec son ombre, ses tapis d’herbe, sa ceinture d’épais taillis. Il n’était plus qu’une volupté.
Albine et Serge restaient ravis.
La Faute de l’abbé Mouret, livre deuxième, extraits des chapitres xi et xv


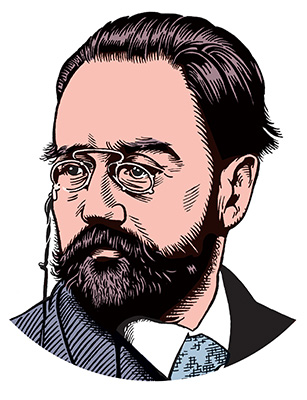
« La feuille est l’usine chimique de l’arbre »
Andrée Corvol
Vous avez consacré toutes vos recherches aux arbres. Comment vous est venue cette passion ?
Durant mon enfance, j’ai passé tous mes week-ends et toutes mes vacances en face de la forêt de Fontainebleau, à Bois-le-Roi. Dans ma jeunesse, j’y séjournais plus longtemps, particulière…
Replanter, disent-ils…
Claude Garcia
La déforestation est aussi ancienne que la civilisation. La preuve ? Prenons l’épopée de Gilgamesh, le plus ancien récit é…
Pando, la forêt d’un seul arbre
Manon Paulic
UTAH (États-Unis). On dit de lui qu’il est l’un des plus vieux organismes vivants de notre planète. Il est sans nul doute le plus massif jamais découvert. Partir à sa rencontre implique de prendre la…







