Immersion au quartier général de la folie
Temps de lecture : 21 minutes
[Grands reportages 4/5] Cet été, le 1 ouvre ses archives en sélectionnant un thème par semaine. Journaliste et auteur de Flic, un journaliste a infiltré la police aux éditions Goutte d’or, Valentin Gendrot revient dans ce récit sur ses quinze mois en immersion aux urgences psychiatriques de la préfecture de police de Paris.
– Vous m'avez niqué ma journée, mon après-midi. Allez vous faire enculer, vous !
Affalé sur le sol, la voix rauque et étouffée, un homme menotté insulte des flics. Lui et quatre policiers viennent d'arriver au deuxième étage. Les agents restent là, plantés devant l'ascenseur, au milieu du couloir, un regard vigilant sur leur homme.
– Vous êtes M. Moreira*, c'est ça ? questionne un infirmier antillais.
Sur sa blouse blanche, un logo brodé en rouge et bleu et ces deux lettres : « PP », pour préfecture de police.
– Ouais, c'est moi, grommelle le type. Eux, là, ils sont méchants avec moi. Ils m'traînent comme ça, ces enculés.
L'infirmier le laisse parler seul, il lit en diagonale des papiers tendus par le plus gradé des policiers. Tout semble en règle. Je scrute ce Moreira, un homme brun aux cheveux et aux vêtements sales. Il lui manque une chaussure, laissant apparaître des orteils noirs de crasse.
– Écoutez-moi, reprend l'infirmier. Là, vous êtes agité. On va vous attacher pieds et mains, avec une ceinture de contention, c'est beaucoup plus confortable que les menottes.
– Vous savez quoi ? Jamais !
– Si vous êtes calme, on vous détachera. Si vous vous énervez, on sera obligés de vous attacher sur le lit. Et aussi de vous faire des piqûres. D’accord ?
Les policiers lui retirent les menottes. Aussitôt, les surveillants, ces gros bras en blouse bleue chargés de la sécurité des lieux, passent à Moreira une ceinture de contention. En cuir blanc, elle relie le buste aux avant-bras, empêchant ainsi toute tentative désespérée de se débattre ou de porter des coups. Un acte médical.
– Monsieur, dès que vous serez en chambre, nous pourrons parler, explique l’infirmier à Moreira.
Sur la droite de l’ascenseur, une porte battante. Derrière, les seize chambres des patients. Des piaules individuelles, doubles ou triples, particulières. Les lits y sont fixés au sol et les portes fermées de l’extérieur. Si un patient souhaite aller aux toilettes, il doit frapper sur la porte ; un surveillant lui ouvrira. Ces chambres vétustes aux couleurs criardes, alternance de bordeaux et de jaune, fleurent les années 1970. Des travaux sont prévus.
« Au début, j’avais peur de mes rencontres avec ces "fous". Je vivais avec l’image convenue d’un homme aux cheveux hirsutes, les yeux injectés de sang, prêt à tuer »
Journaliste, je voulais infiltrer la police et raconter le quotidien d’un flic dans un arrondissement populaire parisien. Sauf que mon plan de vol a connu un sérieux accroc. En sortant des trois mois d’école obligatoires, ma première affectation de policier contractuel m’a conduit ici. À l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, au deuxième étage sécurisé du 3 de la rue Cabanis, dans le XIVe arrondissement. Dans le jargon, on parle de l’I3P. Les urgences psychiatriques réservées à la police parisienne.

Chaque jour, dans ce quartier général de la folie, je vois défiler des Stéphane Moreira et d’autres histoires de la psychiatrie ordinaire. Au début, j’avais peur de mes rencontres avec ces « fous ». Je vivais avec l’image convenue d’un homme aux cheveux hirsutes, les yeux injectés de sang, prêt à tuer. Un fou, dangereux et meurtrier. Loin des stéréotypes collectifs, la réalité dévoilée chaque jour dans sa nudité la plus crue est tout autre. Si 2 % des patients ont déjà tué, l’immense majorité vit en marge, tels des laissés-pour-compte en souffrance. Des migrants, des SDF en perdition, tous interpellés par des policiers parisiens avant d’arriver ici en raison de troubles du comportement apparents. Ils sont placés en observation dans la structure pour une durée maximale de deux jours. En moyenne, ils n’y restent qu’une vingtaine d’heures.
Demain, Moreira sera examiné par un psychiatre. Ces rendez-vous ont lieu le matin, entre 8 heures et 13 heures. À charge pour le praticien de décider s’il doit l’hospitaliser. Sur les 2 000 personnes admises en moyenne chaque année, 55 % vont en HP, le plus souvent sans consentement. Elles sont hospitalisées de force. Motif : ces personnes présentent un danger imminent pour elles-mêmes ou pour les autres. En cas de non-hospitalisation, elles ressortent libres ou retournent en garde à vue dans leur commissariat d’envoi. Elles y seront poursuivies pour les motifs de l’interpellation.
« La culture du secret reste inhérente à l’histoire de l’I3P »
Les 1 100 patients hospitalisés de l’I3P vers des HP représentent une goutte d’eau dans l’océan psychiatrique français. Chaque année, entre 80 000 et 100 000 personnes sont hospitalisées sans consentement. Et quatre à cinq fois plus vont à l’hôpital volontairement.
Ces chiffres en tête, je me faufile jusqu’aux policiers et les questionne. Je viens aux nouvelles, l’air de rien. Je fais mon curieux, bien que mon rôle ne soit pas de m’enquérir de ces patients. Moi, je suis le chauffeur, celui qui transfère en ambulance les patients lorsqu’ils doivent être hospitalisés. C’est mon job de policier contractuel.
– Il a fait quoi ?
– Le bazar aux Restos du cœur. Il a commencé à agresser des gens, c’est eux qui nous ont appelés, répond une policière.
– Il est fou, vous pensez ?
– On a essayé de parler un peu avec lui. Il a dit qu’il était schizophrène. En tout cas, il a des sautes d’humeur. On le connaît, c’est un SDF. On le reverra sûrement dans quelques jours ou dans quelques semaines. Même s’ils l’envoient en hospitalisation, il reviendra…
– C’est bon pour nous, tranche l’infirmier.
Le signal du départ pour les policiers. Les quatre de la patrouille remontent dans l’ascenseur pour retrouver leur véhicule stationné en bas, dans le sas de l’entrée. Juste à côté de mon ambulance.
Je retourne m’asseoir dans la salle de repos. Il n’est que 13 h 30. Je passe une grande partie de mes journées à poireauter, sur un de ces fauteuils noirs. Les transferts de patients n’auront lieu que dans l’après-midi. Avant, il faut attendre. Albert, un surveillant, s’assoit à son tour.
– Une fois, une journaliste a essayé d’entrer ici. Elle a pas tenu deux minutes ! Comment on l’a dégagée mon gars…
Il dit ça d’un air ravi, sans savoir qu’à côté de lui, un autre journaliste, arrivé là par hasard, termine sa tasse de café tiède.
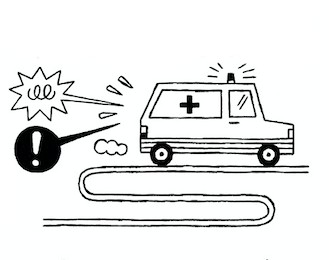 La culture du secret reste inhérente à l’histoire de l’I3P. Pour le secret médical encadrant chaque admission, mais aussi pour la méconnaissance du lieu par le grand public. L’I3P forme depuis la seconde partie du xixe siècle, un État dans l’État psychiatrique parisien. Une institution insulaire et salutaire pour la préfecture de police ; une structure où règne l’arbitraire pour ses détracteurs. On y enfermerait des gens sans leur consentement comme les rois embastillaient jadis des opposants politiques. Les critiques affluent. Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des patients et ex-patients en psychiatrie (Fnapsy), déclarait qu’il est « plus que temps d’en finir avec ce système dérogatoire qui s’apparente aux lettres de cachet ». D’autres, comme le Dr Serge Blisko, ancien député-maire du XIIIe arrondissement, qualifie la structure de « système psychiatro-policier ».
La culture du secret reste inhérente à l’histoire de l’I3P. Pour le secret médical encadrant chaque admission, mais aussi pour la méconnaissance du lieu par le grand public. L’I3P forme depuis la seconde partie du xixe siècle, un État dans l’État psychiatrique parisien. Une institution insulaire et salutaire pour la préfecture de police ; une structure où règne l’arbitraire pour ses détracteurs. On y enfermerait des gens sans leur consentement comme les rois embastillaient jadis des opposants politiques. Les critiques affluent. Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des patients et ex-patients en psychiatrie (Fnapsy), déclarait qu’il est « plus que temps d’en finir avec ce système dérogatoire qui s’apparente aux lettres de cachet ». D’autres, comme le Dr Serge Blisko, ancien député-maire du XIIIe arrondissement, qualifie la structure de « système psychiatro-policier ».
En 2011, le contrôleur général des lieux de privation de liberté pointait la « confusion » entourant ce lieu unique en Europe, et recommandait au gouvernement de transférer cette « infirmerie psychiatrique » dans la corbeille du « dispositif hospitalier de droit commun ». En clair, il préconisait la fermeture de la structure. Un avis consultatif renouvelé en 2019, resté lettre morte.
Dans la salle de repos, Gael, l’infirmier antillais tient un tout autre discours :
– L’I3P, c’est un truc qui nous est jalousé. Quand t’as un toto comme Moreira qui arrive, faut trouver le personnel qui va maîtriser le mec, qui va ensuite l’emmener. C’est tout un merdier. Et puis, ici, on a le savoir-faire. Faut être clair, y’a pas photo quoi.
Je le coupe :
– Mais vous avez quel statut ici ? Vous êtes préfecture de police ?
– Et on est payé par la Ville de Paris. Ce qui gratte le cul de la maire de Paris, parce qu’elle ne supporte pas l’I3P. Elle n’a aucun pouvoir puisqu’il y a un préfet de police.
Un surveillant embraye, comme pour planter un clou supplémentaire sur le statut inconfortable de la structure.
– Ici, le terrain appartient à Sainte-Anne, mais le bâtiment est à la préfecture de police. Et Sainte-Anne aimerait le récupérer parce que l’I3P, c’est une petite verrue pour eux. C’est un vieux bâtiment tout pourrave et moche, et eux, ils sont en train de tout refaire.
« Dans leurs discussions, les soignants n’évoquent pas les droits des patients admis dans la structure »
J’ai déjà entendu parler de cette histoire, et de ce conflit qui oppose l’hôpital psychiatrique voisin et l’I3P. Depuis de nombreuses années, la direction de Sainte-Anne souhaite installer à la place de l’infirmerie un établissement pour handicapés mentaux.
Dans leurs discussions, les soignants n’évoquent pas les droits des patients admis dans la structure. La possibilité notamment de recevoir les conseils d’un avocat. Depuis mon arrivée, je n’ai jamais vu une robe noire dans le couloir. D’ailleurs, il m’arrive d’attendre dans le bureau qui leur est, en théorie, réservé.
Infirmiers et surveillants ne parlent pas non plus de ce doublon, l’existence d’un autre service d’urgences psy. Le Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil, connu sous le nom de CPOA. Au 1 de la rue Cabanis, c’est-à-dire de l’autre côté du mur d’enceinte, dans l’hôpital Sainte-Anne. Deux services peu ou prou identiques à quelques mètres d’intervalle.
Un surveillant refait du café, tandis qu’un autre patient tambourine sur sa porte. Il hurle.
– Vous êtes des traîtres ! Vous êtes des traîtres !
Omar est arrivé la veille, il vient de Guinée.
– Vous m’avez trahi !
Ses cheveux blonds décolorés apparaissent à travers le hublot incassable de la porte. Un bruit de métal sourd dans le couloir. Trois surveillants ouvrent la porte. Omar ne se calme pas, il tourne en rond.
– Monsieur, arrêtez de taper, vous allez vous faire mal à la main. On va être obligés de vous attacher, prévient une infirmière.
– Je m’en fous ! Attachez-moi ! Vous êtes des traîtres !
Je m’approche, dissimulé dans l’embrasure de la porte. De mon poste d’observation, je ne distingue que le corps longiligne du jeune homme désormais debout sur son lit. Sur les murs bleus délavés, d’autres patients ont gravé des inscriptions énigmatiques. Un soleil aux nombreux rayons, des prénoms. Omar n’a pas touché à son plateau-repas. Autour, un vide immense emplit la chambre froide.
– Je vais seulement vous insulter ! Seulement ! éructe encore Omar.
– Il poursuivait des gens avec un bâton dans la rue, dit l’infirmière. Là-haut, c’est un peu grillé. Le crack, ça aide pas. On va lui donner un truc bien pour qu’il se détende. Un Valium, dix gouttes.
« Bientôt, l’homme cesse de hurler, sans doute un peu cassé par le traitement reçu »
Omar reste muré dans sa colère. Le psychiatre vient de trancher, le Guinéen ne sera pas hospitalisé. Bientôt, trois flics viendront le chercher et le renverront en garde à vue. Il sera poursuivi pour consommation de crack et tentative d’agression.
Il est attaché de force sur son lit par les surveillants. La porte de sa chambre s’est refermée. Bientôt, l’homme cesse de hurler, sans doute un peu cassé par le traitement reçu. Les infirmiers et les surveillants retournent s’asseoir dans la salle de repos. Ils ratiocinent encore.
– Tu sais, les fous, c’est ce qui fait le plus peur, explique une soignante. On se disait qu’il fallait les envoyer à la campagne, les mettre au vert. On disait qu’il fallait les sortir des villes. Maintenant, ça a changé. Ils ont créé des services en ville et…
– Ouais, sauf que c’est pas adapté, coupe un autre. Tu regardes, Henri-Ey, c’est une ancienne clinique du sport.
– Et Hauteville, dans le Xe, c’est un ancien hôtel particulier, oui, t’as raison.
La nouvelle politique psychiatrique initiée à l’aube des années 2000 visait à rapprocher le patient de son domicile, à le reconnecter à la société et non plus à le cacher. Hauteville, Avron, Lasalle et d’autres encore sont devenus des hôpitaux psychiatriques en plein Paris. Au milieu de ces évolutions, l’inamovible I3P, hermétique aux changements structurels comme à la fusion de ces différents hôpitaux en un seul groupe.
– À l’I3P, les premiers surveillants, c’étaient des forts des Halles, rappelle un surveillant. Quand ils ont fermé les Halles de Paris, y’avaient beaucoup de costauds qui soulevaient des gros morceaux de viande. Ils sont venus ici et y’avait beaucoup de cas de maltraitance. Des patients se faisaient frapper, prenaient des coups. Ça a mieux évolué quand même, parce que…
– Ça, c’était y’a vingt ou trente ans ! coupe un infirmier. Les mecs, ils étaient pas formés pour bosser ici. Dans ma carrière, c’est arrivé qu’on torde les couilles à un patient parce qu’on arrivait pas à l’attacher. C’est bien, les couilles, parce que ça ne se voit pas. La maltraitance, c’est quand tu vas mettre des claques à un patient qui est déjà attaché. Ou quand tu vas le traiter de bicot. Ça n’existe pas ici.
– L’âge d’or, c’était les années 1980, reprend un surveillant. Depuis, ils ont fermé des lits, enlevé du personnel. Quand tu arrives dans un hôpital, tu le vois bien, les filles, elles courent.
– Oui, c’est ça, reprend un autre. Quand t’as un patient qui arrive, c’est celui qui est le moins en crise qui sort.
Le volume sonore est trop élevé. Tout le monde a un avis, personne ne s’écoute. Je pars à la recherche d’un peu de calme et traverse le couloir. À l’autre bout, des secrétaires remplissent la paperasse pour les hospitalisations des patients. Je serre la main de Bruno, le chef du service. Nos discussions alternent le plus souvent entre le match de foot de la veille et les patients admis à l’I3P. Il me chambre.
– Dis donc, pas terrible les Rennais hier soir.
– Roh, ça va…
– Tu l’as vu passer le petit rouquin, ce matin ? T’étais pas encore arrivé, je crois. Ils l’ont ramené dans sa chambre, ils étaient quatre sur lui…
– Ah oui, quand même.
– Je pense que tu vas avoir du travail, s’amuse-t-il, en me taquinant.
Le rouquin en question va être hospitalisé dans l’après-midi. Avant, il faudra encore attendre. Bruno me laisse jeter un œil. Chaque admission est consignée dans un dossier. Pour éviter tout piratage informatique, il n’existe que sous format papier. Ils sont compilés dans un bureau, dans la partie administrative du couloir. Je lis le procès-verbal et la note de synthèse médicale du dossier en question. Je pose un œil voyeur sur cette vie qui m’est inconnue.
« Lorsqu’il arrive à l’I3P, au petit matin, il doit enfiler le pyjama bleu ciel de rigueur. Ses chaussures, son pantalon, le reste de ses vêtements et la monnaie contenue dans son portefeuille sont placés au coffre »
Un soir d’été, un homme pénètre dans un immeuble parisien, rue du Jura, dans le XIIIe arrondissement. Il sait où aller, ne se trompe pas de porte. À 4 heures du matin, il frappe, avec ses poings, ses pieds, et pénètre de force à l’intérieur de l’appartement. Dans la cuisine, l’homme s’empare d’un couteau. Il menace de mort la locataire des lieux à plusieurs reprises. Il est agité, change de pièce, s’empare à nouveau du couteau. Le repose. Le reprend. La jeune femme prétexte une envie d’aller aux toilettes. Par ruse, elle parvient à quitter son logement et à enfermer son agresseur à l’intérieur. Libérée, elle appelle la police. Un hématome s’est formé sous son œil gauche à la suite du choc de la porte contre son visage. Elle a reconnu son agresseur.
Florian Khaoui est son ex. Il est roux et porte des vêtements bleus. À 5 h 43, trois patrouilles de police débarquent. Khaoui est interpellé. Il est menotté et placé en garde à vue pour violence avec arme sur son ex-compagne. La jeune femme souhaite déposer plainte. Khaoui indique aux policiers qu’il a sniffé de la coke, pris de l’ecstasy et fumé du shit ces derniers jours.
Les policiers procèdent aux habituelles vérifications. L’agresseur, étudiant en fac de géographie, ne figure pas au fichier des personnes recherchées. En garde à vue, il tente d’ouvrir une fenêtre puis frappe un policier avant d’essayer de sortir de sa cellule. Il est finalement maîtrisé. Khaoui est conduit à l’Hôtel-Dieu, aux UMJ, les unités médico-judiciaires, pour un examen de comportement. Il s’explique pour la première fois devant un psychiatre. Le clinicien constate que l’homme en face de lui tient des propos délirants de persécution. « Les gens me regardent bizarrement. Des hommes en voitures noires me suivent dans la rue. Les voisins font des bruits bizarres », explique-t-il.
Je découvre ces explications en lisant une autre pièce du dossier Khaoui, la fiche de synthèse médicale. L’étudiant parle de son ex. Il dit qu’elle « voit des hommes ». « Jaloux, c’était pour lui faire peur. »
Lorsqu’il arrive à l’I3P, au petit matin, il doit enfiler le pyjama bleu ciel de rigueur. Ses chaussures, son pantalon, le reste de ses vêtements et la monnaie contenue dans son portefeuille sont placés au coffre. Comme Omar, Khaoui est conduit dans une chambre individuelle. Le sort réservé à ceux qui semblent le plus dangereux.
Le jeune homme a un passé psychiatrique déjà lourd et connu. Il a été hospitalisé pour une crise paranoïaque. Une autre fois, il a voulu prendre l’avion pour la Norvège pour échapper à un sentiment de persécution. Il n’avait pas de billet.
Les médecins appellent cela un « voyage pathologique ». Khaoui reconnaît prendre irrégulièrement son traitement : 250 mg d’Abilify par mois, un neuroleptique utilisé dans le traitement de la schizophrénie. Dans sa chambre, il est surpris en train de se masturber. Une infirmière lui demande d’arrêter. Il refuse.
– Je suis un homme, je me branle si je veux et quand je veux.
Les soignants estiment qu’il peut être violent, alors Khaoui est attaché sur son lit. Il hurle. L’entretien avec le psychiatre de l’I3P se passe mal. Les surveillants le ramènent dans sa chambre par la force.
Dans son rapport, le médecin note « une agitation après l’annonce d’hospitalisation. Une désinhibition et un comportement masturbatoire inadapté. Une toute-puissance et une attitude menaçante nécessitant une contention et l’administration d’un traitement injectable ».
Seul dans sa chambre, Khaoui est donc sédaté, attaché sur son lit dans l’attente d’une hospitalisation. Quand le dossier sera prêt.
– Tu as terminé ta lecture, c’est bon ? On va fumer ? J’ai un peu de temps, dit Bruno.
J’acquiesce.
Encore un bruit, plus loin, dans le couloir. Devant les portes de l’ascenseur, un nouveau patient encadré par une autre patrouille de police. Une vieille dame chante, un sourire radieux aux lèvres.
– En amour, il faut toujours un perdant, j’ai eu la chance de gagner souvent…
La scène m’amuse. Parfois je ris, toujours au détriment des patients. Cette fois, je ne cherche pas à savoir pourquoi cette femme est admise ici. J’ai mieux à faire, tuer le temps en fumant avec Bruno, que je chambre à mon tour.
– La vieille, là, elle chante du Julio Iglesias, non ? Ça va te rappeler ta jeunesse, ça… Quand tu étais encore fringant !
Bruno rigole, comme un petit gloussement.
– Au fait, t’es déjà allé aux archives ?
– De quoi ? Celles d’ici ? Non, jamais !
– Alors, avant d’aller fumer, tu vas venir avec moi, j’ai un dossier à ranger. Tu vas m’aider, y’a un de ces bordels en bas.
Au sous-sol, au détour d’un couloir lugubre et sombre rendu plus froid encore par le béton gris, Bruno pousse une lourde porte en fer. Derrière, un amoncellement de dossiers jaunis, de cartons entassés. Je plonge ma main dans le premier dossier entraperçu. Celui d’un patient admis à l’I3P dans les années 1940. Un mot est écrit à côté de son nom : « Débile ». Les dates de naissance, écrites en grosses lettres gothiques, indiquent que beaucoup de ces gens ne sont plus en vie. Les dossiers appartiennent dans leur grande majorité définitivement au passé.
« Les traitements infligés aux patients durant des décennies s’apparentaient à du bricolage : saignées, électrochocs, opium, morphine, bains d’eau tiède »
Je me remémore sur le moment ces lectures faites à la Bibliothèque nationale François-Mitterrand, sur mes jours de repos. Les traitements infligés aux patients durant des décennies s’apparentaient à du bricolage : saignées, électrochocs, opium, morphine, bains d’eau tiède. Les neuroleptiques, introduits dans les années 1950, et les contentions chimiques et physiques ont systématisé les soins.
– Un jour, un historien mettra peut-être son nez là-dedans, dit Bruno en refermant la porte.
J’ai bien envie de lui répondre que le sujet m’intéresse. Je dois rester à ma place, celle de chauffeur, pas de journaliste.
« Comment guérir ou se sentir mieux dans un environnement si dégradé et triste ? On me répond souvent que les patients, eux, n’y prêtent pas attention »
Les premiers transferts débutent au milieu de l’après-midi. Je commence ma journée de travail. Si je me dépêche, je pourrai partir à 18 heures, le plus tôt possible. L’ascenseur descend du deuxième étage du bâtiment vers le rez-de-chaussée. Les patients attachés ne parlent pas. L’un d’eux, ensuqué par les neuroleptiques, s’endormirait presque sur l’épaule de Carl, un surveillant bien charpenté.
En bas, j’ouvre les portes de l’ambulance. Je plie les sièges de la C8, j’ouvre le coffre. Les patients sont assis à l’arrière. Un infirmier, un surveillant au milieu et moi, derrière le volant. Je lance l’application Waze, arrivée prévue dans vingt-quatre minutes. Ça bouchonne un peu sur la route. Direction l’hôpital Saint-Maurice, en bordure est de Paris.
– J’aime bien ces petites sorties, ça rompt un peu la monotonie des journées, s’amuse Carl, en prenant place dans l’ambulance.
Je me contente de sourire.
– Avant, quand on débarquait dans les hôpitaux, ils nous appelaient les cow-boys, explique le surveillant.
– Pourquoi ?
– On arrivait avec un pare-soleil « police », le gyrophare, et puis on venait toujours avec les pires cas. Ils avaient peur de ce qu’on leur ramenait ! En même temps, c’est encore le cas…
Carl s’amuse de cette anecdote, alors qu’à l’arrière, le silence règne. Tout le monde roupille.
– Et y’a d’autres choses comme ça qui ont changé ? dis-je, pour relancer la conversation.
– Quand j’ai commencé, on traitait les patients à l’Haldol, raconte l’infirmier. Certains avaient 900 gouttes par jour. Ils étaient shootés. Aujourd’hui, quand je vois les petites doses qu’on leur donne, je rigole.
Après quelques slaloms sur la route, je gare le C8 sur le parking de l’hôpital, au plus près du pavillon psychiatrique indiqué. L’infirmier et le surveillant se lèvent et emmènent un des deux patients. Je reste avec l’autre. Je n’entre jamais dans les hôpitaux psychiatriques, sauf quand il s’agit de trimbaler plusieurs valises. J’y observe avec constance le délabrement des locaux. Comment guérir ou se sentir mieux dans un environnement si dégradé et triste ? On me répond souvent que les patients, eux, n’y prêtent pas attention.
Dans l’ambulance, j’attends le retour des deux soignants. Parfois, je bouquine ou je discute avec le patient. Celui qui vient de se réveiller est un homme d’une soixantaine d’années.
– Bonne année ! me lâche l’homme, assis au fond de l’ambulance.
Il a six mois de retard, ce n’est plus le moment pour transmettre ses vœux, mais à quoi bon.
– Bonne année, monsieur.
– Ben, si c’est comme ça, je divorce… Avant, j’avais une Renault 25 Courchevel. Bonne année !
Il se rendort, aussi vite qu’il venait de se réveiller. À quelques mètres de là, j’observe une infirmière. Elle fume une cigarette à la va-vite, un œil sur sa montre. Je marche à sa rencontre, tout en fermant les portes de l’ambulance. Elle s’appelle Valérie et garde le sourire malgré un stress évident. Elle rigole un peu moins quand il s’agit de parler de son métier et de ses conditions de travail.
– Dans le service, aujourd’hui, on est deux femmes pour vingt-quatre patients. Alors, on court, on court et on ne fait plus vraiment notre boulot.
Valérie en vient rapidement à parler de maltraitance. Pour elle, la solution la plus rapide pour parer aux crises d’un patient reste la piqûre, la contention chimique.
– Je vous laisse, j’ai ma collègue qui m’appelle, dit-elle abruptement.
La discussion s’arrête, bien trop furtive. J’aurais aimé en savoir plus sur la déliquescence des conditions de travail et d’accueil dans les HP, entamée à l’aube des années 1980. Jacques Barrot, alors ministre de la Santé, annonçait sa décision de supprimer 40 000 lits dans les services psychiatriques. Les débuts actés de l’hôpital entreprise. Aujourd’hui, les patients suivis en psychiatrie le sont le plus souvent en dehors de l’hôpital. Dans les CMP, les centres médico-psychologiques, par exemple.
Les soignants et les surveillants de l’I3P ne connaissent pas vraiment cette situation. Peu importe le nombre de personnes admises – entre zéro et seize –, trois infirmiers et trois surveillants au moins y travaillent chaque jour. Quant au budget alloué pour le fonctionnement de la structure, il reste stable : 3 millions d’euros par an. L’I3P n’a pas non plus à supporter le coût d’une hospitalisation. Environ 600 euros par jour et par patient.
« Pour prendre le moindre risque et pour la quiétude du transfert, il préfère inoculer une dose supplémentaire de neuroleptique »
L’attente devant l’hôpital est courte, moins de quinze minutes. On doit rentrer rue Cabanis pour effectuer le dernier transfert de la journée. Je vais terminer tôt. Un homme de 34 ans, originaire de Douala, au Cameroun, a tenté de voler une camionnette avec une petite cuiller. Devant son discours incohérent, entre la dénonciation d’un complot juif, l’affaire Théo et le raid terroriste du Bataclan, le psychiatre a pris la décision de l’hospitalisation. Il ira à Bichat, porte de Saint-Ouen. Dans l’ambulance, l’homme parle beaucoup, bien qu’il reste calme.
– Pourquoi ici ? J’ai carte Vitale, j’ai carte Navigo. J’ai toute chose. Y’a pas le droit en France. Pourquoi ? Moi, un homme, suis pas une femme.
L’infirmier m’interdit de démarrer le C8. Il trouve l’homme trop agité. Pour prendre le moindre risque et pour la quiétude du transfert, il préfère inoculer une dose supplémentaire de neuroleptique. Objectif, le « tasser », pour reprendre un terme que j’entends souvent.
L’infirmier remonte au deuxième étage, demande une prescription médicale en urgence au médecin de garde et redescend, neuroleptique en main, quelques instants plus tard.
– Monsieur, essayez de boire ça, lâche le soignant, essoufflé.
– Pourquoi ?
– C’est pour vous détendre, monsieur.
– Moi suis pas malade. Pourquoi ici ?
L’infirmier se tourne vers le surveillant et moi. Il nous parle à voix basse.
– J’le pique dans la cuisse, les gars, on va pas s’emmerder.
– C’est délicat. Généralement, on monte là-haut quand on fait ça, tranche le surveillant.
J’assiste, muet, à une piqûre au cul de l’ambulance. Je ne suis qu’un flic contractuel devenu chauffeur à l’I3P, mon avis ne compte pas.
Le patient remonte dans la bagnole, s’assoit sur son siège. Le surveillant lui attache sa ceinture de sécurité. Je tourne la clé de contact. Le moteur démarre. L’ambulance peut partir pour Bichat.
* Les noms des personnes ont été modifiés.
Illustrations JOCHEN GERNER
« Les psychiatres ont l’habitude d’être des sous-mariniers de la société »
Raphaël Gaillard
« Une catégorie de patients a émergé, que nous ne connaissions pas, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas à ce jour inscrits dans un parcours de soins : des personnes qui étaient en relative souffrance mais compensaient, et qui dans ce contexte d’angoisse générale, ont décompensé et ont nécessité des…
[Folie]
Robert Solé
ON LES APPELAIT les fous. Ils faisaient rire, mais surtout très peur. Leur état ne pouvait avoir qu’une cause démoniaque et nécessitait donc une forme d’exorcisme. Quand les médecins se sont emparés du problème, c’était encore avec l’idée d’extirper du corps le mal qui l’habitait : saignées, vomi…
Immersion au quartier général de la folie
Valentin Gendrot
Auteur de Flic, un journaliste a infiltré la police aux éditions Goutte d’or, Valentin Gendrot revient dans le récit que nous publions sur sa première affectation aux urgences psychiatriques de la préfecture de police de Paris où il a passé quinze mois, et nous livre ainsi une plongée da…








