De quelle jeunesse parle-t-on quand on évoque les 18-29 ans ?
Les catégories statistiques sont des artefacts complets. Elles sont le produit d’un arbitraire réfléchi. Le premier critère arbitraire, c’est l’âge légal, 18 ans, censé indiquer une autonomie, une mobilité liée aux études, avec des impacts sur les pratiques culturelles. Mais cette limite est abstraite : on ne change pas du jour au lendemain.
Quant à la limite supérieure de cette tranche d’âge, 29 ans, elle a beaucoup évolué. On a longtemps considéré que la sortie de la jeunesse tenait à trois moments : la décohabitation du domicile parental, la mise en conjugalité et l’entrée sur le marché du travail. Si dans les années 1960, ces trois événements étaient quasi simultanés, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pour différentes raisons, dont l’allongement de la durée moyenne des études et les difficultés de l’entrée sur le marché du travail, le temps de la jeunesse s’est allongé.
Dans cette période de 18 à 29 ans, on observe ainsi des situations radicalement différentes, avec des jeunes qui n’ont pas le même rapport à la culture.
La question du prix reste-t-elle un obstacle à la culture ?
Objectivement, oui, et depuis toujours. Ce qui est particulier, c’est la perception très française du prix de la culture. Au moment de l’instauration des dimanches gratuits, le Louvre a fait une campagne de pub avec ce slogan : « Ce qui est gratuit n’a pas de prix », qui disait que la culture est un bien commun, d’où une réticence à la payer.
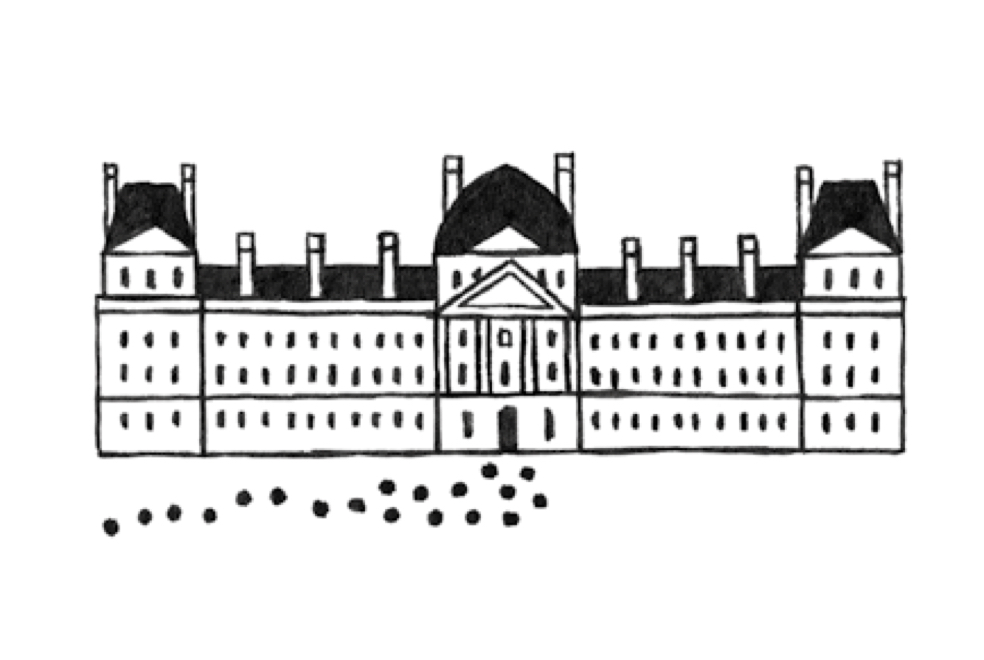
La nouveauté, c’est le fort développement du gratuit ou du prépaiement par abonnement (comme sur les plateformes de streaming Deezer ou Netflix). Cela donne l’impression que consommer devient gratuit, puisque la notion de paiement à l’acte disparaît… À cela s’ajoute le vrai gratuit : les échanges de pair à pair, sur YouTube par exemple, ont transformé le rapport à la culture et aux contenus culturels. Le cumul de ces deux phénomènes, dans une période de forte tension sur le pouvoir d’achat, remet sur le devant de la scène la question de la gratuité.
Le pass culture a-t-il modifié les pratiques ?
Il a permis à des jeunes d’acheter des produits qu’ils n’achèteraient pas sans ce coup de pouce financier, comme les mangas – des produits qu’ils apprécient beaucoup mais qui sont relativement « chers » pour leurs bourses. Ce n’est pas un hasard si ce type de bande dessinée d’origine japonaise arrive en tête des achats réalisés grâce au pass. Mais celui-ci a également eu des effets sur les sorties culturelles. On peut désormais inviter un copain ou une copine. Comme on sait que la sociabilité a une place plus importante dans les dynamiques de sorties culturelles, notamment quand on est jeune, ça marche très bien. Les débats autour du pass révèlent néanmoins la tension, ancienne dans le secteur culturel, entre le soutien à la demande – le consommateur – et le soutien à l’offre – le producteur ou l’artiste.
Qu’ont apporté les nouvelles technologies à nos manières de consommer la culture ? Les ont-elles transformées ?
Elles ont changé beaucoup de choses. La première, c’est que tout passe par cet objet mobile et interstitiel qu’est le smartphone. La manière dont vous consommez la culture se fait donc dans les transports et par petites séquences temporelles, d’où la réduction des formats. On voit apparaître des séries de 20 minutes et les vidéos très brèves diffusées sur Tik Tok suscitent un fort engouement. Le format attentionnel s’est réduit, ce qui a des impacts majeurs sur la création. Les Webtoons, ces mangas coréens qui se lisent sur smartphone, ne sont pas écrits de la même manière que les BD classiques, car on les « scrolle », on les fait dérouler sur l’écran. Il faut donc découper la narration de manière différente. Ce qui a un impact majeur sur l’ensemble des comics, car ces formats non seulement prennent des parts de marché énormes, mais inventent de nouveaux schémas narratifs.
Avec Internet, la frontière entre l’auteur, le commentateur, le récepteur et le consommateur devient plus floue
Le deuxième impact, c’est qu’avec Internet, la frontière entre l’auteur, le commentateur, le récepteur et le consommateur devient plus floue. On a assisté à une transformation complète du rapport à la culture, aux contenus culturels, aux objets culturels, aux créateurs, aux médiateurs et aux gatekeepers habituels (les instances qui, comme l’école et les institutions culturelles, disent ce qui est bon et établissent des recommandations culturelles). Tout le monde peut faire sa petite vidéo, la poster et avoir l’impression qu’il ou elle fait partie du monde des créateurs. Le numérique a donné des outils de production et de création quasi professionnels à la prise en main facilitée : faire des photos ou des vidéos, des montages audiovisuels est possible avec un simple smartphone. Le niveau d’expertise des jeunes a considérablement augmenté.
Ces technologies permettent aussi de mobiliser les jeunes ?
Oui ! Ce qui s’est passé autour du boys band coréen BTS au moment de l’élection de Trump, est phénoménal. Trump étant à l’opposé de leurs valeurs antiracistes, le groupe a utilisé son savoir-faire d’auto-organisation pour court-circuiter l’un de ses meetings phares. Malgré sa communication monstre, la salle était vide à son arrivée, car des millions de fans du groupe avaient pris des places sans avoir l’intention de venir !
Qu’est-ce qui distingue la vague de la pop coréenne, ou K-pop, des précédentes, en particulier des vagues culturelles américaines qui ont inondé l’Europe après la Seconde Guerre mondiale ?
Après-guerre, la France était très endettée auprès des États-Unis. En échange de l’effacement d’une partie de cette dette, l’État a accepté des temps d’écran réservés aux productions américaines dans les cinémas. Ces films promouvaient forcément l’American way of life. Le but, en sus de la suprématie économique, était de « fabriquer » du consumérisme et de l’individualisme à l’américaine. Et ça a marché !
Contrairement à ces vagues, le phénomène de la K-pop n’est pas hégémonique, elle ne s’accompagne pas de l’ambition de coréaniser la planète. L’autre différence, c’est que le narratif culturel n’est pas du tout centré sur des héros individualistes. Au contraire, la préoccupation du collectif est très forte, comme dans la langue coréenne qui privilégie le « nous » par rapport au « je ».
Nos pratiques sont-elles aujourd’hui davantage déterminées par l’évolution des technologies que par les questions qui traversent l’actualité ?
Les enquêtes montrent que les jeunes se mobilisent à des niveaux plus larges : l’inclusion, que ce soit à travers la question des origines ethno-nationales ou du genre, le multilatéralisme, la recherche d’un monde multipolaire. Cet engagement n’est pas politique au sens où cela se passe en dehors des partis politiques, mais il est métapolitique, c’est-à-dire qu’il repose sur des valeurs. Bien sûr, les jeunes peuvent être paradoxaux en ayant à la fois envie de défendre l’environnement et d’accéder à une forme de société de consommation, mais ils ont des comportements d’alterconsommation bien plus importants que les générations qui les ont précédés.
On baptise souvent les générations en fonction des outils qu’ils utilisent, digital natives (« enfants du numérique ») par exemple, pourquoi cette volonté de les nommer ?
Cela relève du marketing et d’une mise en boîte réductrice, comme avec les générations X, Y, Z – on fait défiler l’alphabet, mais la réalité de cette jeunesse, c’est qu’elle n’est pas nombreuse comparativement aux générations précédentes. Les jeunes sont de plus en plus diplômés dans un marché de l’emploi en tension, avec une demande de compétence accrue, et ils sont placés face à des enjeux globaux majeurs.
Où en sont les inégalités culturelles en France ?
Les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français montrent qu’il y a plutôt une réduction des inégalités, mais que ce qu’il reste des inégalités compte double. Tous les jeunes ont maintenant un smartphone, mais ceux qui n’en ont pas ou ceux qui n’ont pas accès à Internet, s’ils ne sont pas très nombreux, subissent des exclusions d’une dureté supérieure. Quand 98 % de la population dispose d’un service et 2 % non, c’est une exclusion quasi radicale. Sans compter que les exclusions sont cumulatives. Ces jeunes-là sont ceux que la statistique internationale appelle les NEET – Not in Education, Employment or Training (« ni en études, ni en formation, ni en emploi »). Ils doivent être ciblés en priorité par les politiques culturelles, mais sont les plus difficiles à atteindre.
« Aux inégalités d’accès pratiques s’ajoutent les frontières symboliques, qui sont les plus difficiles à faire évoluer »
Beaucoup a été fait par les institutions pour proposer une offre « hors les murs » et par les collectivités pour développer la forme « festival », les pratiques numériques ont « démocratisé » l’accès aux contenus culturels, pourtant les inégalités territoriales demeurent prégnantes. Aux inégalités d’accès pratiques s’ajoutent les frontières symboliques, qui sont les plus difficiles à faire évoluer. C’est l’une des réussites du pass culture que d’avoir fait entrer certains jeunes dans les librairies.
Existe-t-il une spécificité des pratiques culturelles de la jeunesse française ?
Ce qui me frappe, c’est la définition française de la culture comme un bien supérieur, un bien commun, désirable, un bien à transmettre, et non un simple bien de consommation. Cette vision s’incarne dans la notion totalement intraduisible de culture générale. Chaque fois que j’essaie d’expliquer à des collègues étrangers le « grand oral de culture générale » du nouveau bac, je réalise que ça n’existe nulle part. Savoir parler de tout, cela fait appel à l’art de la conversation et au « capital culturel incorporé », selon l’expression de Bourdieu, mais pas seulement. Il ne faut pas que ça soit trop scolaire, sinon c’est disqualifiant. C’est une approche très française…
Quelle place prend l’événement dans nos vies ?
Il y a une événementialisation de nos vies. Parce que, dans un environnement de trop-plein communicationnel, vous n’êtes pas vu si vous n’organisez pas d’événements. C’est comme la publicité : on ne sait pas exactement quelle part de la consommation est liée à la publicité, mais on sait que si une marque s’abstient de communiquer, elle est oubliée et ses ventes baissent. Dans la culture, c’est le même phénomène, notamment dans le cas français où l’offre est pléthorique.
On semble avoir plus envie qu’avant de se réunir tout en ayant des pratiques culturelles plus individuelles, sur Netflix par exemple. Comment l’expliquer ?
Les pratiques de consommation sont en effet plus individuelles qu’auparavant, mais pas les pratiques de sortie. Les gens ont toujours envie de se réunir. Sur le marché de la musique enregistrée, on est passé d’un modèle économique où le CD était la « vache à lait » et le concert un événement à perte, à un modèle totalement inversé. Cela prouve que les gens ont très envie d’être ensemble, que plus on est seul devant des écrans, plus se développe une recherche d’expériences collectives.
Propos recueillis par IMAN AHMED & ÉRIC FOTTORINO








