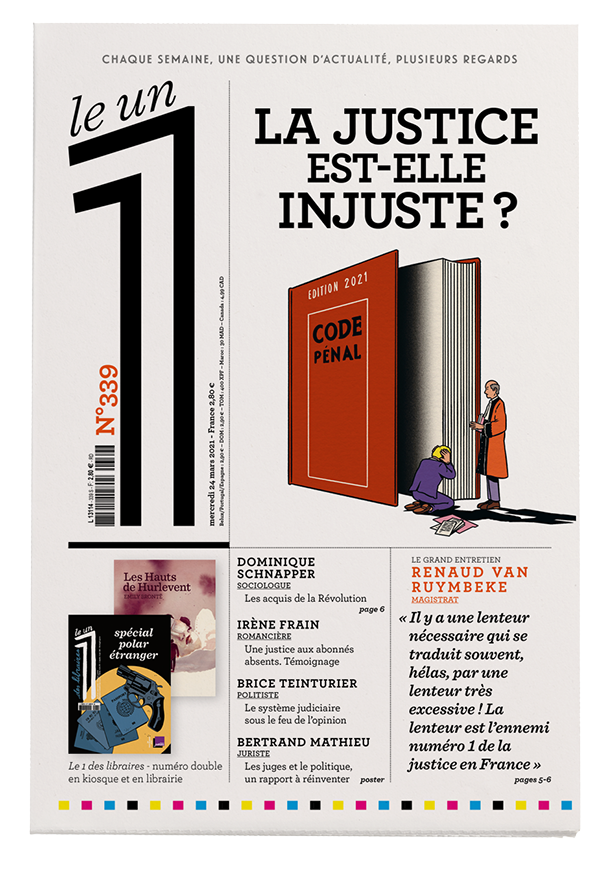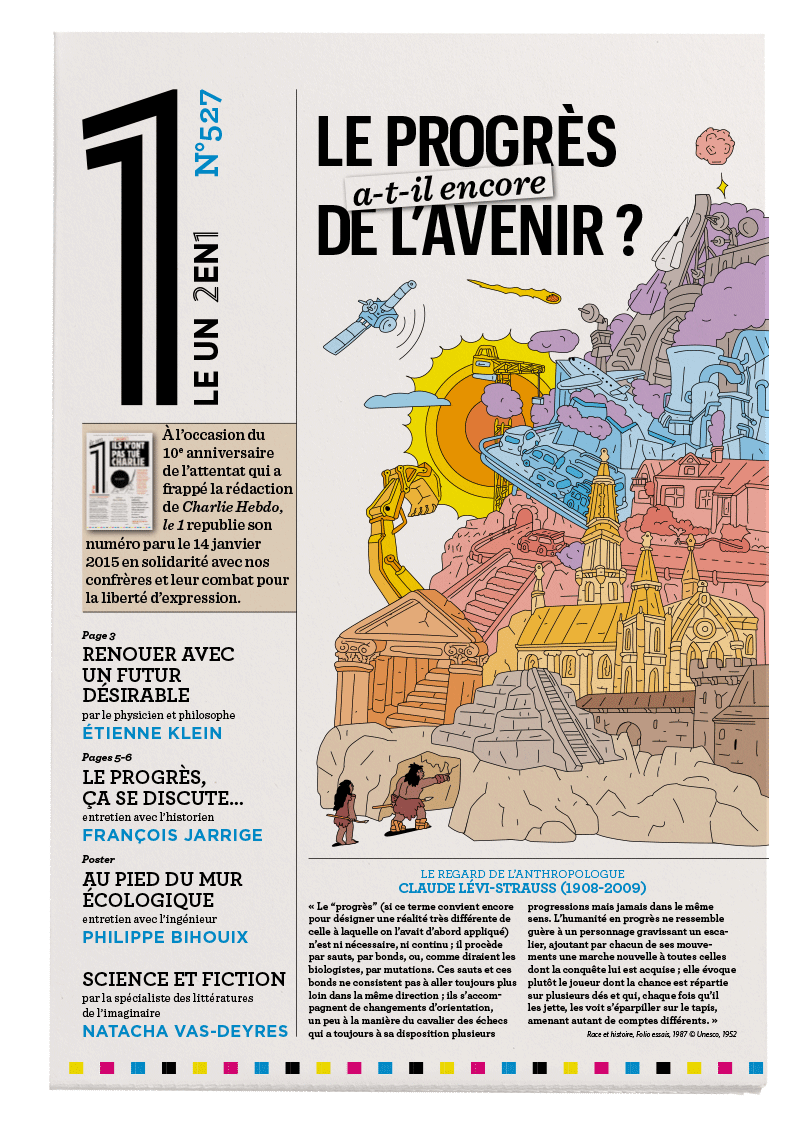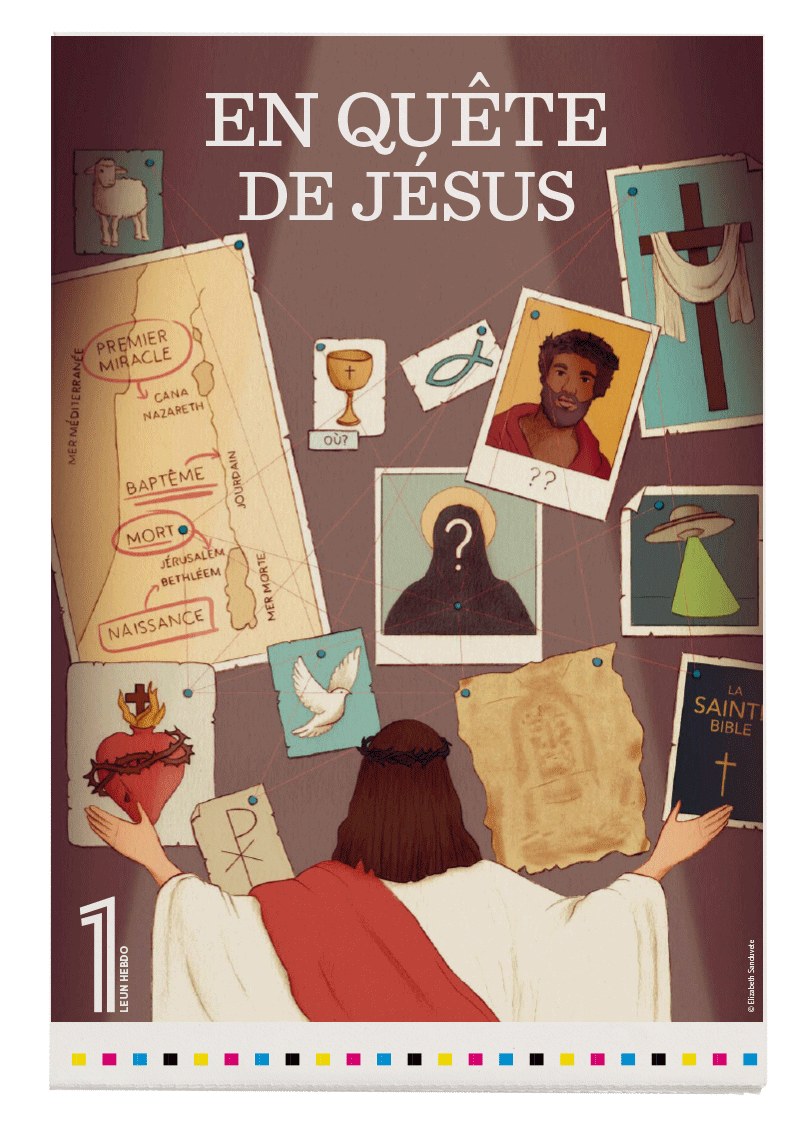La mutation politique des juges
Temps de lecture : 7 minutes
La question des rapports entre justice et politique s’inscrit en France dans un contexte historique particulier. La fin de l’Ancien Régime est marquée par un conflit aigu entre le pouvoir monarchique et les parlements, c’est-à-dire les cours de justice. Pour décrire cette situation, Saint-Simon écrit dans ses Mémoires : « La robe ose tout, usurpe tout, domine tout. » La Révolution se fera autant contre ces cours de justice que contre le roi, et les régimes qui se succéderont traduiront la volonté d’assujettir la justice au pouvoir politique et de lui interdire d’intervenir dans les décisions qui relèvent du pouvoir politique. Sous la IIIe République, alors que les scandales politico-financiers se multiplient (affaires du canal de Panama, des emprunts russes, Stavisky…), le pouvoir politique fait peu de cas de l’indépendance des juges. La Constitution de la Ve République se gardera de faire de la justice un pouvoir, elle se bornera à lui reconnaître le statut d’une autorité, l’indépendance des juges étant placée sous la garantie du chef de l’État.
La responsabilité politique tend à s’opérer devant les juges
C’est au début des années 1970 que la situation va commencer à évoluer, notamment, avec la création du Syndicat de la magistrature, qui revendique un engagement politique clairement marqué à gauche. La mutation qui s’opère alors ne constitue pas seulement un rééquilibrage des pouvoirs au profit de la justice, elle traduit aussi la revendication de certains juges de s’immiscer dans la décision politique et d’adapter le droit à ce qu’ils estiment être les évolutions positives de la société – ce qui est, il est utile de le rappeler, le cœur de la fonction politique.
Si aujourd’hui les tensions s’exaspèrent, c’est essentiellement dû à un phénomène de pénalisation de la vie politique et sociale, qui, au travers d’exigences renforcées de moralité publique, de transparence, va brouiller les frontières entre vie privée et action politique, entre délits de droit commun et exercice de l’activité politique. Par ailleurs, dans un système institutionnel où la responsabilité politique ne joue plus vraiment (responsabilité des ministres devant le Parlement, responsabilité des élus devant le peuple, recours au référendum), la responsabilité politique tend à s’opérer devant les juges. La manifestation la plus évidente de ce phénomène s’incarne dans la décision d’Édouard Balladur de contraindre les ministres mis en examen de démissionner. Alors que la responsabilité est l’une des conditions de la démocratie, les citoyens ont alors tendance à se retourner vers les juges. Il n’en reste pas moins que cette situation fausse le fonctionnement du système institutionnel en conduisant les juges à intervenir au cœur de l’action politique.
Deux affaires sont emblématiques de cette confusion des genres. La première est celle dite du sang contaminé : plusieurs ministres, dont le Premier ministre Laurent Fabius, vont être jugés en 1989 par la Cour de justice de la République pour empoisonnement ; la seconde concerne l’ancienne ministre de l’Économie Christine Lagarde, jugée en 2016 par la même cour pour le délit d’imprudence, constitué en l’espèce par le recours à l’arbitrage dans l’affaire opposant Bernard Tapie au Crédit lyonnais. Dans la première affaire, il eût été plus conforme à la logique parlementaire d’engager la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale du fait des dysfonctionnements de l’administration placée sous ses ordres ; dans la seconde, on conviendra que juger du caractère imprudent ou non d’une décision politique laisse peu de marges à l’autonomie de la décision politique.
Les manifestations actuelles de ces intrusions des juges dans l’activité politique sont particulièrement nombreuses. Pour ne citer que quelques exemples : perquisitions au sein des assemblées parlementaires, interventions dans la campagne présidentielle, saisie des agendas d’un ancien président de la République, écoute des conversations téléphoniques de ce dernier avec son avocat, ouverture d’une information judiciaire contre un garde des Sceaux qui diligente une inspection concernant des magistrats, perquisitions dans différents ministères concernant les conditions de gestion de la crise sanitaire…
La légitimité du juge repose sur son impartialité et si l’indépendance est l’une des conditions de l’impartialité, ce n’est pas une condition suffisante
Si l’on s’en tient aux apparences, on ne pourrait y voir qu’un rééquilibrage et se féliciter du fait que, dorénavant, le statut politique n’arrête plus le bras de la justice, mais ce serait faire abstraction d’une distinction essentielle. En effet, il convient de ne pas confondre dans une même analyse les poursuites et les condamnations qui visent des hommes politiques pour des délits de droit commun – par exemple la fraude fiscale ou le blanchiment (affaires Cahuzac, Balkany…) – et l’immixtion de la justice dans l’activité politique. L’affaire Fillon est de ce point de vue emblématique par les questions qu’elle pose : les juges peuvent-ils librement perquisitionner les assemblées parlementaires, alors qu’une perquisition dans un cabinet d’avocat nécessite l’intervention du bâtonnier ? Est-ce à un juge de définir ce qu’est le travail d’un assistant parlementaire, ou bien appartient-il d’abord à l’assemblée parlementaire de se prononcer sur cette question, avant de déférer à la justice ce qu’elle considérerait être un détournement ? Un juge peut-il intervenir dans une élection présidentielle, mettant de fait « hors jeu » un candidat par une mise en examen – que l’on a pu considérer, au surplus, comme précipitée ? Si de ce dernier point de vue aucune solution n’est vraiment satisfaisante, des « règles du jeu » s’imposent.
Il est un autre révélateur de cette crise qui affecte les relations entre justice et politique, c’est le soupçon de partialité qui pèse sur la justice ou plutôt sur certains juges. Si les juges revendiquent, à juste titre, le respect de leur indépendance, ils se focalisent cependant presque exclusivement sur l’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, ou plus largement du pouvoir politique. En réalité, la légitimité du juge repose sur son impartialité et si l’indépendance est l’une des conditions de l’impartialité, ce n’est pas une condition suffisante.
L’indépendance du juge n’a pas d’abord pour objet de protéger le juge, mais de représenter une garantie pour le justiciable
De ce point de vue, l’engagement politique public de certains magistrats, ou de certains syndicats de magistrats, pose problème. Il ne s’agit pas de considérer qu’un magistrat politiquement engagé serait de ce seul fait partial, mais un magistrat politiquement engagé peut donner le sentiment de l’être, or, comme le relève la Cour européenne des droits de l’homme, l’exigence d’impartialité objective implique que le justiciable ait raisonnablement le sentiment d’avoir affaire à un juge impartial. Serait-ce, par exemple, le cas pour un patron pollueur confronté à un juge dont l’engagement écologiste est public ?
Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’indépendance du juge n’a pas d’abord pour objet de protéger le juge, mais qu’elle représente une garantie pour le justiciable. De ce point de vue, l’affaire Sarkozy, notamment dans son volet corruption, est intéressante à différents égards.
Il ne s’agit pas ici de mettre en cause l’impartialité des magistrats ayant sanctionné l’ancien président de la République, mais de s’intéresser au contexte de l’affaire. Des syndicats de magistrats ont vivement attaqué certaines décisions politiques prises par l’intéressé comme ministre ou comme président et ont pris position contre lui lors de l’élection présidentielle. Par ailleurs, le fonctionnement de la machine judiciaire dans cette affaire a mis en œuvre des moyens « extraordinaires » : saisine du parquet financier, alors que ce dernier a été créé pour traiter d’affaires financières d’une particulière difficulté et de portée nationale ; utilisation des agendas du chef de l’État ; écoutes téléphoniques des échanges avec son avocat… pour une affaire qui, si elle n’avait relevé que du droit commun, ne serait pas d’une extrême gravité. D’autre part, alors que Nicolas Sarkozy est jugé en tant que « rendu à la classe ordinaire des citoyens », la fixation du quantum de la peine prend en compte ses anciennes fonctions politiques… Que les faits ainsi sanctionnés soient avérés ou non, que l’impartialité des magistrats étant intervenus dans le processus judiciaire soit ou non sans reproche, il n’en reste pas moins que la justice a pu donner le sentiment de ne pas fonctionner de manière totalement impartiale.
Tant le pouvoir politique que la justice n’ont rien à gagner à une telle situation. Leurs rapports sont à repenser.
Dessin JOCHEN GERNER
« On ne peut pas laisser le corps judiciaire s’autogérer »
Van Ruymbeke Renaud
« La grande faiblesse de la justice, c’est sa lenteur. Il faut lutter contre cela, même si la grandeur de la justice est de prendre son temps, d’écouter, de vérifier et de donner toute leur place aux recours. Il y a une lenteur nécessaire qui se traduit malheureusement souvent par une lenteur trè…
Raminagrobis et moi
Irène Frain
« “Comment font les autres ?” Les autres : ceux qui n’ont pas les mots, ceux que la simple idée de faire un courrier pétrifie, ou qui ont la naïveté de croire qu’on peut se fier à la machine judiciaire dès lors qu’elle vous fait les yeux doux. » En 2018, la romancière apprend le décès de sa sœur …
[Présomptions]
Robert Solé
VOUS n’avez pas le droit de qualifier mon client de délinquant.
– Il a pourtant fait l’objet de plusieurs plaintes concordan…
Raminagrobis et moi
Irène Frain
« “Comment font les autres ?” Les autres : ceux qui n’ont pas les mots, ceux que la simple idée de faire un courrier pétrifie, ou qui ont la naïveté de croire qu’on peut se fier à la machine judiciaire dès lors qu’elle vous fait les yeux doux. » En 2018, la romancière apprend le décès de sa sœur …