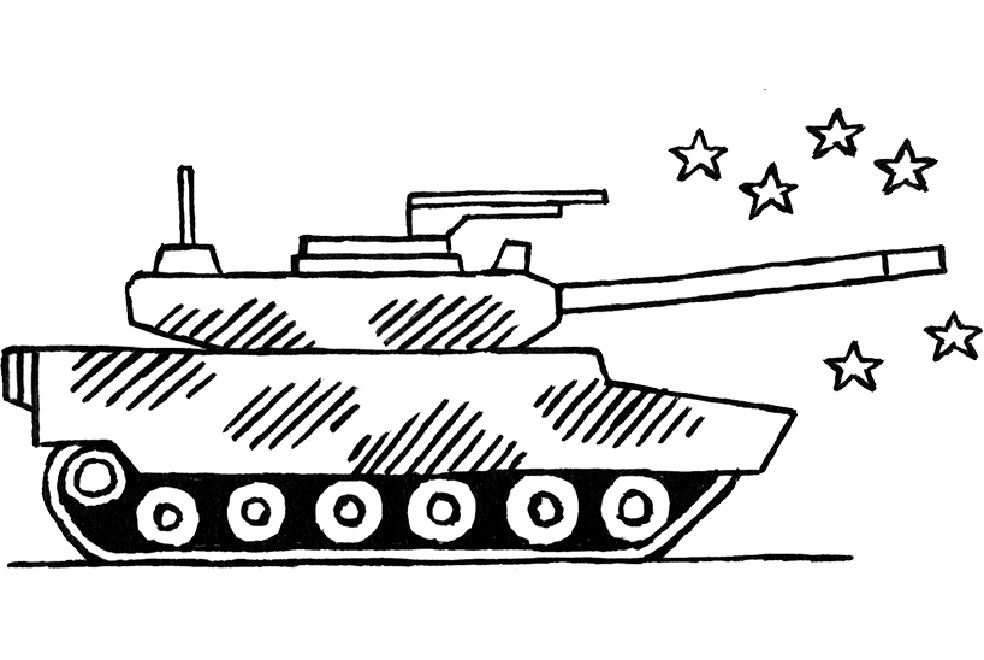Le knout à l’intérieur et le knout à l’extérieur !
Temps de lecture : 7 minutes
Le vendredi 25 février – dès le lendemain, donc, du début de l’agression militaire russe contre l’Ukraine indépendante et souveraine –, une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, présentée par les États-Unis et l’Albanie et soutenue par quatre-vingt-un pays, a été bloquée par le veto de la Russie. Seuls trois États – la Chine, l’Inde et les Émirats arabes unis – se sont abstenus – sans surprise pour les deux premiers, très liés à la Russie, et plus étonnamment pour le troisième, souvent allié à l’Occident, mais lui-même longtemps engagé dans une guerre au Yémen.
Cette impasse a permis l’ouverture, le 2 mars, d’une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale de l’ONU – la première depuis quarante ans –, qui a adopté à une majorité imposante une nouvelle résolution, non contraignante, exigeant l’arrêt des hostilités. Seules quatre dictatures – Biélorussie, Syrie, Érythrée et Corée du Nord – s’y sont opposées. Cent quarante et un pays l’ont approuvée et trente-cinq se sont abstenus, dont à nouveau la Chine.
Ces deux réunions ont manifesté l’isolement diplomatique de la Fédération de Russie, accentué par la prise de distance de pays réputés proche d’elle : Chine, Cuba, Viêtnam, Inde, Iran, Kazakhstan, Algérie, qui se sont abstenus.
Malgré la demande de l’Ukraine, relayée par le Royaume-Uni, l’option d’exclusion de la Russie, membre fondateur et permanent, n’a pas été jugée possible, en dépit de son contournement délibéré de la Charte des Nations unies : le veto russe l’empêche. Pour mémoire, c’est la mise en place de ce droit de veto sur toute décision collective, exclusivité des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui avait convaincu Staline d’accepter la création de cette institution conçue par les équipes du président Roosevelt et agréée lors de la conférence de Yalta en février 1945. Staline avait d’ailleurs également suspendu son accord à l’entrée de l’Ukraine et de la Biélorussie à l’ONU, aux côtés de la République socialiste fédérative soviétique de Russie !
Moscou a su renouer avec les contacts entretenus à l’époque soviétique au Moyen-Orient et sur le continent africain
Ce pays, qui dispose du cinquième réseau diplomatique du monde – derrière la Chine, les États-Unis, la France et le Japon –, peut-il se trouver complètement isolé ? La Fédération de Russie déploie deux cent quarante-deux postes diplomatiques dans le monde, dont cent quarante-quatre ambassades. Le nombre exact des nombreux agents accrédités sous couvert diplomatique n’est pas connu avec précision, pas plus que le budget du « MID », le ministère russe des Affaires étrangères. La Russie a une tradition diplomatique ancienne et solide et elle trouve dans les diverses enceintes internationales des lieux d’expression et d’influence qu’elle ne manque jamais d’exploiter. Même si, à la différence de la pratique des diplomaties des pays démocratiques, diplomatie et coercition vont ici de pair, l’une pouvant servir à brouiller l’autre, le plus souvent par recours à la vieille méthode soviétique des contre-vérités énoncées sans vergogne.
Ce pays, qui vient d’être assuré d’une « amitié entre le peuple russe et le peuple chinois solide comme un roc et de l’immensité des perspectives de coopération futures », selon les termes choisis du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi le 7 mars, est-il isolé ? En réalité, la Chine reste prudente – Wang Yi parle de « peuples », pas de gouvernements. Cette prudence se manifeste par une double abstention à l’ONU, que Pékin explique par sa disponibilité pour engager une médiation. L’entretien récent entre Xi Jinping, le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron va dans ce sens, car seul Pékin pourrait amener Moscou à la retenue et à la négociation – à condition que Washington y consente par une levée des sanctions contre la Chine ! Les dirigeants chinois ne peuvent pas dire publiquement leur désapprobation de l’agression russe, qui contredit le principe de l’intégrité territoriale, mais ils anticipent un affaiblissement durable de la Russie – aux niveaux économique et diplomatique – qui servira leurs intérêts de long terme.
Moscou, qui a su renouer avec les contacts entretenus à l’époque soviétique au Moyen-Orient et sur le continent africain – théâtres de la compétition idéologique et stratégique entre les deux blocs durant la guerre froide –, dispose de relais mobilisables dans les institutions internationales. La géographie des trente-cinq abstentions lors de la session de l’Assemblée générale de l’ONU le confirme.
La Russie a eu dans le passé une véritable politique arabe, avec l’Irak de Saddam Hussein – nationaliste laïc et excellent client pour l’armement soviétique – et avec la Syrie d’Hafez Al-Assad – qui était devenue une sorte de protectorat. La Russie a depuis une décennie étendu sa présence dans ce dernier pays, dans le contexte de guerre civile qui s’y est déroulée ; elle a sauvé le régime, de concert avec la République islamique d’Iran. L’antiaméricanisme systématique de l’Iran explique son abstention récente, même si sa méfiance à l’égard de la politique russe est profonde.
L’Union soviétique était très active sur le continent africain. Elle a soutenu efficacement le combat de l’African National Congress (ANC) de Nelson Mandela en Afrique du Sud et celui des pays de la « ligne de front » – groupement informel animé par la Tanzanie, avec notamment le Botswana, la Zambie, le Mozambique, le Zimbabwe ou l’Angola, dont les États, dirigés par la majorité noire, voulaient se défendre contre leurs voisins dirigés par la minorité blanche. Elle s’est engagée militairement, avec Cuba et la République démocratique allemande, dans les luttes d’indépendance de l’Angola et du Mozambique contre les forces sud-africaines soutenues par les Occidentaux, jusqu’à ce que les sanctions décidées par ceux-ci contre Pretoria accélèrent la fin du régime d’apartheid. Elle a soutenu la dictature de Mengistu en Éthiopie.
En Algérie, les officiers supérieurs de l’armée ont été formés dans les académies militaires russes, dans une relation nouée à l’époque soviétique, poursuivie ensuite et approfondie avec la fourniture récente d’armement face au Maroc. Les relations avec le Mali datent de l’indépendance et de la première rupture avec la France, du fait de l’orientation socialiste et panafricaniste de son premier président Modibo Keïta. Le film de Robert Guédiguian Twist à Bamako (2021) illustre cette période. La musique « impérialiste » n’a pas eu plus de succès dans la Bamako socialiste que dans le Tombouctou islamiste, comme le montre la fin du film. Les deux derniers coups d’État ont resserré les liens entre le Mali et la Russie : le Premier ministre Choguel Maïga est diplômé de l’Institut des télécommunications de Moscou, où il aurait résidé une dizaine d’années ; l’un des auteurs du putsch, le colonel Sadio Camara, formé militairement en Russie, était rentré à Bamako deux semaines avant le putsch pour des congés ; il est le ministre de la Défense et l’homme fort du nouveau régime. D’autres pays intéressent la Russie, notamment le Soudan, qui semble ouvert à l’installation d’une base navale russe sur la mer Rouge. La Russie a trente-sept ambassades en Afrique ; elle forme sept mille étudiants par an, notamment, à Moscou, à l’Université russe de l’amitié entre les peuples, ancienne université Patrice-Lumumba, relancée en 2019 après l’arrêt de ses activités dû à des incidents racistes.
C’est donc un investissement ancien qui s’est accru depuis trois ans. Il trouve sa contrepartie dans les votes conciliants africains et moyen-orientaux à l’ONU. Il s’agit de contrer le poids de la France en Afrique et sans doute celui de la Chine, même si la Russie n’a pas les moyens d’une coopération au développement. Il lui reste les armements et les mercenaires, qui ont un rôle de garde prétorienne, et la propagande. Celle-ci s’est développée à partir de la République centrafricaine depuis 2019 sous la forme d’une lutte informatique d’influence visant, à travers les réseaux sociaux, à encourager les courants politiques panafricanistes, attribuant tous les malheurs de l’Afrique non à la mauvaise gouvernance actuelle mais à la période coloniale passée. La première cible est l’Afrique francophone, qui est travaillée par des mouvements de critique ouverte des gouvernances défaillantes, dont la responsabilité est attribuée, en dernier ressort et par commodité, à l’ancienne métropole coloniale. Une posture d’abstention comme celle du Sénégal peut être interprétée, dans ce nouveau contexte, comme un moyen pour son gouvernement d’éviter d’être pris pour cible d’une offensive informationnelle susceptible de favoriser les mouvements d’opposition.
Si la Russie est désormais largement isolée et durablement affaiblie, ses dirigeants cultivent un double héritage qui sous-tend la « fuite en arrière » actuelle : d’une part, celui de l’expérience soviétique, selon laquelle la stabilité du système est mieux assurée en temps de guerre – ce qu’Andreï Gratchev, ancien conseiller diplomatique de Gorbatchev, qualifie dans un ouvrage prémonitoire publié en novembre 2021, Le Jour où l’URSS a disparu, de « code secret » et qui est à nouveau mobilisé par un Vladimir Poutine en fin de règne dans un système à bout de souffle ; d’autre part, celui de l’autocratie tsaro-stalinienne, qui veut que la Russie ne soit écoutée et entendue que lorsqu’elle fait peur. La lutte informatique d’influence entretient cette peur. Le knout (1) à l’intérieur et le knout à l’extérieur !
(1) Instrument de supplice en Russie impériale.
Dessins JOCHEN GERNER
« Un nouvel Afghanistan »
Michel Goya
Pour l'ancien colonel et historien Michel Goya, les forces ukrainiennes font subir des pertes sans précédents à l’armée russe, qui ne peut sortir gagnante.
[Guerre]
Robert Solé
Réfléchissez : comment la Russie pourrait-elle faire la guerre à l’Ukraine alors que l’Ukraine fait partie de la Russie ?
« Cette guerre nous mène à la fin du régime Poutine »
Jacques Rupnik
Le spécialiste de la Russie Jacques Rupnik affirme que même si le maître du Kremlin a étouffé toute opposition intérieure, cette guerre met en péril le contrôle qu’il exerce sur les sphères de pouvoir.