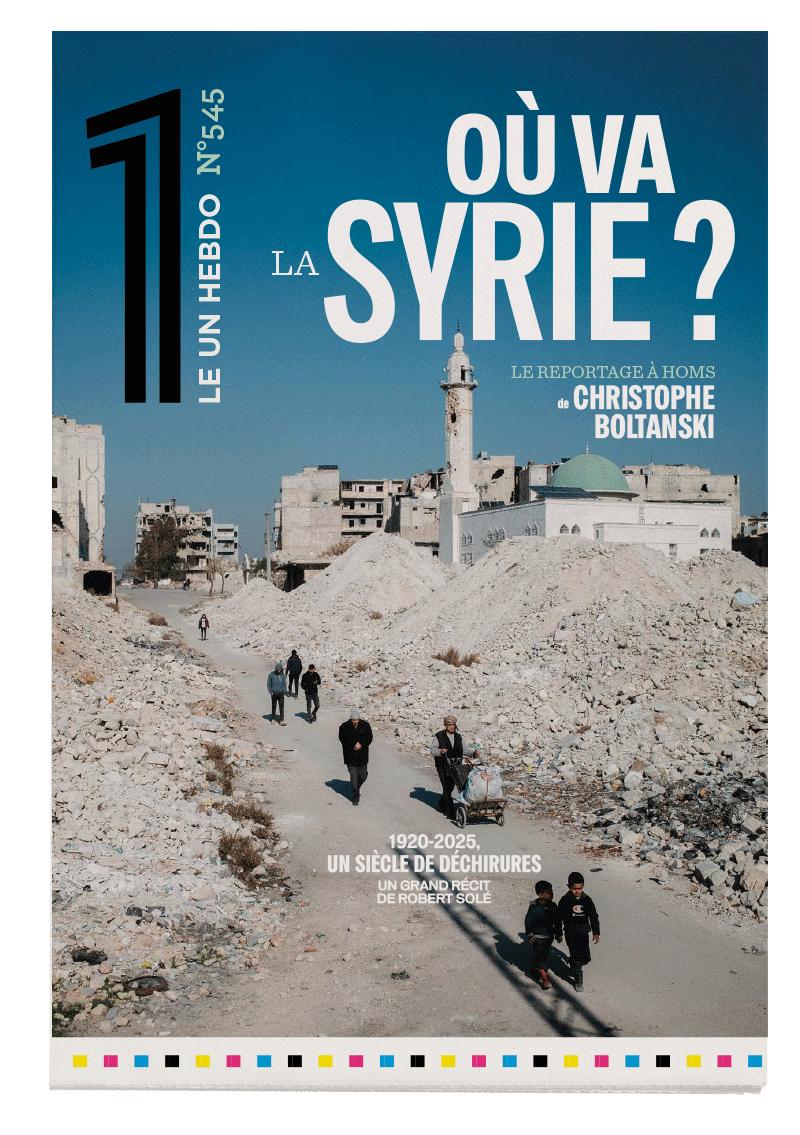« J’aime monter par à-coups »
Temps de lecture : 9 minutes
Comment devient-on grimpeur ?
C’est d’abord une question génétique : vous devez avoir la chance d’avoir une morphologie longiligne qui permette de passer les bosses. Vous pouvez aimer le grand air des cols, si vous avez un physique massif de sprinteur, ce sera beaucoup plus difficile pour vous. Ensuite, c’est une question de mentalité. J’ai découvert la montagne très jeune, aux côtés de mon père et de mon frère aîné. J’aimais la liberté qu’on ressent quand on se retrouve dans les cols, quand on prend de la hauteur et qu’on goûte à la solitude et au silence.
Qui admiriez-vous alors ?
J’avais 7 ans lorsque Richard Virenque a fini deuxième du Tour de France, donc il était évidemment celui qui me faisait vibrer. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux en France ! D’ailleurs, le deuxième vélo de ma vie était une réplique du sien, le vélo bleu et jaune Peugeot de l’époque Festina.
Quels sont les premiers cols que vous avez découverts ?
Nous partions en vacances dans la région de Perpignan, et allions rouler dans le massif du Canigou. Je me souviens que la première fois que j’ai escaladé un col là-bas, j’ai réussi à monter, mais pas à redescendre tant la pente me faisait peur ! Je n’avais que 10 ans, mais je n’étais déjà pas un grand descendeur…
Vous aviez aussi des côtes près de chez vous, dans les Vosges…
Bien sûr ! Tous les ans, j’allais voir le Tour de Franche-Comté, une course semi-professionnelle, assez réputée à l’époque, qui se terminait en haut de la Planche des Belles Filles. Je me souviens que la difficulté de cette ascension, la souffrance des coureurs pour arriver au bout, c’est aussi ce qui m’a donné envie d’être grimpeur.
Comment cette souffrance spécifique du grimpeur peut-elle faire envie ?
C’est difficile à expliquer. Quand on attaque un col des Alpes ou des Pyrénées, on sait qu’on s’apprête à souffrir une grosse demi-heure, voire plus d’une heure dans les cols plus longs. Donc pour être grimpeur, il faut aimer se faire mal, tout le temps. Même lors d’une sortie de récupération à l’entraînement, j’ai besoin de me tester, de me faire vraiment mal, une minute, deux minutes. Je pense que notre corps est habitué à cela, et que si on n’a pas notre dose de souffrance, on n’est pas bien ! Et on ne se sent vraiment mieux que lorsqu’on a réussi à venir à bout d’un entraînement long et difficile.
Mais comment surmonte-t-on cette douleur ?
En course, je pense à tous les sacrifices accomplis. Quand je suis près de lâcher, je pense à la dureté de l’entraînement, aux stages loin de chez moi, à tout ce qu’il a fallu surmonter pour pouvoir en arriver là. Et à l’entraînement, quand c’est dur, je regarde le cadre de mon vélo où j’ai fait dessiner mes plus grandes victoires, au Tour de Lombardie, au Tourmalet, aux lacs de Covadonga… Tous ces sommets mythiques que les efforts m’ont permis de l’emporter.
Grimper, ça s’apprend ?
Au début de ma carrière, je pensais que c’était inné. Que certains coureurs avaient cela dans le sang, et que cela suffisait. Mais le vélo moderne nous montre que des rouleurs peuvent devenir grimpeurs, c’est donc bien que ça s’apprend ! Ces nouveaux grimpeurs, comme Tom Dumoulin, sont capables de cadenasser une course à eux seuls, en cassant les codes des grimpeurs traditionnels, plus habitués à monter en danseuse, par à-coups.
Comment savez-vous, dans un col, que vous avez des jambes de feu ?
On le sait en regardant les autres. L’an passé, lors de ma victoire au Tourmalet, je n’ai vraiment su que j’étais bien que lorsqu’on m’a dit que Geraint Thomas, le vainqueur du Tour 2018, avait lâché, alors même que je sentais que j’en avais encore sous la pédale, que je n’avais pas encore produit mon effort. Là, tu te dis que tu dois être vraiment bien et que tu as les jambes pour être au-dessus des autres. Mais ça, tu ne le vois que dans les derniers kilomètres, quand tout le monde est à fond. Au début d’un col, tu ne sais jamais si ce sera toi le plus fort.
Il faut apprendre à doser son effort ?
Bien sûr ! Moi aussi, il y a des jours à l’entraînement, même en course, où monter un col me fait chier ! Il y a des jours où on n’a pas envie, où on est fatigué, où on veut rester dans le peloton, sur le grand plateau, pour ne pas souffrir. Et ça peut durer pendant les trois quarts d’une course, sans forcément augurer du final. Pendant une course, je sais que je ne dois surtout pas m’écouter : plus la ligne d’arrivée approche et mieux je me sens, car l’adrénaline monte et les jambes se débloquent. Il y en a eu tellement des étapes de ce genre, où je galère toute la journée avant de faire une bonne place, voire de gagner ! Lors du Tour 2014, par exemple, je suis tout près de me faire lâcher par le peloton dans le Tourmalet, et pourtant, une heure plus tard, je finis deuxième à Hautacam derrière Nibali.
Votre équipe joue un rôle important dans ces moments-là ?
Oui, mes coéquipiers sont les premiers à me rassurer, à me rappeler les courses passées. Il leur arrive même de ne pas m’écouter, de prendre la course en main alors que je leur dis que je ne suis pas bien ! Ils me connaissent, ils savent que les jambes vont généralement en s’améliorant…
Qu’est-ce qui fait la difficulté d’un col pour vous ?
Ce n’est pas forcément le pourcentage de la pente, mais plutôt la qualité du revêtement et la longueur du col. Une montée comme l’Alpe d’Huez par exemple, c’est l’une des arrivées du Tour les plus faciles pour moi : la route est un billard, les virages plats permettent de reprendre de la vitesse, et la montée ne fait que douze kilomètres. J’ai bien plus peur quand on me parle d’une arrivée au Ventoux. La route y est granuleuse, le paysage rocailleux, lunaire ; on sait déjà qu’on va beaucoup souffrir.
Quel est votre secret pour faire la différence ?
Quand je suis bien, j’aime monter par à-coups. C’est ce que j’avais demandé à David Gaudu l’an dernier au début du Tourmalet : accélérer par à-coups pour faire mal à tout le monde. Quand on monte sur un rythme linéaire, on peut survivre, s’accrocher. Pas quand ça accélère d’un coup très fort devant vous. Le secret, c’est d’être capable, à 300 mètres de l’arrivée, de baisser le braquet d’une dent quand tous les autres remontent.
Y a-t-il des cols que vous préférez ?
Cela dépend du contexte. À l’entraînement, j’aime les cols étroits, méconnus, où on croise peu de voitures, comme le col de Sarenne. En revanche, en course, je préfère les lieux mythiques, où la foule est très nombreuse, comme le Galibier ou l’Alpe d’Huez.
Quel rôle joue le public justement au cours d’une ascension ?
Cela dépend des coureurs. Certains aiment monter les cols seuls, sans la pression de la foule. Moi, j’aime sa présence, j’aime l’odeur de la bière et des fumigènes, j’aime l’adrénaline que la foule suscite et qui me permet de supporter la douleur. C’est pour ça que je ne préfère pas imaginer l’éventualité d’un Tour à huis clos.
Lors d’un grand tour, à quel moment savez-vous que vous tenez la forme ?
Généralement, cela se révèle lors du premier contre-la-montre. Il y a bien sûr des contre-exemples, mais normalement je sais que si je suis performant dans cet exercice, alors c’est que la préparation a été réussie, et que la montagne qui arrive devrait me réussir.
Y a-t-il une fragilité particulière des grimpeurs ?
Nous sommes plus frêles bien sûr, notre gabarit donne l’impression que nous sommes plus fragiles que les autres coureurs, alors même que notre pourcentage de masse grasse est le même que celui d’un sprinteur. Mais la montagne nous offre une revanche. J’avais consulté il y a quelques années un spécialiste des ondes positives, qui m’avait dit que la montagne permettait à mon corps de me régénérer, de récupérer. Et je pense qu’il y a du vrai là-dedans. La montagne, c’est le royaume des solitaires, il faut aimer être seul quand on est grimpeur. Je m’entraîne 95 % du temps seul, et c’est dans ces moments-là que je me sens le mieux.
La descente est-elle un exercice très différent ?
Oui, beaucoup de grimpeurs n’aiment pas descendre. Tout simplement parce que nous ne sommes pas faits pour la vitesse. Ce n’est pas notre mentalité. La technique de la descente, ça se travaille, on finit par l’acquérir. Mais pour bien descendre, en fin de compte, le plus important reste la confiance.
Comment voyez-vous ce Tour 2020 si particulier, organisé pour la première fois à la fin de l’été ?
À vrai dire, ça me convient plutôt bien : je ne suis pas un grand adepte de la chaleur et on devrait éviter la canicule en septembre. En revanche, on peut avoir une semaine de pluie en montagne, ça peut changer beaucoup de choses. Après, c’est un Tour avec des montées moins connues que les années précédentes, comme le col de la Loze, au-dessus de Courchevel, une arrivée très pentue, goudronnée sur une piste de ski et sans épingles. Celui-là, j’ai hâte d’aller le reconnaître.
Il faut toujours faire des reconnaissances pointues des cols avant un tour ?
Au début de ma carrière, j’avais besoin de reconnaître toutes les courses. Aujourd’hui, le numérique permet de mieux savoir où on va, de connaître tous les détails d’un col sans l’avoir grimpé et donc de ne pas partir dans l’inconnu. Mais ça ne veut pas dire que la stratégie de course est totalement arrêtée avant le départ. À la fin, ça dépend des jambes que tu as pendant la course.
Quel est votre plus grand souvenir en montagne ?
Ma victoire à l’Alpe d’Huez lors du Tour de France 2015. J’ai eu la chance de faire plus de la moitié de la montée seul, à partir du virage des Hollandais, et pour un Français, il n’y a pas de plus belle victoire. Je me souviens aussi du col de la Croix, lors de mon premier Tour en 2012 : je double un adversaire et je vais gagner l’étape à Porrentruy, à 22 ans : c’étaient des frissons incroyables… Je suis capable d’oublier les mauvais moments pour me remettre au travail. Mais je n’oublie jamais les souvenirs des grandes victoires. C’est pour ces jours-là qu’on fait du vélo.
Un dernier conseil pour les apprentis grimpeurs, qui souhaitent se lancer dans un col ?
Avant tout choisir le bon braquet et ne pas avoir peur de mettre le petit plateau. Ça ne sert à rien de se battre contre son vélo et la pente, il vaut mieux bien tourner les jambes. Et ensuite ne pas être crispé, poser les mains sur son guidon sans s’acharner, sans pédaler « avec les oreilles » comme on dit, et laisser de la fluidité dans votre geste.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO & JULIEN BISSON
« J’aime monter par à-coups »
Comment devient-on grimpeur ?
C’est d’abord une question génétique : vous devez avoir la chance d’avoir une morphologie longiligne qui permette de passer les bosses. Vous pouvez aimer le grand air des cols, si vous avez un physique mass…
L’art de la descente
Romain Bardet
Je n’ai jamais peur en descente. J’ai un sentiment de maîtrise, même si c’est une vue de l’esprit. En course, on prend beaucoup de virages à l’aveugle, avec des revêtements un peu hasardeux. Mais au sortir d’un virage, je pense souvent que j’aurais pu passer plus vite. Quand la …
L’art de la descente
Romain Bardet
Je n’ai jamais peur en descente. J’ai un sentiment de maîtrise, même si c’est une vue de l’esprit. En course, on prend beaucoup de virages à l’aveugle, avec des revêtements un peu hasardeux. Mais au sortir d’un virage, je pense souvent que j’aurais pu passer plus vite. Quand la …