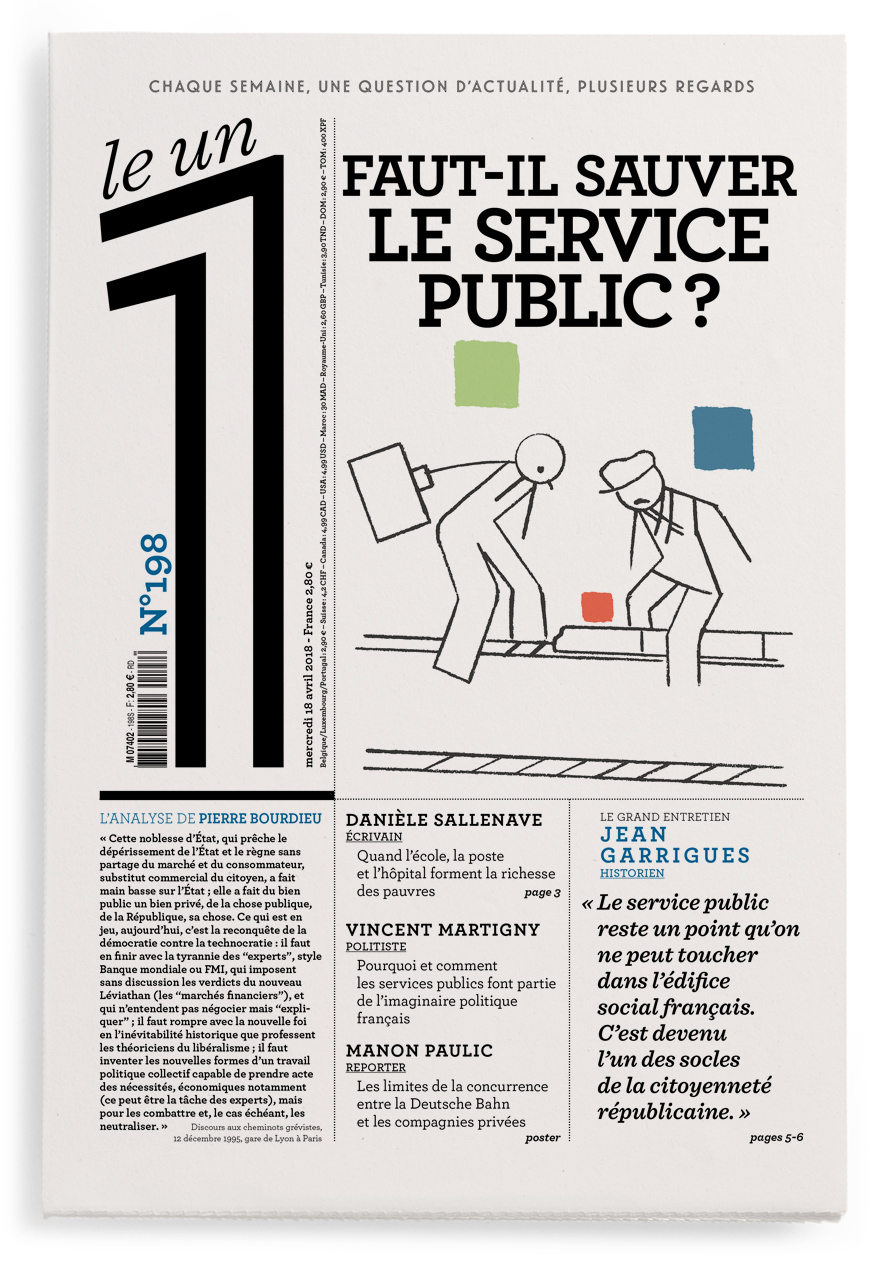« Le service public constitue notre écosystème républicain »
Temps de lecture : 7 minutes
Depuis quand la notion de service public est-elle utilisée en France ?
C’est une notion qui a été définie par un juriste de l’entre-deux-guerres, Léon Duguit. Dans un traité de droit constitutionnel de 1923, il définit le service public comme un ensemble de services – qu’il s’agisse de protections, de commodités, etc. – que seule la « puissance gouvernante » est en mesure d’apporter aux citoyens. C’est donc une notion neuve que l’on peut rattacher à l’idée de l’État-providence qui s’impose après la Seconde Guerre mondiale.
Beaucoup d’entre nous ont pourtant l’impression que cette notion existe depuis bien plus longtemps.
Parce qu’on peut l’inscrire dans une durée plus longue. L’idée de nationaliser un certain nombre d’industries, notamment les chemins de fer, remonte par exemple à la fin du Second Empire. On la trouve dans la fraction de gauche des républicains, chez Léon Gambetta. L’ambition d’un service scolaire primaire laïque, gratuit et obligatoire est portée par Jules Ferry. L’enseignement scolaire relève bien d’une conception d’un service rendu au public. La loi est votée en 1882. La notion de service public n’existe pas encore, mais l’idée circule.
Cela se cristallise à ce moment-là ?
Je ne dirais pas cela. Le service public se construit par étapes. En 1928, Raymond Poincaré, qui n’est pas vraiment un homme de gauche, dirige un gouvernement, lequel donne naissance aux habitations bon marché. Il s’agit d’une manière de service public, l’ancêtre des HLM. Plus tard, le Front populaire marque un vrai tournant. C’est en 1938 que sont nationalisés les chemins de fer et que la SNCF voit le jour. Le vœu de Gambetta se concrétise. Avec le Front populaire, on assiste à la résolution de tous les blocages de la IIIe République. Mais on ne parle toujours pas de services publics et l’expression n’est du reste pas utilisée dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) de 1944.
Que dit-il ?
Le programme prévoit entre autres « l’éviction des grandes féodalités économiques et financières » et, par exemple, la nationalisation des grandes banques et des sources d’énergie qui vont donner les Charbonnages de France, EDF, GDF, etc. Ces secteurs entreront dans le domaine du service public à la Libération. C’est aussi à ce moment que l’on assiste à la naissance de la Sécurité sociale et de tout un secteur de santé publique qui trace les contours du service public à la française.
« L’idée de service public est associée dans l’opinion à la reconstruction, au début des Trente Glorieuses et à la mise en place de la protection sociale »
Quelques années auparavant, en 1942, l’économiste britannique William Beveridge avait rédigé un rapport qui fixait les bases de l’État-providence. C’est ce rapport qui irrigue le programme du Parti travailliste en 1945 et va finalement conduire à la création du fameux Service national de santé (National Health Service). C’est alors que la notion de service public entre vraiment dans les faits et les discours.
C’est une importation ?
Non, c’est une convergence qui s’inscrit dans une chronologie beaucoup plus ancienne. Le plan Beveridge rejoint la réflexion menée lors du Front populaire et de la rédaction du plan du CNR.
Comment analysez-vous l’attachement des Français au service public ? De quand date-t-il ?
Il est très vif à partir de la Libération, en considération de toutes ses avancées sociales. L’idée de service public est associée dans l’opinion à la reconstruction, au début des Trente Glorieuses et à la mise en place de la protection sociale. Il y a dans cet attachement une culture portée aussi bien par la gauche (le PC et la SFIO représentent plus de 50 % de l’électorat) que par le général de Gaulle.
« Le service public reste un point qu’on ne peut toucher dans l’édifice social français »
Il y a chez ce dernier tout à la fois une forme de dirigisme jacobin et une méfiance à l’égard des « féodalités économiques ». À la Libération, c’est bien lui qui fait remarquer lors d’une réunion avec les représentants du patronat qui veulent faire renaître l’équivalent du Medef : « Mais je n’ai vu aucun d’entre vous à Londres. Estimez-vous heureux de ne pas vous retrouver en prison. » Cette méfiance envers le capitalisme privé amène l’État à mettre la main sur des secteurs entiers de l’économie.
Dans les années 1981-1983, peut-on penser que le service public correspond à l’idéologie socialiste ?
Oui, totalement. Avec les nationalisations et les lois Auroux sur le travail, on est dans la continuité de l’esprit du Front populaire et de la Libération. Une rupture se fait jour au sein de la gauche, avec la contestation portée par Michel Rocard depuis le début des années 1970 autour des dysfonctionnements du service public. Puis viendra la critique de Jacques Delors, qui conduira au tournant de la rigueur de 1983. Mais culturellement, symboliquement et même politiquement, la gauche ne remet pas en cause le service public comme point cardinal de sa pensée. À l’échelle de l’opinion publique, l’idée du service public est bien moins contestée que celle des nationalisations.
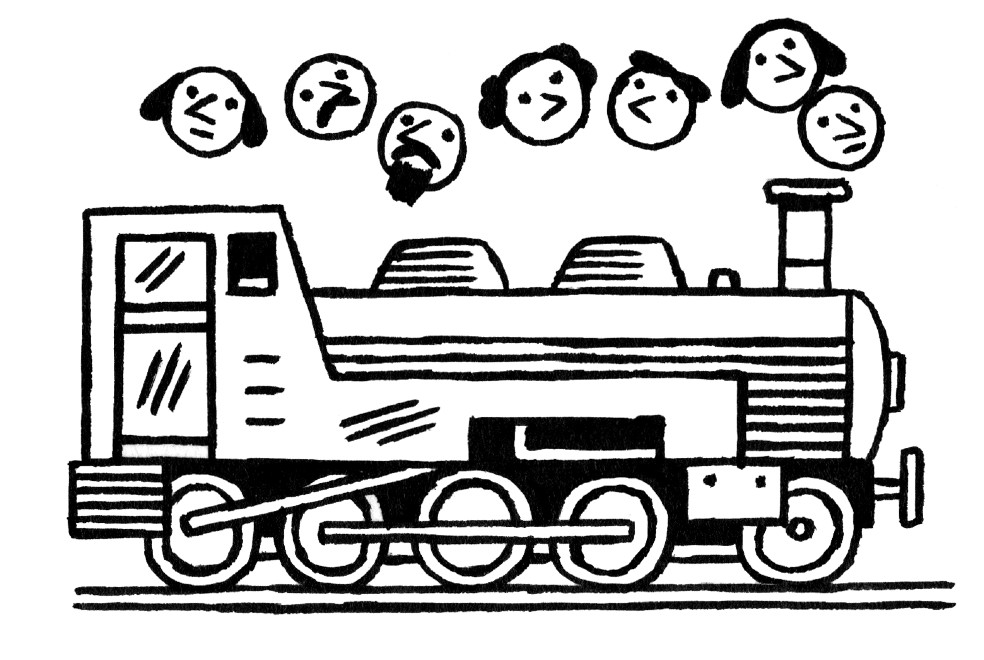
Pourquoi ?
Le service public reste un point qu’on ne peut toucher dans l’édifice social français. C’est devenu l’un des socles de la citoyenneté républicaine. Ce socle s’est d’abord forgé au début de la IIIe République autour des grandes lois concernant les libertés élémentaires, puis l’enseignement. La deuxième strate s’est construite progressivement entre la fin de la guerre de 14-18 et la Libération, renforçant l’idée d’une indissociabilité entre la République et le service public identifié comme une spécificité française. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut questionner la rentabilité de ce secteur. J’ajoute que, pour la SNCF, tous ses dirigeants de 1944 à la fin des années 1950 ont fait l’expérience de la Résistance. Ce n’est pas un hasard. Le rôle des réseaux Résistance-Fer n’a fait que confirmer culturellement, même si c’est inconscient chez les Français, cette image positive du service public.
Quels sont les moments de contestation du service public et pourquoi ?
Cela commence par la grande vague néolibérale que l’on observe en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, et en France en 1986-1988. Il y a d’abord la perception des insuffisances du service public. Puis sa remise en cause.
Qu’il s’agisse de l’éducation, des transports ou de la santé, la remise en question de l’efficacité du service public est devenue récurrente dans la société d’aujourd’hui. À quoi tient ce désamour ?
Il est lié à l’évolution de la culture de la gauche française, car, à droite, il y a toujours eu une méfiance autour de cette notion. On a parfois fait la confusion entre fonction publique et service public. La critique de la première est très ancienne. On la trouve chez Feydeau ou Courteline vers 1890, pour ne pas remonter aux diatribes de Saint-Just contre les « agents publics ». Clemenceau moquait les fonctionnaires assoupis dans les bureaux du ministère de l’Intérieur…
« Quel est le prix à payer pour préserver le modèle de l’État-providence français ? »
La critique des services publics du secteur marchand est plus récente. Elle est liée à la diffusion du concept libéral d’efficacité productive des années 1990, suite à la grande vague néolibérale de la décennie précédente. Dans une partie de la gauche française, le blairisme en Grande-Bretagne puis la politique de Schröder en Allemagne ont contribué à poser la question de la productivité. Il s’agissait plus d’une critique managériale qu’idéologique du service public. Celui-ci est tellement enraciné dans notre culture et notre histoire qu’il est plus difficile de le contester qu’ailleurs. On observe toujours cette réticence de fond à briser ce qui constitue notre écosystème républicain.
Le macronisme change-t-il cette vision ?
Le macronisme est d’abord un pragmatisme. Il est difficile de le considérer comme une volonté de démanteler le service public. Il consiste plutôt à adapter les fondements d’un État-providence aux contraintes de la mondialisation. L’intelligence historique de Macron lui fait comprendre que le service public fait partie du socle culturel des Français. Je ne le vois pas comme un fossoyeur. La question fondamentale, selon moi, est la suivante : quel est le prix à payer pour préserver le modèle de l’État-providence français ? Elle se pose depuis la fin des années 1970, les chocs pétroliers de 1973 et 1979 et l’entrée dans la crise. L’adaptation a été trop longtemps repoussée ou traitée avec des demi-mesures par les prédécesseurs de Macron. Lui semble vouloir répondre de façon pragmatique et radicale, c’est-à-dire par une action forte.
Propos recueillis par ÉRIC FOTTORINO et LAURENT GREILSAMER
Dessin JOCHEN GERNER
« Le service public constitue notre écosystème républicain »
Jean Garrigues
Depuis quand la notion de service public est-elle utilisée en France ?
C’est une notion qui a été définie par un juriste de l’entre-deux-guerres, Léon Duguit. Dans un traité de droit constitutionnel de 1923, il définit le service public comme un ensemble de services – qu’…
[Pantoufles]
Robert Solé
Il arrive qu’un fonctionnaire de police arrondisse ses fins de mois en se livrant à de petits travaux de maçonnerie, de peinture ou de gardiennage… Dans le jargon du métier, ce travail au noir s’appelle « la tricoche ».<…
Rail : l’envers du décor allemand
Manon Paulic
HAMBOURG. Gare centrale, quai no 12. Sous la gigantesque halle métallique, assise à l’extrémité d’un banc, Christine serre fort son café fumant entre ses mains. Cette Hambourgeoise de 59 ans, au visage pourt…