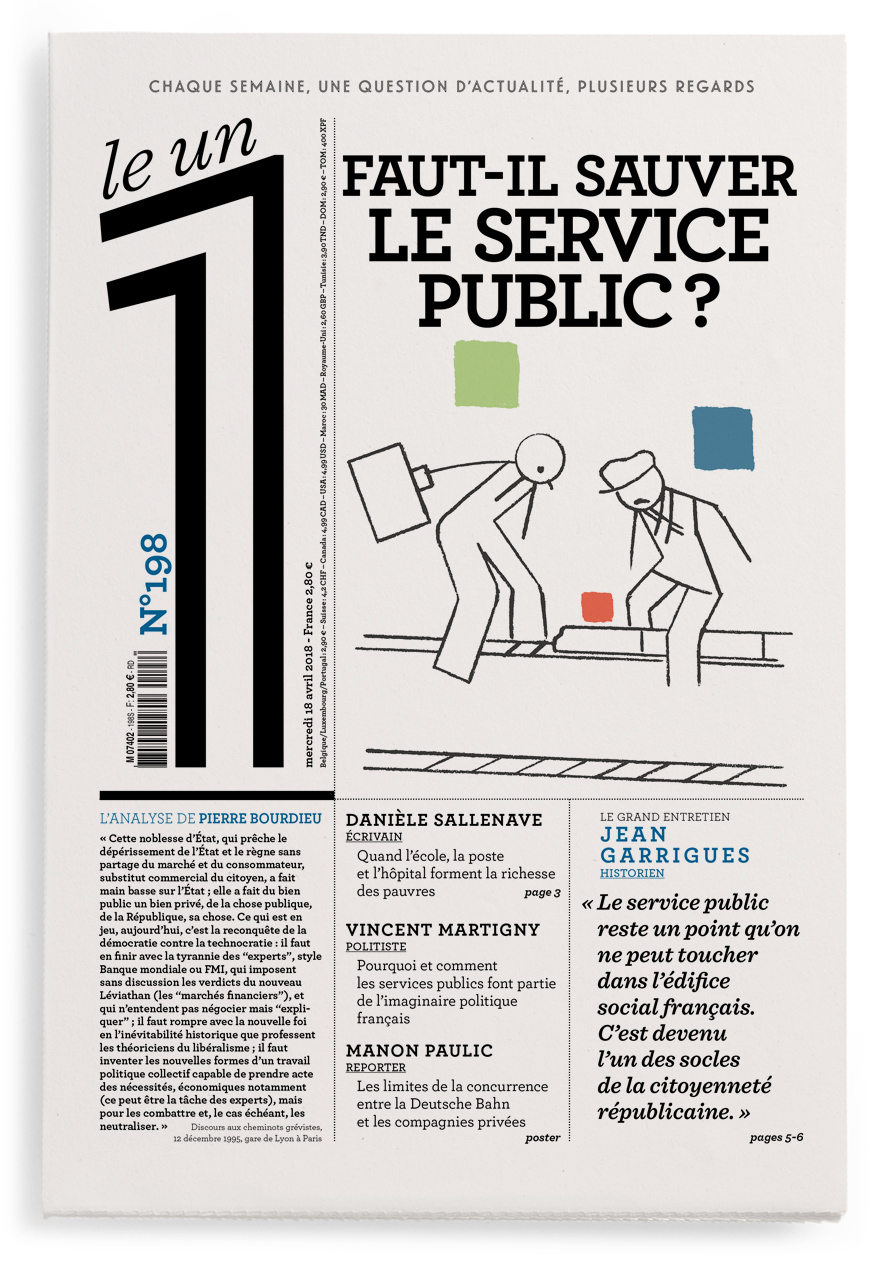Itinéraire d’une idéologie française
Temps de lecture : 12 minutes
Sauver le service public en danger ou le réformer au nom du bon sens : la pièce qui se joue ces jours-ci est un marronnier de la vie politique française. Ses acteurs reprennent une partition dont les arguments semblent se répéter à l’infini, de conflits sociaux en projets gouvernementaux de transformation du service public. Des plateaux des chaînes d’information en continu jusque dans les repas de famille dominicaux, les thuriféraires du service public affrontent les tenants (toujours plus nombreux) de la maîtrise des dépenses et d’une efficacité renforcée de l’action de l’État. Au-delà de la confrontation entre la réduction des déficits et la défense de statuts, pourquoi la notion de service public génère-t-elle de pareilles passions ?
Projet historique, symbole républicain et enjeu identitaire figé dans le marbre du droit, la notion de service public plonge au cœur de l’imaginaire politique français. Elle est historiquement le produit de la rencontre entre la construction de l’État, qui dès l’Ancien Régime définit un « bien commun » que le roi était chargé de défendre, et les événements de la Révolution française d’où émerge le concept d’intérêt général. L’irruption du peuple dans l’espace de la souveraineté impose alors l’idée, encore embryonnaire, que la puissance publique doit se mettre au service des citoyens, et non l’inverse.
Mais c’est avec la IIIe République, à la fin du xixe siècle, que la notion prend son sens contemporain et que l’État va être amené à s’engager beaucoup plus activement dans la vie sociale. Jacques Chevallier, professeur de droit et auteur de nombreux ouvrages sur le service public, analyse ce tournant comme la convergence « de contraintes diverses ». Elles sont pour lui économiques (l’industrialisation et la concentration des moyens de production), sociales (la paupérisation et l’apparition de besoins nouveaux) et politiques (le modèle républicain et le progrès de l’idée de justice sociale). Dès lors, l’État ne se cantonne plus aux seules prérogatives de la puissance et de la souveraineté, il devient un prestataire de services en vue de satisfaire les besoins du public : « Il n’hésite plus à se jeter dans l’arène et à intervenir activement dans le jeu social. »
Cette évolution se manifeste à travers les lois scolaires de 1882 qui instaurent l’école publique, gratuite et obligatoire, mais aussi via la multiplication des équipements publics et les premiers dispositifs d’assistance publics pour les ouvriers. Plus qu’une simple évolution pragmatique des missions de l’État, l’« école du service public », qui émerge à cette époque sous la houlette du juriste Léon Duguit, rencontre une utopie sociale. Luc Rouban, chercheur au CEVIPOF de Sciences Po, insiste sur l’ambition novatrice de cette idée : « Le service public est avant tout une philosophie politique qui se forge sous la IIIe République à travers deux grandes doctrines : la philosophie solidariste de Léon Bourgeois qui revendique une solidarité intergénérationnelle et interclassiste d’une part ; et la philosophie positiviste d’Auguste Comte, basée sur l’idée de progrès social, qui refuse d’abandonner la solidarité au christianisme ou à l’abstraction historicisante du socialisme. » Apparaît déjà la volonté de construire une troisième voie, républicaine, entre la brutalité du capitalisme et l’idéologie des mouvements ouvriers.
De cette période aux années 1970, l’affirmation du service public ira de pair avec l’expansion de la sphère étatique, favorisée par une mythologie qui progressivement pare la gestion publique d’une supériorité de principe sur la gestion privée et fait de l’État le principal garant de la croissance économique et du progrès social. D’abord portée par la gauche, qui sous le gouvernement de Front populaire a créé en 1938 la SNCF en nationalisant les compagnies privées qui géraient jusqu’alors le réseau ferroviaire, l’idéologie du service public devient consensuelle à partir de la Libération. La nationalisation par le gouvernement provisoire de larges pans de l’économie française, l’institution de la Sécurité sociale et du régime des retraites, pierres angulaires de l’État-providence en construction, et d’un statut spécifique pour les fonctionnaires, consacrent un culte de l’État auquel sacrifient gauche et droite. Yves Guéna, diplômé de la première promotion « France combattante » à l’Ena, créée en 1945, ministre et figure du gaullisme avant de devenir un proche de Jacques Chirac, résume l’état d’esprit de l’époque : « Pour nous, c’était Keynes et le Plan. » Le service public devient à cette période ce que Jacques Chevallier nomme « la trame de la vie collective, et partant l’instrument privilégié de cohésion de la société française ». Une conception consacrée par le préambule de la Constitution de 1946 qui statue : « Tout bien, toute entreprise dont l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » (article 9).
Alors que les Trente Glorieuses avaient semblé rendre ce processus irréversible, la crise économique issue des deux chocs pétroliers des années 1973-1974 et 1979 a des conséquences délétères pour la philosophie du service public. Le ralentissement de la croissance et le chômage endémique qui frappent le pays au début des années 1980 transforment progressivement la perception de l’action publique, fragmentant le consensus qui s’était établi jusqu’alors. La droite, prise dans une vague de néolibéralisme venue des États-Unis et de Grande-Bretagne, critique durement les nationalisations de 1982 (qui voient les cinq premiers groupes industriels français, trente-neuf banques et deux compagnies financières devenir publics) et en vient à dénoncer le poids de la gestion et de la fonction publiques. Renouant avec ses vieilles habitudes que sont la dénonciation de l’incurie des fonctionnaires et celle de la gabegie de l’administration, la critique du service public prend de l’essor, alors que la gauche se convertit à l’idée d’un contrôle strict des comptes publics à partir du tournant de la rigueur, en 1983.
Ces attaques ont pour cible la croissance des effectifs de la fonction publique et du poids du secteur public qui pèse sur les prélèvements obligatoires, jugés trop élevés – ceux-ci représentent aujourd’hui près de 45 % du PIB, contre 15% avant la Première Guerre mondiale. Alors qu’une conception « organique » du service public privilégiait l’administration par la puissance publique de toute activité d’intérêt général, les privatisations consacrent l’idée qu’une gestion privée des services publics peut parfois se révéler plus efficace. La privatisation de France Télécom (devenue Orange) et d’Air France en 1997 et 1999, ainsi que l’ouverture du capital d’EDF en 2000 (qui demeure une entreprise publique) sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin marquent un tournant. La dérégulation décidée au niveau européen, qui enjoint les États nationaux à briser les monopoles étatiques et à privilégier l’ouverture à la concurrence et la privatisation des entreprises publiques, s’impose progressivement dans le droit national.
La demande de mise en concurrence des entreprises nationales, qui préserve jusqu’ici l’État-providence et les services sociaux, est concomitante de projets de réforme de l’État dans plusieurs directions. L’introduction de la notion de performance et de rentabilité des services publics, qui revient à devoir faire « mieux avec moins », est vécue par les fonctionnaires comme incompatible avec les valeurs du service public, auxquelles ils restent viscéralement attachés. Plus généralement, la délégation d’activités de service public à des entreprises privées ou la sous-traitance au secteur privé sont généralisées. Jacques Chevallier souligne que « les activités régaliennes ne le sont plus que de nom. Alors que la police relevait exclusivement de l’État, 175 000 personnes travaillent aujourd’hui dans la sécurité privée et l’État partage son ancien monopole avec l’Europe et les pouvoirs locaux. Le problème étant que la “coproduction de la sécurité” pose la question essentielle de la coordination de l’ensemble, l’un des enjeux saillants de l’action publique ».
Loin d’être exclusivement technique, la question est profondément politique. D’abord parce qu’elle structure plus que jamais le champ partisan, opposant d’un côté les défenseurs du service public à gauche et au Front national et de l’autre les tenants de la « réforme » de l’État. Perçue par les premiers comme un démantèlement de l’action publique, celle-ci est défendue à la fois par le gouvernement actuel et par Les Républicains. Elle réactive également l’opposition entre le « peuple » attaché à une France des places et des solidarités traditionnelles, et les élites « mondialisées » accusées de sacrifier le service public sur l’autel de la globalisation et de la construction d’une Europe libérale.
Dans une enquête de mars 2016, l’IFOP mettait en évidence le fait que l’absence de bureaux de poste dans une commune constituait le facteur favorisant le plus un vote FN. La défense des services publics est ainsi devenue depuis 2011, avec Marine Le Pen, une thématique largement reprise par le parti d’extrême droite, qui ne s’y trompe pas, et depuis peu, par le nouveau leader des Républicains, Laurent Wauquiez, qui ne manque jamais une occasion de prendre la défense des « enracinés » contre les « élites libérales ». Le thème historique du peuple contre les « gros », réactivé par des conflits de territoire et un sentiment de relégation de la « France périphérique », se cristallise notamment dans la question européenne. La fracture entre les défenseurs de l’Europe et ses contempteurs recoupe de manière croissante la question du service public. L’Union est accusée de vouloir la mort des services publics français, dont la défense encourage en retour le souverainisme, tendance particulièrement marquée au sein des électorats de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen ou de Nicolas Dupont-Aignan.
La relation des Français à leur service public est pourtant plus équivoque qu’il n’y paraît. Certes, toutes les enquêtes d’opinion démontrent l’attachement viscéral à l’idée de service public. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP, parle de « niveaux d’attachement massifs » aux activités régaliennes et à l’État-providence : dans une enquête datant de janvier 2017, 90 % des Français se disent attachés à l’hôpital public, 85 % à la Sécurité sociale, 78 % à l’Éducation nationale, 85 % à la gendarmerie et à la police, 72 % à la Justice. Pour autant, le sondeur souligne une relation plus ambivalente aux entreprises nationales : « Alors que l’attachement à la SNCF demeurait très fort jusque dans la dernière décennie, des interrogations sont apparues sur l’efficacité du service proposé et sa fiabilité. Et l’idée domine que l’ouverture à la concurrence va pouvoir conduire à une baisse des prix. » Cette mise en cause de certaines activités portées par l’État traduit une érosion des solidarités liée au creusement des écarts entre secteur public et secteur privé.
La majorité parlementaire de LREM, composée pour plus de moitié de salariés issus du secteur privé – fait inédit par son ampleur dans l’histoire de la Ve République –, est particulièrement sensible à cet argument et soutient sans réserve la réforme de la SNCF. Ce que déplore Luc Rouban : « Le problème actuel est la lecture trop économiste du service public. Tout le débat sur le statut des cheminots, sur la SNCF, passe sous silence la dimension identitaire du service public en France sous couvert que l’UE ne reconnaît pas cette notion mais seulement celle de biens collectifs et des services d’intérêt général. Macron réinvente la IIIe République et c’est toute l’utopie que représentait le service public qu’on met aujourd’hui à la poubelle. »
Ce que révèle cette nostalgie du service public est en réalité profondément ambivalent. À la fois liée à l’identité républicaine, à l’imaginaire historique des Trente Glorieuses et à une certaine conception de l’exceptionnalité française, elle traduit en même temps une forme de conservatisme, une résistance au néolibéralisme et un refus d’abandonner l’idéal d’intérêt général au cœur de la définition française de la citoyenneté. La question du service public est d’autant plus actuelle, dans une démocratie obsédée par l’égalité, que de nouveaux défis (la révolution numérique, le changement climatique) nécessitent, plus que jamais, une régulation des intérêts privés par une autorité impartiale au service de tous.
« Le service public constitue notre écosystème républicain »
Jean Garrigues
Depuis quand la notion de service public est-elle utilisée en France ?
C’est une notion qui a été définie par un juriste de l’entre-deux-guerres, Léon Duguit. Dans un traité de droit constitutionnel de 1923, il définit le service public comme un ensemble de services – qu’…
[Pantoufles]
Robert Solé
Il arrive qu’un fonctionnaire de police arrondisse ses fins de mois en se livrant à de petits travaux de maçonnerie, de peinture ou de gardiennage… Dans le jargon du métier, ce travail au noir s’appelle « la tricoche ».<…
Rail : l’envers du décor allemand
Manon Paulic
HAMBOURG. Gare centrale, quai no 12. Sous la gigantesque halle métallique, assise à l’extrémité d’un banc, Christine serre fort son café fumant entre ses mains. Cette Hambourgeoise de 59 ans, au visage pourt…