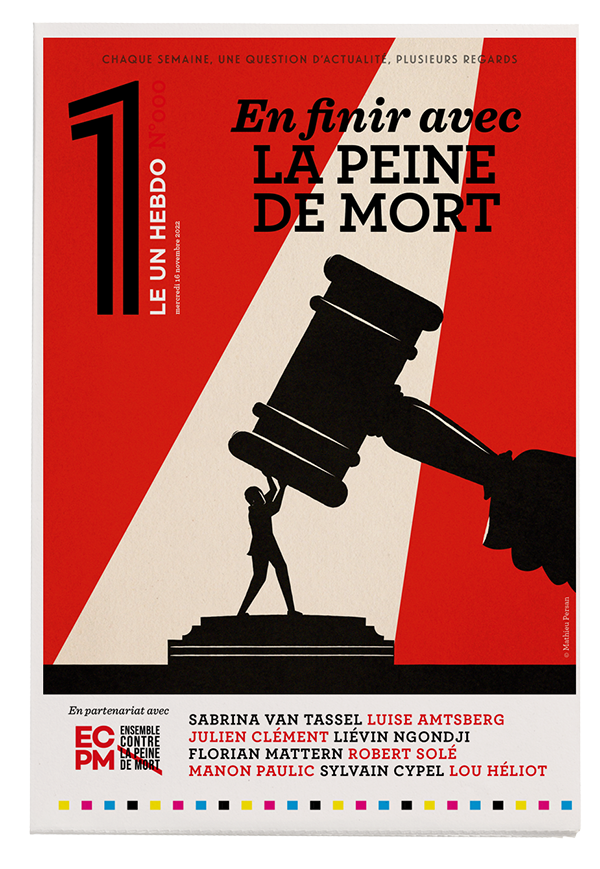La peine de mort a-t-elle toujours coexisté avec les sociétés humaines ? Peut-on assimiler à la peine capitale les sacrifices humains ou bien le mauvais sort jeté à un ennemi ? Ces questions demandent quelques mises en perspective.
1) Il faut distinguer la sanction pénale ultime des sacrifices humains. Les sacrifiés étaient généralement valorisés pour leurs caractéristiques : les vierges, chez les Aztèques, semblent avoir été immolées parce qu’elles étaient porteuses d’une vitalité offerte aux divinités. Pour elles, comme pour d’autres – souvent des jeunes –, il y avait des formes de préparation, comme l’absence de sommeil ou la consommation de certaines boissons ou substances. Le sacrifice humain constitue bien un rite spécifique, lié à des êtres invisibles.
2) On doit aussi éviter de comparer la peine capitale avec la vengeance mortelle perpétrée sur un adversaire ou le mauvais sort jeté à un ennemi. Faire couler le sang, ou jeter des malédictions, est fréquent, mais il s’agit de conflits entre deux parties, là où la peine de mort nécessite une instance judiciaire qui fait tiers.
3) Le fait de briser un tabou peut conduire à des formes de mort sociale. Le mot tapu vient du Pacifique, de Polynésie en particulier. Consommer un animal interdit, comme une tortue, dans certaines sociétés, provoque peu à peu la mort de la personne en raison de suggestions psychiques ayant des effets physiques. Il ne s’agit pas d’une peine de mort, même si la société entraîne indirectement la mort d’un individu par le tabou brisé.
Tous ces exemples permettent de caractériser la peine de mort. Cette dernière est définie par trois éléments : un crime défini, une instance judiciaire tierce et une mise à mort de l’individu. Il n’y a là ni sacrifice, ni vengeance, ni conditionnement psychique. Le philosophe Michel Foucault, dans son livre de 1975 Surveiller et punir, montre le passage en France, à la fin du XVIIIe siècle, d’une justice de châtiments corporels, censés servir d’exemple et effrayer pour prévenir d’autres crimes, à des institutions de discipline telles les prisons où l’on mate les corps sans les châtier. La surveillance se généralise alors, avec des objectifs de prévention et d’identification des individus dangereux, pour tenter d’éteindre l’effroi public. On en connaît les formes contemporaines, qui vont des caméras de surveillance au traçage en ligne.
Avec cette métamorphose du droit, l’objet de la punition a changé : c’est l’intériorité que l’on vise, et non le corps lui-même. La peine de mort n’est plus l’ultime châtiment corporel. C’est l’individu dangereux que l’on doit tenir à distance, ou transformer pour le remettre dans le droit chemin – et le chemin du droit. La prévention se passe du spectacle des exécutions. Soit la puissance publique y renonce, soit la « cérémonie » de l’exécution déserte les places publiques pour être reléguée dans l’enceinte des prisons. La discipline tend à se passer de la suppression physique à laquelle elle préfère l’enfermement. Lorsque cette transformation sociale a lieu, la peine de mort n’a plus de place, et plus d’objet.
Pour conclure, comme le dit Michel Foucault, il faut continuer à interroger les formes de jugement et de punition. La clémence impose de dégager chez chacun la part d’humanité que la peine de mort avait vocation à faire disparaître, à jamais, en passant par le corps pour tuer l’âme elle-même.