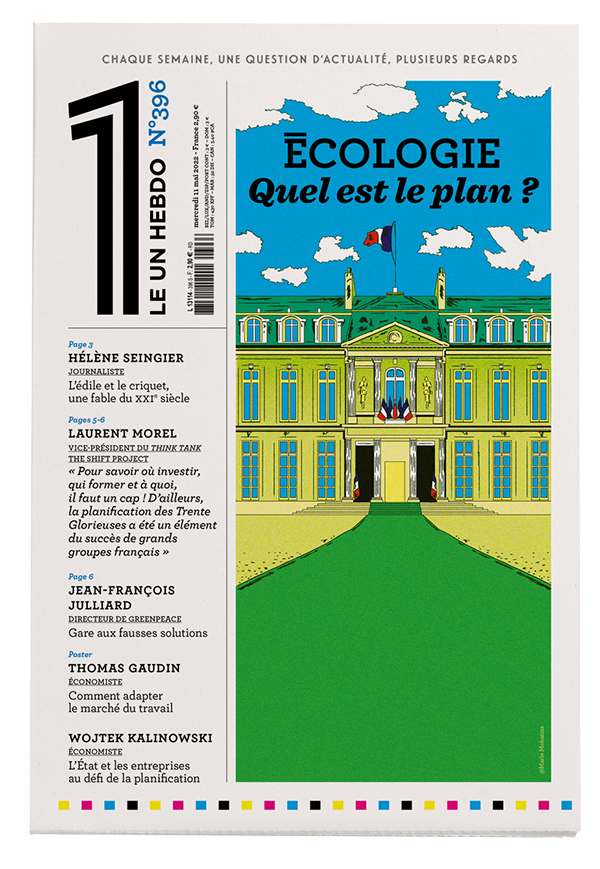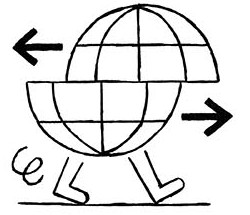Industrie : planifier au plus près des besoins
Temps de lecture : 7 minutes
À l’été 2021, la presse suédoise annonçait que le sidérurgiste SSAB venait de livrer une commande d’acier entièrement décarboné, c’est-à-dire produit sans recours à des sources d’énergie fossiles. Une première mondiale et une source de fierté industrielle pour un pays connu pour ses exportations, mais aussi pour son ambition d’être à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. Si la production d’acier représente à elle seule entre 5 et 7 % des émissions des gaz à effet de serre (GES) globales, c’est qu’elle nécessite des températures extrêmement élevées, entre 1 200 et 1 400 °C, voire plus, et que l’intrant dominant a jusqu’ici été le coke de charbon. À la place, SSAB utilise de l’hydrogène produit uniquement à partir de sources renouvelables.
Difficile d’imaginer exemple plus parlant d’une stratégie d’entreprise qui s’inscrit dans la politique climatique et y trouve son nouveau modèle économique. L’acier décarboné sort actuellement de la phase expérimentale, et SSAB promet de terminer la conversion en 2030, soit quinze ans plus tôt que prévu initialement. Le gouvernement se félicite déjà d’une baisse de 10 % de l’ensemble des émissions de GES territoriales suédoises, tandis que les carnets de commandes de l’industriel se remplissent par anticipation ; en 2021 déjà, le producteur d’automobiles Volvo exposait le premier véhicule produit à partir d’acier décarboné, et les premiers modèles commercialisés sont prévus pour 2026.
Naturellement, SSAB sera bientôt suivi par d’autres aciéristes européens ; les recherches et les expérimentations vont bon train un peu partout et l’on opte pour des solutions techniques différentes. Mais, globalement, la lenteur des transformations industrielles contraste avec l’urgence climatique. En France, l’État a annoncé en février dernier un soutien financier massif à la conversion des deux sites d’ArcelorMittal (Dunkerque et Fos-sur-Mer) qui ne devront plus émettre « que » 8 millions de tonnes de CO2 par an d’ici à 2030, contre 12 millions actuellement. Et l’industrie n’est pas la seule à être concernée par ce problème ; on pourrait en dire autant de l’agriculture française, dont la part des terres cultivées en bio (10 %) est à la traîne en comparaison de l’Autriche (25 %) ou de la Suède (20 %).
La planification paraît plus efficace en Suède
Comment expliquer ces différences de vitesse, alors que les objectifs semblent les mêmes ? En partie par la planification, qui paraît plus efficace en Suède, bien que le pays n’ait jamais connu de « plans » comparables à ceux mis en œuvre en France dans les décennies d’après-guerre. Cette planification est souvent décentralisée et menée par les collectivités, le rôle de l’État central étant de fixer les obligations de résultat. Elle s’opère aussi dans les entreprises elles-mêmes, qui anticipent plus ou moins activement les changements à venir. Dans le cas de l’acier suédois, elle a pris la forme d’une coopération entre les trois grands industriels qui organisent la filière : SSAB, le producteur de minerai de fer LKAB et le producteur d’électricité Vattenfall. Ensemble, ils ont investi dans le développement d’une technologie nouvelle (Hybrit), en profitant des aides publiques lors de la phase de recherche expérimentale – pour des sommes d’ailleurs bien plus modiques (environ 70 millions d’euros) que celles que l’État français et l’UE viennent d’accorder à ArcelorMittal (1,7 milliard d’euros).
Les aides publiques ne sont ainsi qu’un élément parmi d’autres. Il en va plus fondamentalement de la capacité de l’État non seulement d’indiquer la direction à suivre, mais aussi d’entraîner réellement les entreprises et les consommateurs. C’est là où le bât blesse en France, pays dont les politiques publiques sont erratiques et mal suivies dans les faits, au point qu’elles n’arrivent pas à projeter la société et l’économie dans une trajectoire de transition crédible. On l’a vu avec l’abandon de la taxe carbone fin 2018, mais on pourrait donner bien d’autres exemples, notamment dans le domaine de la protection de la biodiversité. Il n’en va pas de telle ou telle mesure prise individuellement, mais de la cohérence d’ensemble. Les outils dont les deux pays disposent sont plus ou moins les mêmes : taxes, subsides et investissements publics, mais aussi normes et standards de production (concernant, entre autres, les taux d’émissions de polluants des voitures, ou le dosage des produits phytosanitaires agricoles), quotas (comme dans le cas du système européen des quotas d’émissions) ou encore interdiction pure et simple de certains produits ou procédés. L’essentiel est la capacité de choisir un cap et de s’y tenir, d’inscrire une politique dans la durée et de la rendre crédible aux yeux des acteurs économiques de la société.
En l’occurrence, l’avance prise par SSAB sur ses concurrents internationaux montre que les entreprises suédoises anticipent de longue date une politique climatique menée par l’État avec beaucoup de constance. L’exemple le plus connu de cette politique est la taxe carbone suédoise : introduite dès 1991 dans le cadre d’une réforme fiscale globale longuement négociée au Parlement et bénéficiant d’un vaste soutien transpartisan, elle a été progressivement augmentée et affiche aujourd’hui le taux le plus élevé du monde.
Le progrès technique ne suffira pas à nous mettre sur la voie d’une société durable
Cette façon d’encastrer les actions menées par les entreprises dans une planification publique plus globale est indispensable si nous voulons réellement répondre à la crise écologique. Car SSAB va continuer de vendre son acier à qui veut l’acheter, même si l’on s’aperçoit que ses ventes ne remplacent pas l’acier fossile comme on pouvait espérer, mais s’y ajoutent plutôt, de sorte que le résultat global est une surconsommation et non une transformation – c’est l’« effet rebond », bien connu des chercheurs, qui veut que les économies d’énergie ou de ressources permises par l’innovation se trouvent dans les faits contrebalancées par une augmentation de la consommation, ce qui explique pourquoi le seul progrès technique ne suffira jamais à nous mettre sur la voie d’une société durable.
L’effet rebond n’est pas l’affaire de SSAB et c’est normal, mais, après tout, il s’agit de faire avancer la transition énergétique et écologique. La différence entre une planification au niveau des entreprises et celle qu’on mène à l’échelle de la société vient justement du fait que la transition recouvre des problèmes de nature très diverse. En simplifiant, distinguons trois groupes de cas :
- La transition fait émerger des modèles économiques viables à court ou moyen terme. La planification publique est souvent nécessaire dans la phase de démarrage. Elle peut, par exemple, prendre la forme d’une politique de tarifs d’achat pour soutenir l’émergence des énergies renouvelables.
- La transition doit faire émerger des infrastructures plus sobres ou aménager les territoires. Pensons au problème de la reconversion thermique de bâtiments anciens, au tracé de certaines lignes ferroviaires, à la question du fret fluvial. Ces opérations peuvent, en théorie, être rentables, mais au bout de longues décennies et les incertitudes sont telles que la finance privée n’ose pas s’engager, d’où une situation de sous-investissement privé massif.
- Des transformations sont nécessaires, mais ne seront jamais rentables au sens financier du terme. Songeons à la protection de la biodiversité, aux dépenses relatives à la « transition juste» et aux mesures d’accompagnement, comme la mise en place d’une offre de qualité et très accessible de programmes de requalification pour les salariés des secteurs en déclin. C’est également le cas de nombreuses infrastructures, et de la qualité du service qu’elles proposent. Prenons l’exemple des transports en commun : si l’on veut que les habitants laissent leur voiture à la maison, il faut que le train passe toutes les dix minutes et non deux fois par heure.
Autrement dit, il est bien plus aisé de planifier la transition là où elle est une affaire potentiellement rentable (premier cas) ; tout le problème est de savoir comment agir là où elle ne l’est pas. Or, les différents plans d’investissement « verts » – par exemple, celui qui accompagne le « Pacte vert » de l’UE – accordent la priorité aux domaines les plus faciles à développer, comme les énergies renouvelables ou les batteries électriques, simplement parce qu’ils reposent en grande partie sur des cofinancements privés. Vu la pression sur les finances publiques, les décideurs ont tendance à s’en remettre aux engagements volontaires des entreprises et à la transparence des marchés – favorisée par un cadre de reporting extrafinancier amélioré, une notation ESG (environnement, social, gouvernance), un label, un standard européen d’obligation verte…
L’idée sous-jacente semble qu’en rendant visibles les impacts négatifs des activités économiques, on finira par convaincre les entreprises et les investisseurs d’aller dans la direction souhaitée. Comme le montre l’impasse de la « finance verte », c’est plutôt un leurre. Bien plus, il nous faut une planification écologique adaptée à chaque type de problème à résoudre et capable d’allouer les financements nécessaires lorsque le secteur privé fait défaut.
« Planifier est un moyen de sortir de l’inquiétude par l’action »
Laurent Morel
Le vice-président du think tank The Shift Project, Laurent Morel, expose les grandes lignes du « Plan de transformation de l’économie française » développé par son organisation.
[Chinois]
Robert Solé
Si le général de Gaulle revenait sur terre, comprendrait-il un traître mot à la planification écologique ?
Fret : le ferroviaire et le fluvial sommés de mieux faire
Florian Mattern
Avec respectivement 9 % et 3 % des parts de marché, trains et barges font aujourd’hui en France figure d’acteurs mineurs, alors même qu’ils sont nettement moins polluants.