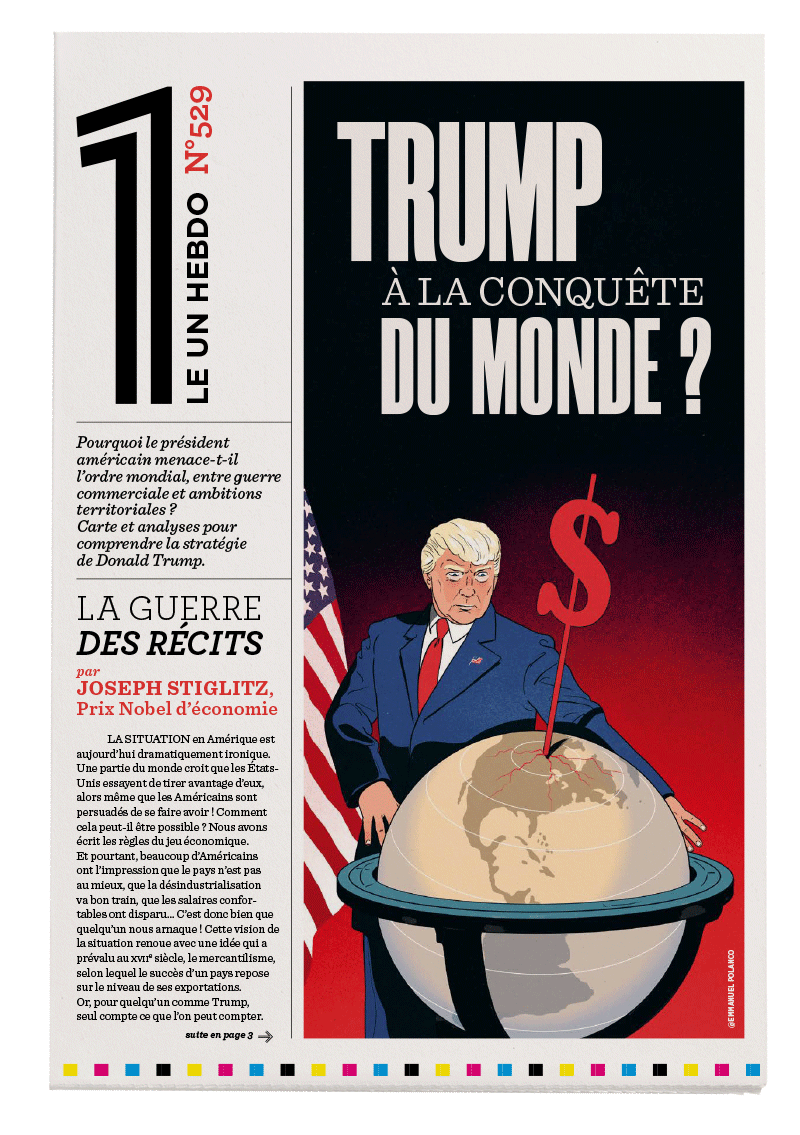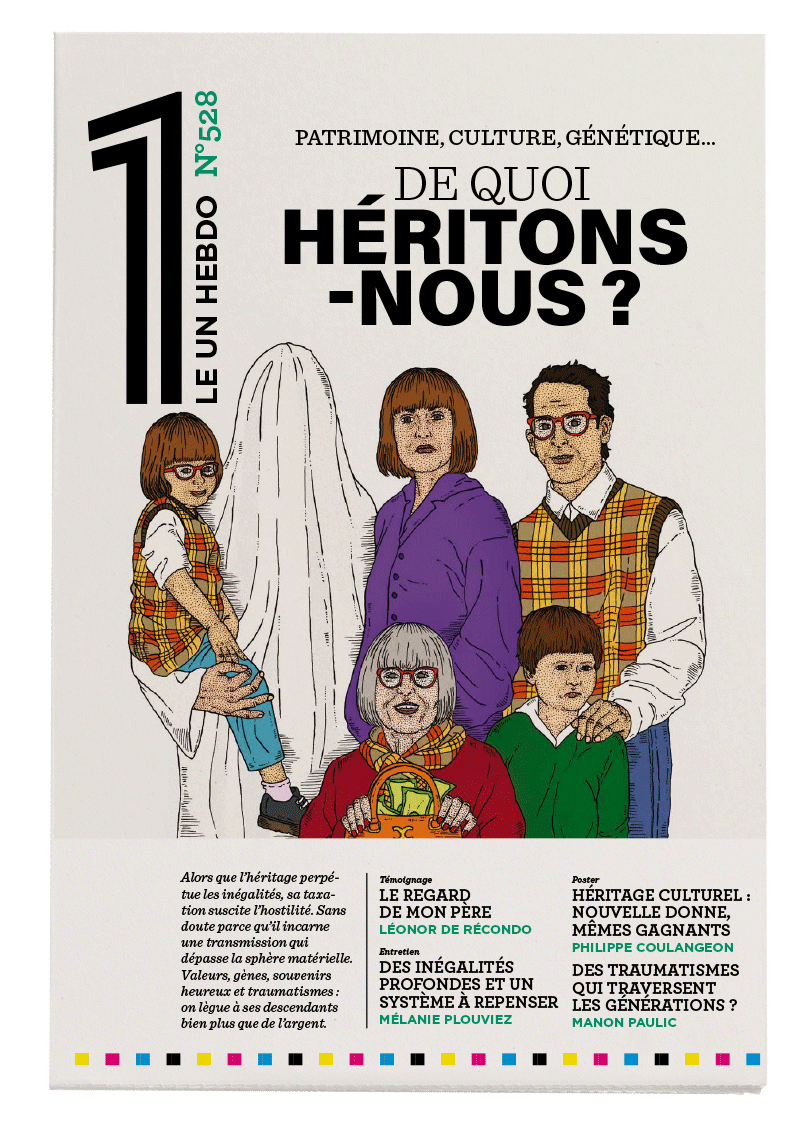« L’enjeu est d’accepter un État palestinien pour sauver l’État d’Israël »
Temps de lecture : 11 minutes
À quoi Gaza ressemblait-elle avant la Nakba ?
Géographiquement, Gaza est le point de jonction entre l’Afrique et le Moyen-Orient et, si l’on resserre la focale, entre l’Égypte et l’espace israélo-palestinien. Historiquement, la région de Gaza a toujours été un nœud de communication, une synapse entre ces deux mondes, et cela depuis l’Antiquité lorsque Gaza était une cité-État particulièrement prospère. Au Moyen Âge, c’est un berceau du monachisme byzantin, ce dont témoignent aujourd’hui les fouilles archéologiques du monastère Saint-Hilarion. À l’époque ottomane, les commerçants, les pêcheurs et les agriculteurs de Gaza sont réputés pour la qualité et l’abondance de leurs produits. C’est donc tout le contraire d’une région marginalisée, pauvre et désertique. C’est également une ville rebelle et combattante, très jalouse de son autonomie : en 1917, les troupes britanniques doivent s’y reprendre à trois fois avant de s’emparer de Gaza.
Ce n’est qu’avec la Nakba de 1948 que ce qu’on appelle aujourd’hui la « bande de Gaza » se transforme en une agrégation d’immenses camps de réfugiés, avec l’arrivée de plus de 170 000 Palestiniens à l’issue de la première guerre israélo-arabe. La zone est alors administrée par l’Égypte, mais sans y être annexée. Notons également qu’à l’issue de la guerre des Six Jours de 1967, les Israéliens mettront quatre longues années avant de prendre définitivement le contrôle de la bande de Gaza, du fait d’une résistance palestinienne particulièrement déterminée.
Pourquoi Gaza est-elle au cœur de la résistance palestinienne ?
La très grande majorité des habitants actuels de Gaza sont les descendants de familles palestiniennes qui habitaient jusqu’en 1948 à Jaffa, à Jérusalem, à Beer-Sheva ou dans l’une des quatre cents localités palestiniennes détruites et vidées de leurs habitants par l’armée israélienne en 1948-1949. Les Gazaouis sont donc intimement connectés aux différents territoires palestiniens. On est loin du simple folklore : chaque famille sait exactement d’où elle vient. Au départ, les camps de réfugiés étaient d’ailleurs structurés selon l’origine de leurs habitants : chaque camp, chaque quartier, chaque rue étaient rattachés à une région ou à un village de Palestine. Même si l’armée israélienne a tenté de fragiliser ces solidarités en reconfigurant la géographie des camps après 1971, ces liens continuent d’imprégner aujourd’hui les 2,3 millions d’habitants de la bande, et de nourrir ce que Jean-Pierre Filiu appelle, dans son Histoire de Gaza parue chez Fayard en 2012, « une communauté de douleurs et de rancœurs ». Ce point est essentiel pour comprendre les « marches du retour » de 2018-2019.
En quoi consistaient ces marches du retour ?
Il s’agissait de manifestations massives de civils gazaouis en direction de la barrière de sécurité, pour dénoncer le blocus israélien imposé depuis 2007 et exprimer leur revendication d’un droit au retour. Ces mobilisations répondaient à un appel du Hamas, qui souhaitait impliquer de manière visible les civils palestiniens dans la lutte nationale. Le bilan fut très lourd, avec plus de deux cents morts palestiniens par des tirs directs à balle réelle, et plusieurs milliers de blessés graves, dont de nombreux amputés.
Le choix du Hamas de nommer l’attaque du 7 octobre « Déluge d’Al-Aqsa » a-t-il pour objectif de rappeler le lien des Palestiniens à Jérusalem ?
Absolument. La défense de la mosquée Al-Aqsa est désormais l’un des pivots stratégiques du Hamas. C’est efficace pour au moins deux raisons : le dôme du Rocher, monument central et fondateur de la mosquée Al-Aqsa, est un emblème essentiel pour tous les Palestiniens musulmans. Inauguré en 692, aux premiers temps de l’Islam, c’est le plus ancien monument islamique conservé au monde. Le dôme du Rocher figure d’ailleurs en majesté sur le drapeau du Hamas. En outre, les provocations récentes du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir permettent à cette organisation de mobiliser la population contre une menace réelle, visible et crédible.
Comment la naissance du Hamas s’inscrit-elle dans l’histoire du conflit israélo-palestinien ?
Le Hamas est créé officiellement en 1987, au moment où l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) entame un chemin vers la reconnaissance internationale en tant que représentante officielle des droits des Palestiniens. À l’époque, la charte de l’OLP visait l’instauration d’un État de Palestine souverain et indépendant sur la totalité de la Palestine mandataire, de la mer au Jourdain, ce qui sous-entendait donc une destruction de l’État d’Israël. En 1989, sous l’amicale pression de François Mitterrand et pour ouvrir une perspective de négociation qui débouchera sur le processus d’Oslo, Yasser Arafat déclare que cette charte est « caduque ». Le Hamas prend donc la place laissée libre par l’OLP, avec un combat radical appelant à la destruction de l’État d’Israël et prônant l’instauration d’un État de Palestine régi par la loi islamique. Le Hamas, émanation des Frères musulmans, se distingue ainsi radicalement des mouvements laïcs et marxistes qui constituaient la colonne vertébrale de l’OLP.
Comment le Hamas a-t-il gagné l’intérêt de la communauté internationale ?
En plusieurs étapes. Après avoir remporté les élections législatives de 2006, la branche politique du Hamas souhaite devenir un interlocuteur crédible et fréquentable pour la communauté internationale. En 2011, elle fait un premier pas dans cette direction en déclarant que sa charte de 1988 – véritable tissu de délires antisémites – ne doit pas être interprétée dans un sens littéral. En 2017, le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, va plus loin en rendant publique une version amendée de la charte, qui revendique désormais « un État palestinien souverain et indépendant dans les frontières de 1967 ».
« L’enjeu n’est pas de raisonner les Israéliens, mais de les ceinturer, comme on le ferait pour un ami qui s’apprête à commettre l’irréparable »
Finalement, en trente ans – le Hamas entre 1987 et 2017, l’OLP entre 1964 et 1994 –, ces deux mouvements nationalistes ont suivi un même cheminement les conduisant à une reconnaissance de facto de l’État d’Israël. Mais, dans les deux cas, ce chemin n’a pas fait consensus : comme jadis le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) vis-à-vis du Fatah de Yasser Arafat, la branche militaire du Hamas n’a jamais validé cette stratégie de dédiabolisation entamée par sa branche politique. C’est sans doute une des explications de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, dont on sait aujourd’hui qu’elle a été planifiée par la seule branche militaire du Hamas.
Quel rapport les Gazaouis entretiennent-ils avec le Hamas ?
Dans un contexte autoritaire, il est toujours difficile d’évaluer précisément le positionnement des opinions publiques. Mais, lors de mes rares visites à Gaza – la dernière a eu lieu en juin dernier, à l’invitation de l’Institut français –, j’ai pu constater combien la société civile gazaouie est plurielle, curieuse et avide de connaissances. Elle n’adhère pas en bloc au programme sociopolitique du Hamas, en particulier concernant le statut des femmes, elle critique son inefficacité et sa brutalité. Mais elle n’exprimera pas ces réserves publiquement, à la fois par peur des représailles et pour ne pas risquer d’affaiblir la résistance armée, qui fait consensus au sein de la population.
Quelle est l’influence du Hamas au-delà de la bande de Gaza ?
Les dernières élections législatives remontent à 2006 et elles ont été largement remportées par le Hamas, y compris en Cisjordanie. Celles qui étaient prévues en 2021 ont été annulées au dernier moment par Mahmoud Abbas. De ce fait, les seuls capteurs dont on dispose aujourd’hui en Cisjordanie sont les élections universitaires et les élections municipales. À chacun de ces scrutins, le Hamas gagne du terrain. Cette montée en puissance prospère sur la crise de légitimité de l’Autorité palestinienne, minée par une corruption endémique et par l’échec du processus d’Oslo.
Que vous inspirent les débats, en France, pour savoir s’il faut qualifier le Hamas de « terroriste » ou de « criminel de guerre » ?
Colère, exaspération et tristesse. Ces débats sont ineptes et inopérants car ils n’ont aucune prise sur le réel. Ils sont totalement décalés par rapport à la gravité de la situation et uniquement indexés sur des agendas de petite politique française. Deux voix sortent du lot et sauvent l’honneur, celle de Jean-Louis Bourlanges à droite et de François Ruffin à gauche : tous les deux, chacun sur une ligne politique différente, s’expriment avec gravité, sincérité et profondeur historique.
Comment peut-on hésiter à qualifier l’attaque du 7 octobre d’opération terroriste ? Des civils mitraillés, des enfants égorgés, des femmes éventrées, des blessés brûlés vifs, des victimes filmées avec des caméras GoPro, puis exhibées sur les réseaux sociaux : ce ne sont pas là les « dégâts collatéraux » d’une opération militaire, ce ne sont donc pas seulement des « crimes de guerre ». C’est une stratégie délibérée, destinée à terroriser et à horrifier toute la société civile israélienne, bien au-delà des seules victimes directes. C’est donc la définition presque exemplaire d’une opération « terroriste ».
« Le mot « terrorisme » ne devrait donc pas être le point d’arrivée de la discussion, mais au contraire son point de départ, et pas seulement sur un plan éthique »
Ce qui me désole, en tant qu’historien, c’est que tout cela n’a pas été inventé le 7 octobre 2023. Après tout, à l’extrême gauche du champ politique – rappelons-nous les Brigades rouges ou Action directe –, on ne manque pas de références intellectuelles et historiques pour discuter des rapports entre terrorisme, mouvements de résistance et radicalisme politique ! À droite également, les héritiers du gaullisme devraient se souvenir que les résistants des années 1940 étaient qualifiés de « terroristes » par les forces d’occupation et de collaboration. Sans parler de l’extrême droite, héritière des terroristes de l’OAS qui assassinaient les civils en Algérie et en métropole en imaginant faire ainsi bifurquer la guerre d’Algérie. L’explication réside peut-être là, justement, dans les replis honteux et mal digérés de l’histoire politique française : du fait de sa coloration aujourd’hui exclusivement islamiste, le mot « terrorisme » est devenu une insulte infamante, sidérante, coupant court à toute discussion, alors qu’il fait partie du vocabulaire de l’action politique radicale depuis la Révolution française, à gauche comme à droite.
Selon moi, le mot « terrorisme » ne devrait donc pas être le point d’arrivée de la discussion, mais au contraire son point de départ, et pas seulement sur un plan éthique. Qualifier l’attaque du 7 octobre 2023 d’action terroriste n’est pas qu’une exigence morale, c’est également la condition de son appréciation politique : c’est seulement à ce prix qu’on pourra évaluer la portée de cet événement et donc espérer peser sur ses conséquences à court, moyen et long terme.
Justement, comment comprendre les objectifs du Hamas ?
On ne peut que les présumer : replacer la question palestinienne au cœur de l’agenda diplomatique ; remettre la solution à deux États sur la table ; freiner, voire reporter aux calendes grecques, les accords d’Abraham visant à une normalisation des relations entre Israël et les États arabes au détriment de la question palestinienne ; modifier durablement le rapport de force et faire en sorte que la peur change de camp. Tous ces objectifs ont été atteints.
Mais, au-delà ? Ma conviction est que le Hamas cherche à faire tomber Israël dans un double piège, stratégique et moral. Sur le plan stratégique, le Hamas veut faire entrer les troupes israéliennes au cœur de la bande de Gaza car il sait que, dans une telle densité urbaine, les combats donnent toujours l’avantage aux défenseurs, surtout s’ils sont prêts à perdre plus d’hommes que les assaillants. Ce piège est d’autant plus redoutable que la menace du Hezbollah sur la frontière nord empêchera les Israéliens de positionner toutes leurs forces à Gaza.
« Des crimes de guerre sont déjà à déplorer, il n’y a aucun doute sur ce point »
Quant au piège moral, il est totalement cynique et consiste à attendre patiemment que l’opinion publique internationale se retourne contre Israël, à la suite des crimes de guerre commis contre la population civile de Gaza. C’est le résultat d’une analyse lucide de la situation : l’image d’Israël s’est considérablement dégradée depuis plusieurs mois, du fait du gouvernement d’extrême droite suprémaciste qui assume ouvertement de mener une politique d’apartheid en Cisjordanie. L’ampleur des premières manifestations de soutien aux Palestiniens montre que ce calcul est conforme à la réalité actuelle de l’opinion publique internationale vis-à-vis d’Israël.
Comment qualifier l’impact qu’a sur les civils palestiniens la réponse d’Israël à cette attaque terroriste ?
Des crimes de guerre sont déjà à déplorer, il n’y a aucun doute sur ce point : 2,3 millions d’habitants soumis à un siège total, privés de nourriture, d’électricité et d’eau potable, sans aucune échappatoire possible ; plus d’un million de déplacés ; des infrastructures de santé totalement effondrées. Le bilan humain est également effroyable, du fait des bombardements massifs et incontrôlés : 7 000 morts, dont plus de 2 000 enfants, en dix-huit jours, c’est plus que les 5 000 personnes tuées à Gaza depuis… dix-huit ans, entre 2005 et septembre 2023. Souvenons-nous que l’opération « Plomb durci » avait fait 1 300 morts en 2008 et que la dernière guerre entre Israël et le Hamas, à l’été 2014, avait fait 2 000 morts en plus de six semaines. Comme ce qui s’est passé le 7 octobre en Israël, ce qui se déroule sous nos yeux à Gaza est donc, à proprement parler, inouï et sans précédent.
Que peuvent faire la France et le reste de la communauté internationale ?
Je ne suis pas de ceux qui ironisent sur l’inutilité de l’outil diplomatique, pour deux raisons. D’abord, parce que le conflit israélo-palestinien a été généré et paramétré par la communauté internationale, dès son origine : en 1917, la Société des nations confie un mandat aux Britanniques ; en 1947, l’ONU vote le plan de partage de la Palestine. C’est donc un conflit indissociablement national et international, par conséquent les puissances n’ont pas d’autre choix que de s’y confronter. Même si, depuis une quinzaine d’années, elles ont fait semblant de croire que ce conflit n’existait plus – une erreur funeste que les Israéliens et les Palestiniens payent aujourd’hui de leurs vies.
Désormais, l’enjeu n’est pas forcément d’argumenter, de chercher à raisonner les Israéliens, rendus logiquement enragés par la cruauté horrifique des attaques du 7 octobre. L’enjeu est plutôt de les entourer et de les ceinturer, comme on le ferait pour un ami qui s’apprête à commettre l’irréparable.
À plus long terme, la solution d’un État palestinien est-elle audible aujourd’hui pour les Israéliens ?
Oui, car cette solution a totalement changé de signification depuis le 7 octobre. Finalement il ne s’agit plus, pour les Israéliens, d’accepter l’existence d’un État palestinien parce que ce serait moralement légitime. Il s’agit désormais de se rallier à cette solution pour préserver leur propre sécurité et pour sauver l’existence même de l’État d’Israël.
Propos recueillis par MANON PAULIC
« L’enjeu est d’accepter un État palestinien pour sauver l’État d’Israël »
Vincent Lemire
« Les Gazaouis sont intimement connectés aux différents territoires palestiniens. On est loin du simple folklore : chaque famille sait exactement d’où elle vient », explique l’historien Vincent Lemire qui retrace l’évolution de ce territoire et la façon dont le Hamas a pu s’y imposer, avant d’ana…
[Prénoms]
Robert Solé
Ils étaient ensemble sur la photo : le père, Nidal Al-Sékali, un chômeur de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, âgé de 30 ans ; son épouse, Islam, 25 ans, voilée de la tête aux pieds, et leurs triplés, deux garçons et une fille, qui étaient nés quelques semaines plus tôt.
365 km2, 2,1 millions d’habitants… Quelques données sur la bande de Gaza
Hélène Seingier
Démographie, santé, économie, emploi, politique… La journaliste Hélène Seingier a réuni tout un panel d’informations, présentées sous la forme d’une fiche d’identité synthétique qui offre un regard global sur ce qu’était la situation de ce territoire étroit et surpeuplé à la veille de la guerre. …