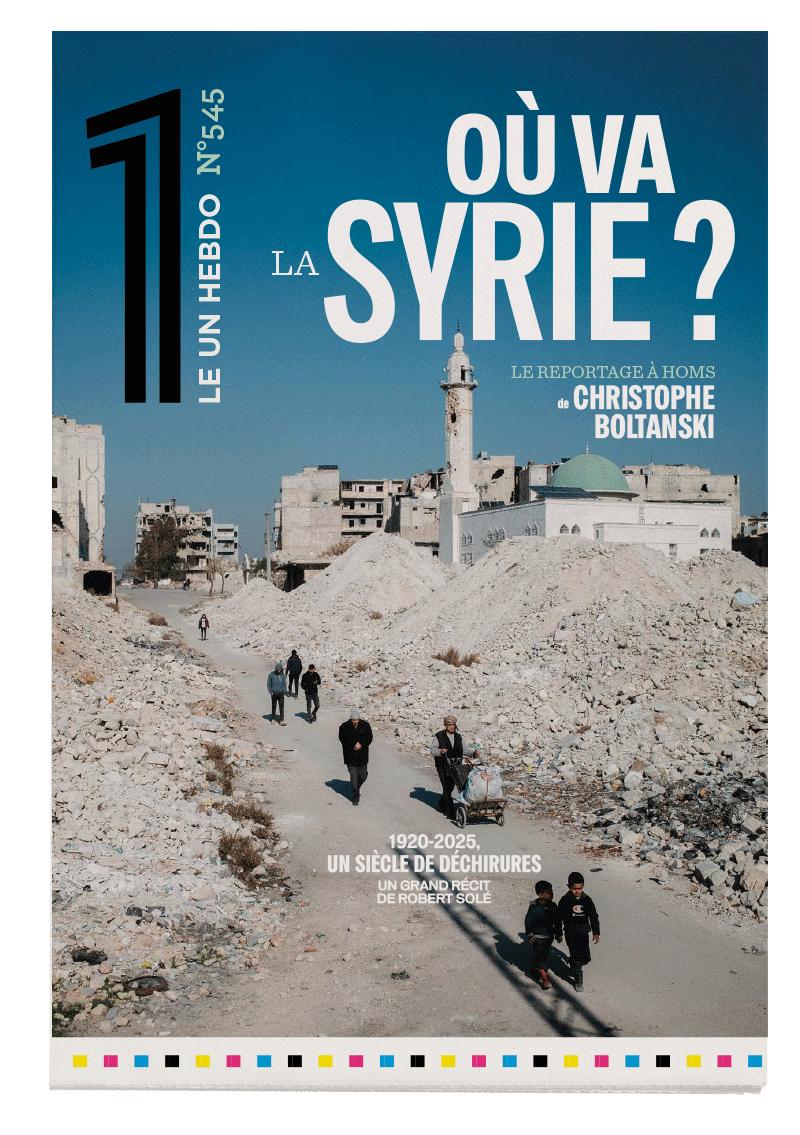« On peut nourrir correctement la population, réduire les pollutions et créer des emplois »
Temps de lecture : 8 minutes

Dans quelle mesure la France produit-elle sa nourriture ?
Sur le papier, elle est totalement à l’abri des pénuries : elle exporte plus qu’elle n’importe – le différentiel représentant l’équivalent de 9 % de ses terres agricoles. Mais, en réalité, la France ne produit que 63 % de son alimentation. La moitié de ses fruits et légumes et tout le soja qui nourrit son bétail viennent de l’étranger.
Certaines exportations sont nécessaires, par exemple la vente de céréales à des pays qui ont peu de terres fertiles et une forte démographie. Mais d’autres échanges ont des raisons purement économiques. La France importe ainsi globalement autant de tournesol qu’elle en exporte ! Avec la guerre en Ukraine, on se retrouve en pénurie alors qu’on produit en excédent.
Par ailleurs, la marge de manœuvre agricole du pays diminue, pour trois raisons : la population croît, nous perdons des dizaines de milliers d’hectares de terres agricoles par an et le changement climatique limite les rendements.
En quoi l’évolution du climat va-t-elle influencer l’avenir agricole et alimentaire du pays ?
Il n’y a pas de climatosceptiques chez les agriculteurs : ils expérimentent au quotidien le changement climatique. Cette année, certains éleveurs ont dû abattre leurs bêtes, faute d’herbe pour les nourrir en raison de la sécheresse ; des fruiticulteurs ont perdu leur récolte à cause du gel tardif ; et les chaleurs précoces ont entraîné l’échaudage des céréales, c’est-à-dire une maturation trop rapide du grain.
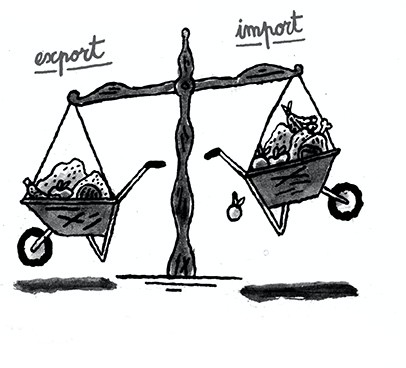
L’eau aussi va devenir un facteur limitant : l’irrigation bénéficie en grande partie au maïs-grain – qui sert à nourrir les poulets et les porcs – alors qu’il faudrait arroser avant tout les fruits et légumes. Il faudrait aussi se tourner vers des plantes adaptées à la sécheresse, comme le sorgho, ou planter des arbres dans les champs pour créer de l’ombre et produire en agroforesterie. L’inventivité va devenir le maître-mot. L’agriculture émet 20 % de nos gaz à effet de serre, mais constitue aussi une partie de la solution car elle stocke du carbone [en faisant pousser des végétaux, NDLR].
Vous avez participé à l’élaboration du scénario Afterres 2050, qui décrit l’alimentation et l’agriculture de demain. Quelles en sont les grandes lignes ?
Il démontre qu’on peut nourrir correctement la population française tout en divisant par deux les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture, en réduisant les pollutions et en créant des emplois. Il faut pour cela changer notre régime alimentaire et orienter les pratiques agricoles vers l’agroécologie.
Le système agricole actuel ne permet-il donc pas de relever le défi ?
 Depuis les années 1960, les fermes françaises se spécialisent, se mécanisent et intensifient leur production, en utilisant beaucoup de produits de synthèse. Les territoires, eux, perdent en diversité. Plus de 50 % des porcs et des volailles sont élevés en Bretagne, la production laitière se concentre dans le Grand Ouest, etc. Cela entraîne beaucoup de transport et donc de pollution.
Depuis les années 1960, les fermes françaises se spécialisent, se mécanisent et intensifient leur production, en utilisant beaucoup de produits de synthèse. Les territoires, eux, perdent en diversité. Plus de 50 % des porcs et des volailles sont élevés en Bretagne, la production laitière se concentre dans le Grand Ouest, etc. Cela entraîne beaucoup de transport et donc de pollution.
Autres impacts négatifs : environ 35 % des nappes phréatiques sont polluées par les pesticides, la biodiversité est en péril, et des études montrent que consommer des aliments contaminés par les pesticides augmente les risques de cancers, de diabètes de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Ces maladies chroniques coûtent 4,5 milliards d’euros par an, soit… la moitié du budget de la PAC.
« La France importe globalement autant de tournesol qu’elle en exporte ! Avec la guerre en Ukraine, on se retrouve en pénurie alors qu’on produit en excédent »
Le Programme national nutrition santé (PNNS), qui, à nos yeux, est aussi important que la PAC, donne le ton : il est urgent de consommer plus de produits végétaux, mais non traités. À la célèbre phrase « Mangez 5 fruits et légumes par jour », il faudrait ajouter « et non contaminés par les pesticides » !
À quoi ressemblerait, selon votre scénario, une production plus durable ?
Un système plus vertueux existe, à travers l’agriculture biologique, les appellations d’origine contrôlée (AOC) ou les ventes en circuit court. Il ne demande qu’à être développé. Dans la haute vallée de l’Aude, par exemple, une ferme de vaches tarasconnaises s’est diversifiée en cultivant des céréales mais aussi un hectare de pommes de terre et un demi-hectare de carottes. Ces deux cultures lui rapportent plus que la vente de la viande ! Dans l’Ouest, les prairies-vergers permettent d’élever des ovins à l’ombre de pommiers. Au lieu de mettre en moyenne 35 traitements chimiques par an sur ces fruitiers, on plante des variétés rustiques et non traitées. Le rendement est moindre, mais il complète tout de même le revenu tiré de la vente des moutons. En multipliant ces vergers, on pourrait faire en sorte que le jus de pomme remplace le jus d’orange sur la table du petit-déjeuner. Voilà des pistes pour relocaliser de façon intelligente.
En outre, notre scénario crée 63 000 emplois de plus à horizon 2030 que si la tendance actuelle se maintenait. Le défi consiste à remplacer les générations d’agriculteurs partant à la retraite, voire à augmenter les effectifs.
Pour changer tout cela, il faut s’appuyer sur les projets alimentaires de territoire ou encore sur la loi Egalim, qui prévoyait 50 % de produits labellisés dans la restauration collective en 2022, dont 20 % de bio. La France est dotée de plans ambitieux, mais ils sont rarement appliqués. Ce n’est pas un problème technique, c’est un problème de volonté politique.
Comment, en suivant votre scénario, le régime alimentaire du pays évoluerait-il en parallèle ?
La France est l’un des plus gros consommateurs de protéines animales au monde. D’après la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, nous en mangeons 1,4 fois trop. Un des principaux leviers consiste donc à diminuer de moitié notre consommation de protéines animales et à privilégier les élevages à l’herbe et les labels.
En élevant moins de porcs, de bœufs ou de volailles, on libère des terres pour le maraîchage
En élevant moins de porcs, de bœufs ou de volailles, on libère des terres pour le maraîchage. Il en faudrait 500 000 hectares pour importer moins de fruits et légumes et permettre aux Français d’adopter un régime plus végétal. Il faut également augmenter la production et la consommation de pois chiches, pois cassés, lentilles et autres légumineuses qui sont source de protéines. En plus, ces protéagineux fixent l’azote de l’air et nourrissent le sol, ce qui réduirait notre dépendance aux engrais azotés, importés de Russie ou de Biélorussie.
Au-delà de cela, il faut consommer de saison, local, et privilégier les produits non raffinés comme des pâtes complètes. Beaucoup de minéraux sont stockés dans l’enveloppe du blé, qui disparaît lors du raffinage.
Demain, mangera-t-on des insectes ou des algues ?
Nous avons bâti un scénario sans rupture technologique – sans viande cellulaire de laboratoire, notamment – et sans insectes. En revanche, les algues, riches en oméga-3, pourraient représenter une alternative au poisson. Les Français consomment plus de produits de la mer que la moyenne mondiale et les stocks s’amenuisent. Consommer des crevettes d’Asie du Sud-Est, par exemple, entraîne la destruction des mangroves, des écosystèmes très importants. Quant aux saumons d’élevage, ils se nourrissent de farines faites avec des poissons que les humains pourraient consommer. Mieux vaut privilégier les poissons fourragers marins : maquereaux, sardines ou anchois.
Des structures réfléchissent à une Sécurité sociale de l’alimentation, qui garantirait à tous une base de nourriture saine et abordable
Les Français passent des heures à manger, parler gastronomie, choisir les produits… Il faut entretenir cet atout, mais en cuisinant plus de légumineuses, moins de viande, en jouant sur les épices… De nombreux chefs cuisiniers se lancent.
Tout cela impose d’éduquer le consommateur.
Effectivement, c’était l’objet du PNNS. Sauf que ses moyens financiers sont ridiculement bas en comparaison des budgets publicitaires des industries et lobbies agroalimentaires.
Quels seront les impacts sur le coût futur de la nourriture ?
On a calculé qu’un gros consommateur de bio dépense 1,7 euro de plus par jour que quelqu’un qui n’en consomme pas. Pour les personnes au RSA ou les familles nombreuses, cela peut représenter une dépense importante. Mais pour la majorité de la population, c’est le prix d’un abonnement télé. Par ailleurs, une alimentation moins carnée coûte moins cher. Enfin, des structures réfléchissent à une Sécurité sociale de l’alimentation, qui garantirait à tous une base de nourriture saine et abordable.
Quel rôle jouerait la technologie dans tout ça ?
Il faut valoriser les savoirs d’antan relatifs aux variétés, à la conduite des troupeaux, à la gestion des haies... Mais on ne va pas revenir massivement au cheval ! Dans l’Yonne, une coopérative a sauvé ses récoltes grâce à un drone capable de détecter, dans les champs, les pieds de datura – une plante toxique dont les graines rendent la récolte impropre à la consommation. En Indre ou dans la Drôme, des plateformes Internet permettent à des responsables de restauration collective d’optimiser leur approvisionnement auprès de producteurs locaux. C’est la face positive de la technologie. En revanche, les organismes génétiquement modifiés (OGM) nous semblent des leurres. De l’argent a été investi pour créer des tournesols résistants aux herbicides alors que la France a adopté un plan de réduction des produits chimiques. C’est incohérent.
Le contexte réglementaire encourage-t-il la forme d’agriculture, et donc d’alimentation, que vous prônez ?
Seules 11 % des terres agricoles sont cultivées en bio alors que l’objectif fixé était de 20 % en 2020 – et certaines aides aux agriculteurs bio ont été coupées. La stratégie européenne « Farm to fork » (« De la ferme à la table ») était plutôt prometteuse, mais non contraignante. Tout va dépendre de la nouvelle PAC de 2023, qui n’annonce pour l’instant aucun tournant majeur.
Mais peut-être que la guerre en Ukraine va bousculer les choses avec l’envolée des prix du blé et des oléagineux. Si nous avions fait d’autres choix, nous n’aurions pas eu à subir ces impacts. La France peut produire à peu près tout, mais il faut une volonté politique pour organiser cela à grande échelle, avec par exemple des contrats pluriannuels pour sécuriser tout le monde. Nous n’avons plus le choix ! Espérons que suffisamment de personnes prendront conscience des enjeux et qu’à un moment, ça va basculer.
Propos recueillis par HÉLÈNE SEINGIER
Illustrations LE POISSON
« On peut nourrir correctement la population, réduire les pollutions et créer des emplois »
Philippe Pointereau
L'agronome Philippe Pointerau, expert des impacts environnementaux de l’agriculture au sein de l’association Solagro et coauteur du scénario Afterres 2050, plaide pour une réorientation de la production vers l’agroécologie et l’adoption de nouvelles habitudes alimentaires plus soutenables.
[Zéro déchet]
Robert Solé
Le gaspillage alimentaire est un scandale. Ne devrait-il pas figurer, avant même la gourmandise, parmi les sept péchés capitaux ?
Le Loir-et-Cher met les bouchées doubles
Manon Paulic
Un reportage de Manon Paulic dans le Loir-et-Cher où, des cantines à la formation des maraîchers bio, les collectivités se sont engagées dans un grand plan dont l’objectif est d’assurer à terme la souveraineté alimentaire du département.