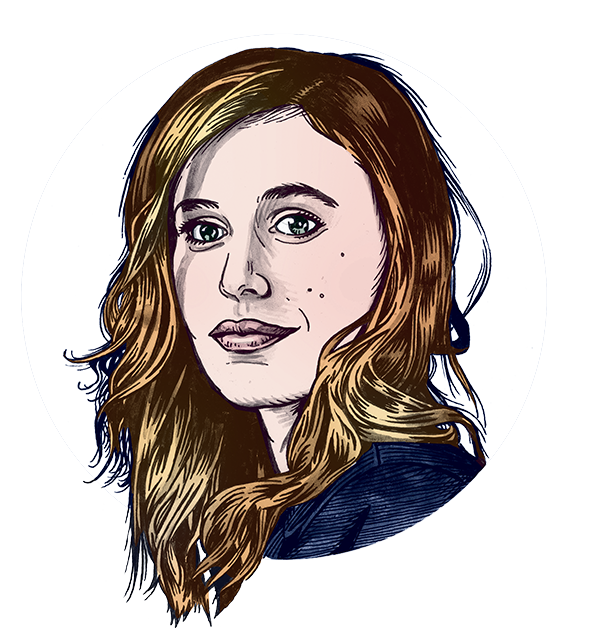Le nuage perdu
Temps de lecture : 5 minutes
En 2050, je prendrai enfin le temps de regarder dans le rétroviseur. Que retiendrai-je de toutes ces années ? Peut-être un ensemble de scènes qui, mises bout à bout, constitueraient un étrange film moitié muet, moitié assourdissant. S’il fallait que je rembobine la cassette, que je rallume le projecteur, que je me retourne, oui, revenir sur mes pas quelques instants, que trouverais-je ? Des grains de sable dans des baskets, des éclats de voix, un parfum entêtant, une phrase assassine ?
Mes parents, écologistes avant l’heure, qui trient le plastique, le papier et les détritus ménagers dès la fin des années quatre-vingt-dix. L’application météo que je consulte tous les jours pour vérifier la température de Paris et d’Alger, et l’écart qui se creuse pour finir certains étés par s’inverser lorsque je suis dans le sud de la France, quatre, cinq, six degrés de plus qu’à Alger. L’effarement et l’inquiétude. Les épaules qui se soulèvent, les moues dubitatives de certains lorsque d’autres disent vouloir acheter une maison en Norvège ou en Suède, le plus loin, le moins chaud possible.
Peut-être que je ne penserai à rien de tout cela, peut-être que la seule image qui me restera sera celle d’une perte irrémédiable, une nuit d’été.
Plus jeune, j’ai capturé un nuage.
Cela pourrait être le début d’une histoire pour enfants. Une histoire où il serait question d’un nuage qui emporte avec lui un cabanon de plage et les amis de toute une vie, un vent maléfique qui souffle fort et une effroyable grêle qui brûle le blé en herbe.
Il y a de cela une quinzaine d’années, j’ai capturé un nuage, en Algérie. Je l’ai trouvé au-dessus d’un cabanon de plage. Ce n’était pas à Tipaza ni à Zéralda, mais entre les deux. Je conduisais une vieille bagnole, sur une route bordée de rouge, là où le ciel et la mer se rejoignent, là où la montagne les borde. Je me suis arrêtée et j’ai échoué sur cette plage, toujours déserte. Il était là.
Et puis. Un grand événement, essentiel, puisqu’on y laissait la vie.
Un matin, aux aurores, je suis partie. Sans rien dire. J’ai emprunté une route grise, bétonnée, où de petites automobiles roulaient à toute vitesse, pressées d’arriver à l’aéroport. En attendant mon vol, j’ai rangé dans mon portefeuille une photo prise la veille. Elle est toujours avec moi. Au moment où je raconte cette histoire, elle est posée sur la table à côté de mon clavier et j’y jette de fréquents coups d’œil comme pour vérifier que tout cela a réellement existé un jour. La photo est jaunie maintenant, les bords sont abîmés et cornés. Les couleurs sont un peu passées, comme si elle avait baigné dans la mer. Il suffit pourtant de plisser les yeux et de regarder attentivement pour deviner quatre amis assis au loin, sur la plage. Les sourires sont figés, les yeux à moitié fermés à cause du soleil qui les éblouit. Les écharpes s’envolent. Derrière nous, le cabanon de plage. Et au-dessus de nos têtes, le nuage, butin de guerre.
En 2050, nous devions revenir sous ce même nuage, nous retrouver après avoir fait le tour de nos vies. Les conjoints et les enfants. Les métiers et les crédits. Les histoires et les mensonges. Nous aurions trouvé une solution.
Mais. Un grand événement, essentiel, puisqu’on y laissait la vie, général, puisqu’il affectait tout le monde.
Depuis longtemps en effet, notre cité souffrait d’une maladie étrange, insaisissable. Elle était partout et nulle part ; elle semblait disparaître quelques mois, puis fondait brusquement, terriblement, comme pour rattraper le court moment de répit qu’elle nous avait laissé. On avait essayé tous les remèdes.
Le nuage, ce fichu nuage qui s’envole et qui emporte le dernier rêve. Il n’y a plus de nuage sur la plage entre Tipaza et Zéralda. Je l’ai suivi, j’ai couru derrière lui à défaut de pouvoir le retenir.
Il s’est arrêté un temps à Marseille. Et à Marseille, il y avait encore l’espoir de tout recommencer là-bas. Ce n’était pas le même bord de la Méditerranée ni le même pays. Il n’y avait pas de montagne qui venait border la mer et le ciel. Ceux sur la photo jaunie et aux bords écornés ne pouvaient pas m’y rejoindre, mais, dressée sur la pointe des pieds, la main en visière et le regard au loin, je pouvais entrapercevoir ce qui n’était ni Tipaza ni Zéralda.
Quand. Un grand événement, essentiel, puisqu’on y laissait la vie, général, puisqu’il affectait tout le monde, allait briser la monotonie de vivre.
Le nuage a filé et, de nouveau, j’ai couru mais pas assez vite cette fois. Je l’ai un peu perdu de vue, je l’ai beaucoup cherché. J’ai fini par le retrouver en Bretagne, bien caché.
Autour de moi, tout le monde a commencé à chercher des nuages, à vouloir accaparer le mien. Deux ans de suite toutes les sources avaient tari. La terre ne pouvait pas suffire à tous les besoins.
Mais le plus grave n’était pas là, le plus grave, c’était cette tristesse qui suintait des murs, c’était la promesse non tenue. Le plus grave, c’était que le nuage continuait son chemin, et que je restais là, abasourdie par ce que je venais de perdre : le plus grand des rêves, celui de finir avec ceux qu’on a le plus aimés. Mon nuage m’a quittée au milieu de la nuit, comme font tous ceux qui n’aiment plus.
Il y a quinze ans, j’ai capturé un nuage.
Si c’était une histoire pour les enfants, ce serait de celles qui leur dresseraient les cheveux sur la tête, de celles qui ne peuvent se raconter qu’à la tombée de la nuit. Et dont on chuchoterait la fin : Il est vrai qu’on avait tout fait pour mériter cette malédiction.
Les phrases en italique sont extraites de La Colline oubliée (rééd. Folio, 1992) de Mouloud Mammeri.
« Ce n’est pas dramatique d’avoir le climat d’Alger en France »
Jean Viard
« Après la pandémie, on ne voudra pas avoir souffert pour rien. […] Pourtant, on sera également en présence d’un sens nouveau du commun, qui permettra de fonder la civilisation dont nous avons besoin pour être armés dans le combat contre le réchauffement climatique. Le numérique devrait nous en d…
[Douce France]
Robert Solé
AUJOURD’HUI, en 2050, quand on regarde en arrière, la France d’il y a trente ans nous paraît un peu étrange. Le Parlement venait de voter « l’urgence écologique et climatique ».
La France en 2050
Ce poster qui inaugure la nouvelle formule du 1 présente les conséquences du changement climatique à venir à travers une mosaïque de paysages assortie d’une dizaine de schémas et de notices explicatives. Outre les impacts physiques de ce phénomène – de la montée des eaux et de l’érosion …