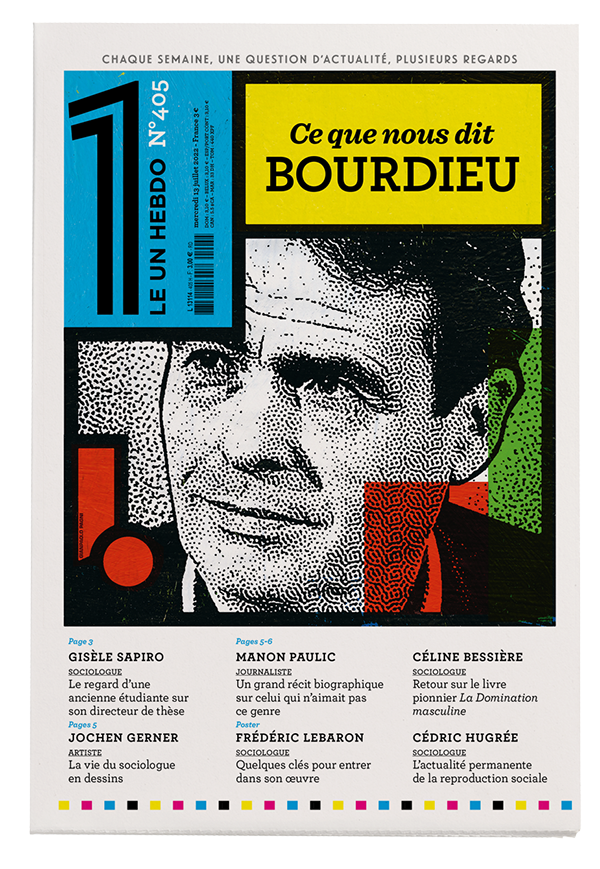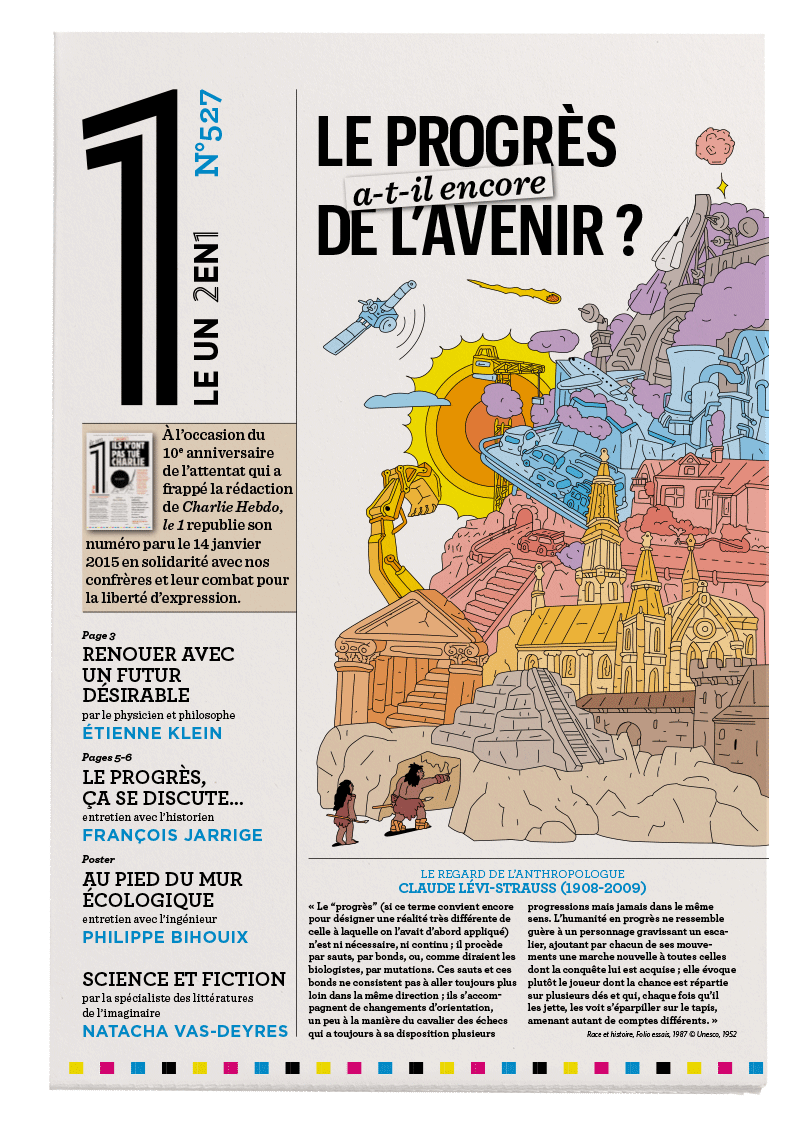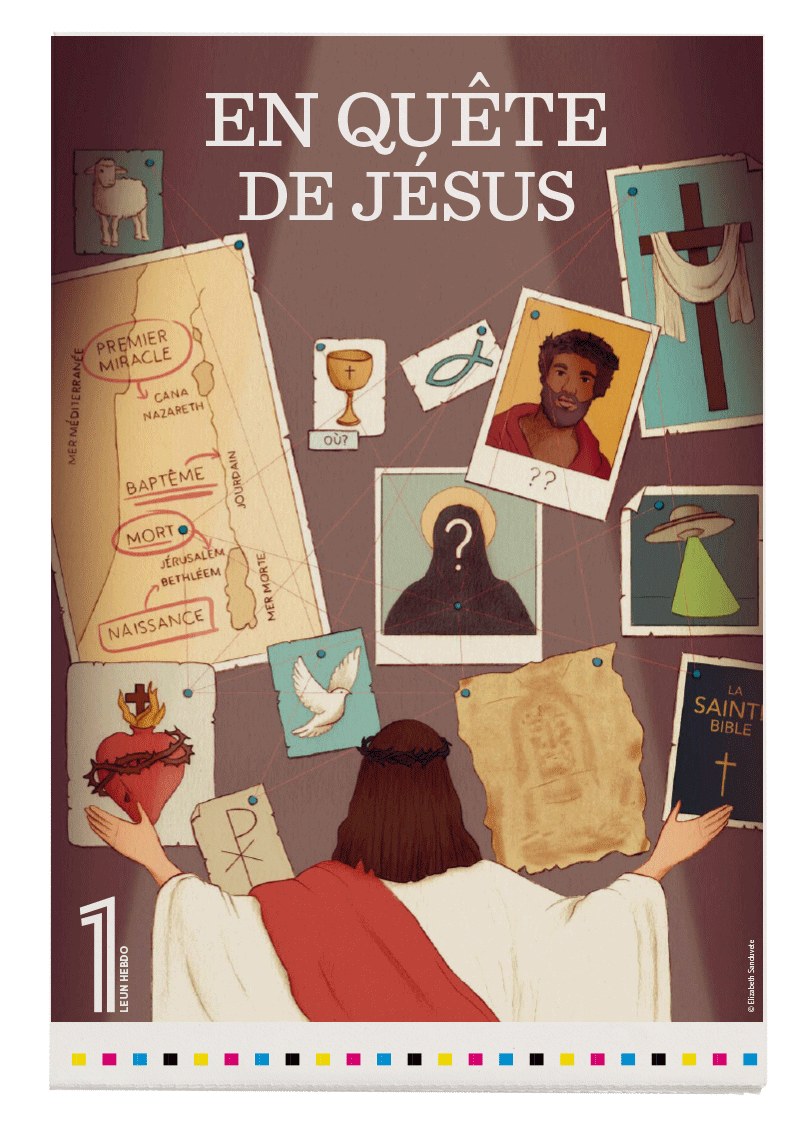Les habits neufs de la reproduction sociale
Temps de lecture : 8 minutes
Entre 1964 et 1970, deux ouvrages cosignés par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron paraissent aux éditions de Minuit. Les Héritiers : les étudiants et la culture (1964) analyse les inégalités sociales et culturelles de parcours dans l’université de l’époque. La Reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement (1970) développe un propos plus théorique sur le rôle de l’école dans le maintien de l’ordre social, c’est-à-dire dans la reproduction des inégalités entre classes sociales au fil des générations. Ces deux ouvrages ont profondément transformé le regard que la société française portait sur son système scolaire. Leurs nombreuses traductions en font aujourd’hui des classiques des sciences sociales dans le monde entier. Les découvertes et les résultats faits à l’époque dans ces deux ouvrages sont aujourd’hui encore d’actualité et demeurent de précieux outils pour penser les inégalités contemporaines entre les classes sociales et le rôle joué par l’institution scolaire dans la fabrique des destins sociaux.
En démontrant – statistiquement et enquêtes à l’appui – les liens étroits entre la socialisation dans les classes dominantes et les modes de sélection et d’élection scolaires des élèves, le travail de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron fait « d’une pierre deux coups ». D’un côté, il propose deux concepts qui rendent compte des mécanismes par lesquels le système éducatif favorise la reproduction des inégalités entre les classes sociales : le capital culturel et la violence symbolique. De l’autre, il invalide les conceptions naturalisantes de l’intelligence expliquant les réussites scolaires par de supposés « dons », et celles les concevant comme la conséquence d’un « mérite » individuel.
Le capital culturel détermine les représentations que les membres des différentes classes sociales se font de l’école
D’abord désigné sous le terme d’héritage culturel, le capital culturel est un système de valeurs explicites et implicites transmis différemment selon les classes sociales. Le capital culturel est l’expression d’un rapport social à l’institution scolaire, mais aussi plus largement d’un rapport au langage et aux formes culturelles légitimes, c’est-à-dire valorisées par l’école et par les institutions culturelles. Ce concept explique de façon bien plus robuste les inégalités scolaires que les seules inégalités de revenu et de patrimoine (le capital économique). En effet, le capital culturel détermine les représentations que les membres des différentes classes sociales se font de l’école, de l’utilité et de la légitimité de ses enseignements et des différentes disciplines scolaires et, finalement, de l’intérêt de la scolarisation pour l’avenir de leurs enfants. Dans les années 1960, les classes populaires (ouvriers, petits employés et petits agriculteurs) sont marquées par une forte « culture anti-école » (selon l’expression employée par Paul Willis dans L’École des ouvriers [Agone, 2011]) : une majorité des élèves issus de ces milieux s’auto-excluent des études classiques, qui sont aussi les plus longues ; processus redoublé par leurs nombreux verdicts scolaires négatifs. Ces auto-exclusions des filières les plus prestigieuses de l’enseignement secondaire correspondent à des anticipations inconscientes des sanctions que l’école leur réserve, ce qui fait ainsi écrire à Pierre Bourdieu que les élèves en viennent à « prendre la réalité pour leurs désirs ».
Mais l’école ne fonctionne pas comme une institution neutre socialement, même si elle le prétend. La culture scolaire s’avère proche de la culture des classes dominantes. Cette affinité est particulièrement repérable dans le maniement de la langue scolaire : les enseignants utilisent la langue professorale et magistrale proche de la langue écrite, que maîtrisent les élèves issus des classes dominantes, là où ceux des classes dominées semblent condamnés à l’emprunter. L’institution scolaire ne sanctionne d’ailleurs pas seulement les inégalités face à la langue légitime. Elle consacre aussi le mode d’acquisition familial en soulignant, par exemple, « l’aisance naturelle » d’un élève, ou en dévalorisant le mode d’acquisition scolaire de cette langue, comme lorsque le devoir d’un autre est jugé « trop scolaire ». En hiérarchisant les élèves selon des principes qui se présentent comme autonomes de la hiérarchie sociale, mais qui fonctionnent en affinité avec les modes de vie et de pensée des classes dominantes, l’action pédagogique est ainsi analysée comme l’imposition d’un arbitraire culturel. Mais ce pouvoir de classement et de hiérarchisation des agents sociaux est légitime et reconnu, car il dissimule les ressorts de son fonctionnement : c’est la violence symbolique. Dans cette optique, l’école est donc une institution qui contribue fortement à établir les hiérarchies entre classes sociales et à les reproduire durablement dans le temps.
L’école ne fonctionne pas comme une institution neutre socialement, même si elle le prétend
Pour Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, la reproduction des inégalités sociales n’a cependant rien d’une stricte symétrie d’une génération à l’autre : la structure sociale évolue, des groupes sociaux disparaissent peu à peu (par exemple les agriculteurs) et d’autres émergent (comme les emplois peu qualifiés des services appelés « employés »). La force de cette théorie est de permettre de comprendre le maintien de la structure et des distances sociales entre les classes sociales au fil du temps. Entre le système scolaire des années 1960 et celui des années 2020, de profonds bouleversements ont en effet eu lieu. À la fin des années 1960, seuls 20 % des membres d’une classe d’âge décrochent un baccalauréat (essentiellement dans les filières générales). À cette époque, la France organise en masse la scolarisation des élèves jusqu’à 16 ans, mais le collège unique n’existe pas encore et seule une minorité de ces élèves prolongent leurs études au lycée, voire dans l’enseignement supérieur. L’enseignement supérieur français n’a d’ailleurs pas grand-chose à voir avec celui d’aujourd’hui : s’il connaît une première explosion de ses effectifs, il est principalement organisé autour des facultés parisiennes et de celles de quelques villes de province. Les lettres et la philosophie sont encore en haut de la hiérarchie des disciplines dans le secondaire et à l’université. Les grandes écoles d’ingénieurs et de commerce ne sont pas encore organisées comme un marché scolaire unifié (avec des concours et des classements communs).
Cinquante ans plus tard, 80 % d’une classe d’âge obtient un des trois baccalauréats (général, technologique ou professionnel). Parmi ceux qui sortent de l’enseignement supérieur, la moitié est désormais titulaire d’un diplôme égal ou supérieur à la licence. Dans les classes populaires, la culture anti-école a cédé la place à une « mobilisation inquiète », pour reprendre l’expression qu’utilise Tristan Poullaouec dans son article « Regrets d’école : le report des aspirations scolaires dans les familles populaires » (Sociétés contemporaines, no 114, 2019). Dans ce système scolaire massifié, la sélection scolaire passe moins par l’éviction précoce (bien qu’elle existe encore) que par un système de relégation dans certaines filières de l’enseignement secondaire, celles-ci étant très finement hiérarchisées selon leur composition sociale et scolaire.
Aujourd’hui, les enfants d’ouvriers et d’employés n’obtiennent toujours pas le baccalauréat dans les mêmes proportions que les enfants de cadres supérieurs. Mais, surtout, pour les enfants d’origine populaire, le bac le plus fréquemment préparé et obtenu est le bac technologique, puis vient le bac professionnel. Les enfants de cadres supérieurs et d’enseignants sont très majoritairement des bacheliers généraux et, le plus souvent, ils l’obtiennent dans l’ancienne série scientifique. Ainsi, de fortes inégalités sociales devant le système scolaire français contemporain demeurent et conditionnent largement les inégalités économiques et sociales entre les différentes classes sociales.
Le poids pris par le patrimoine dans la détermination des positions sociales s’est accru
Mais ce modèle théorique peut aussi être actualisé relativement à deux aspects au moins. Premièrement, en France, la suprématie du capital culturel par rapport au capital économique, très présente dans les travaux de Pierre Bourdieu, apparaît aujourd’hui moins claire. Le poids pris par le patrimoine dans la détermination des positions sociales s’est en effet accru, comme en attestent les travaux de Thomas Piketty. Les fractions économiques des classes dominantes investissent aussi très fortement le jeu scolaire : depuis les années 2000, ce ne sont plus seulement certains titres scolaires qui sont visés, c’est la manière de les obtenir et la quête de parcours irréprochables qui semblent préoccuper les élites, et ce, dès les débuts de la scolarisation de leurs enfants.
Le renforcement du pouvoir du capital économique a des effets réels sur le capital culturel : on pense évidemment à l’augmentation des frais d’inscription et à l’instauration progressive de barrières économiques à l’entrée de formations scolaires ou universitaires. Mais plus subtilement, Muriel Darmon observe dans son livre Classes préparatoires : la fabrique d’une jeunesse dominante (La Découverte, 2013) que les disciplines les moins « scolaires » et les plus récentes des prépas économiques gagnent aussi en légitimité par rapport aux disciplines plus anciennes des prépas scientifiques.
Deuxièmement, le régime de sélection scolaire et ses registres de légitimité ont eux aussi évolué. Dans Héritocratie (La Découverte, 2021), Paul Pasquali montre par exemple qu’à partir des années 1990, les grandes écoles fondent des petits dispositifs d’ouverture sociale pour tenter de désamorcer la critique les présentant comme les lieux centraux de reproduction des élites françaises. Elles cherchent ainsi à se présenter comme des lieux d’exemplarité en matière de mérite scolaire. Cette politique est le résultat d’une mobilisation des élites formées dans ces écoles leur permettant d’échapper à une réforme générale… pour maintenir leur quasi-monopole sur la reproduction des élites, plus que jamais fermées socialement.
Plus largement, avec Tristan Poullaouec, dans notre ouvrage à paraître, nous défendons l’idée qu’un nouveau régime de sélection scolaire émerge au tournant des années 2000 et s’institue dans l’enseignement supérieur avec Parcoursup. À l’inverse de celui des années 1970 puis 1980, il s’agit d’un système tout entier tourné vers le fait de diplômer les nouvelles générations (avec un objectif de 50 % d’une génération à bac +3), mais dans lequel on ne cherche plus à réduire les écarts scolaires entre les classes sociales. D’où l’actuelle multiplication des filières et des manières de sélectionner les étudiants à l’entrée dans le supérieur à travers Parcoursup : la hiérarchisation accrue des filières, des diplômes et des établissements est la manière contemporaine de faire perdurer les mécanismes de l’école conservatrice et très peu démocratique analysés par Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, il y a de cela plus de cinquante ans.
« Il vous faisait sentir comme son égal »
Manon Paulic
Quel fut le parcours intellectuel de Pierre Bourdieu, ce géant de la sociologie, de son enfance dans le Béarn à sa dénonciation des politiques néolibérales, en passant par ses premières enquêtes de terrain en Kabylie ?