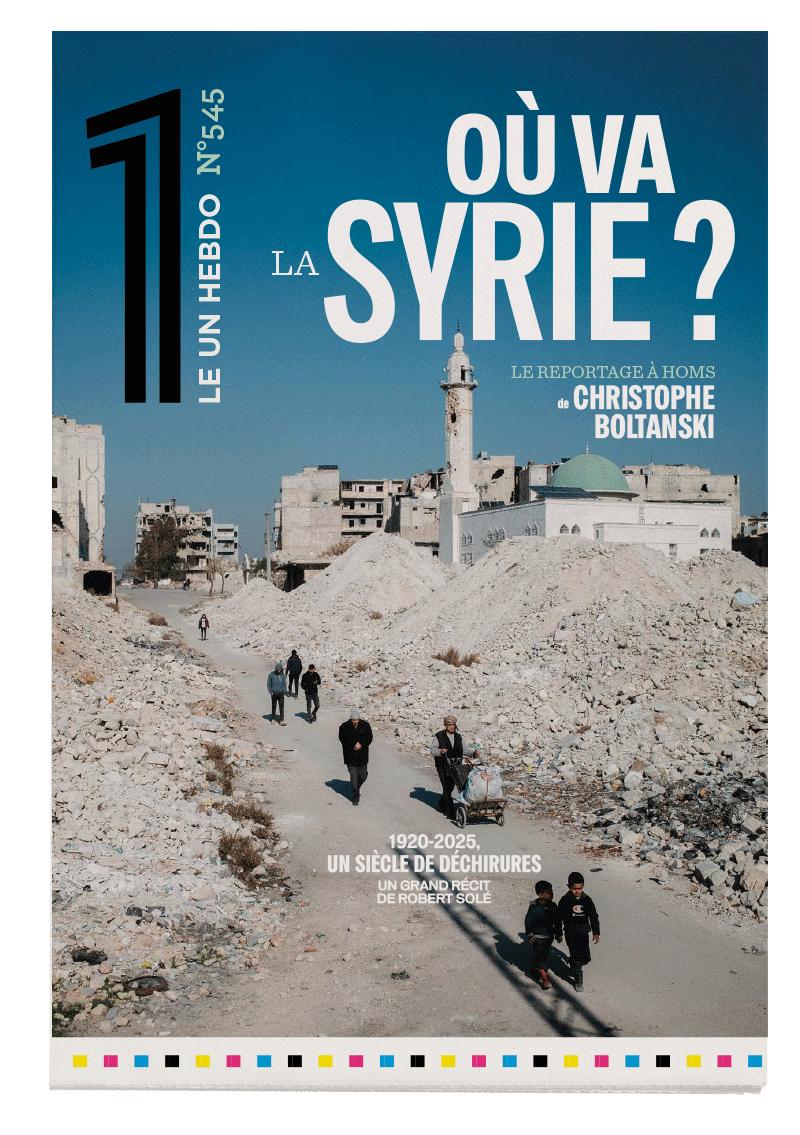« Xi Jinping se veut l’héritier de Mao comme de la Chine impériale »
Temps de lecture : 9 minutes
Douze ans après son accession à la présidence de la Chine, Xi Jinping reste encore pour nous un personnage méconnu. Est-ce dû à un manque de curiosité occidentale ou lui‑même cultive‑t-il le mystère autour de sa personne ?
Je penche plutôt pour la deuxième option. Les Occidentaux essaient depuis longtemps de percer son mystère, mais ils sont confrontés au même problème que celui qu’ils rencontrent avec tous les dirigeants chinois depuis le début des années 2000, à savoir la difficulté croissante d’avoir accès directement à eux. Jiang Zemin, secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) de 1989 à 2002 et président de 1993 à 2003, a été le dernier à accepter de parler sans filtre à une télévision occidentale. Les rares prises de parole de son successeur, Hu Jintao, étaient rares et très contrôlées, avec des questions préparées. Avec Xi Jinping, on revient très loin en arrière, avec un culte de l’opacité et de la personnalité qui rappelle l’époque de Mao Zedong.
Pourquoi un tel secret ?
Il s’agit moins d’une volonté de mystère que d’un hypercontrôle de l’image que le régime veut projeter. Le PCC a acté le fait que la presse occidentale faisait partie des ennemis. D’ailleurs, pour Pékin, les médias chinois ne sont pas un contre-pouvoir, mais au contraire un outil de propagande, destiné à relayer la parole du Parti, sans aucun souci de transparence. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte : Xi a effectué toute sa carrière en faisant profil bas, gravissant les échelons en toute discrétion. Cette ascension sans accrocs est due à sa connaissance intime du Parti, et à sa conscience qu’on peut très vite chuter, et qu’il n’y a pas loin de Zhongnanhai, le centre du pouvoir, à la prison de Qincheng, près de la capitale.
Le sort de son père est-il la clé permettant de comprendre son parcours ?
La chute de son père, ancien compagnon d’armes de Mao, l’a évidemment marqué, puisque du jour au lendemain sa famille a été expulsée de Zhongnanhai, un domaine situé à l’ouest de la Cité interdite qui abrite les bureaux du Parti et les logements des familles dirigeantes. Mais il ne l’a pas si bien connu : son père a été victime d’une purge en 1962, quand Xi Jinping avait 9 ans, et il ne le reverra vraiment que dix-sept ans plus tard. Entre-temps, Xi a vécu la Révolution culturelle et les travaux dans les champs, avant de commencer son ascension au sein du Parti.
En quoi se distingue-t-il de ses prédécesseurs ?
Quand il arrive au pouvoir en 2012, des débats très forts agitent le PCC depuis plusieurs années, qui est en butte à une remise en cause de plus en plus marquée de son autorité liée à l’émergence de la société civile comme à l’importance croissante accordée au droit et à la Constitution. Les tensions sont alors en train de monter ; on dénonce les inégalités sociales ou la corruption généralisée, fruits de la politique économique engagée dans les années 1980. Pour les « princes rouges », les fils des premiers révolutionnaires, la réponse peut passer par un homme fort, capable de remettre le pays – et le Parti – sur les rails. Ce courant « néo-autoritariste » remonte aux années 1980. Il est incarné par un universitaire, Wang Huning, devenu depuis l’un des idéologues du régime. Et cet homme a trouvé son champion en Xi Jinping au moment où, en 2012, celui-ci a accédé au poste de secrétaire général du Parti.
« Il est à la fois idéologique et très pragmatique »
Xi Jinping a-t-il alors immédiatement affirmé sa puissance ?
Depuis la fin du dernier mandat de Jiang Zemin, à chaque arrivée d’un nouveau dirigeant du PCC, une partie de la société, des analystes et des médias ont eu tendance à penser que le nouveau venu se montrerait plus libéral, qu’il chercherait une meilleure répartition des pouvoirs, qu’il moderniserait la vie politique. Bref, qu’il serait le Gorbatchev chinois. Et, deux fois, ils se sont trompés… Xi Jinping a pu un temps laisser croire qu’il était réformiste, car il avait des amitiés dans ce camp-là, et son ascension prudente ne permettait pas d’imaginer ce qu’il ferait du pouvoir. Mais dans un texte secret de 2013 connu sous le nom de « Document no 9 » et qui a, par la suite, fuité en Occident, il précise son programme, qui est plutôt celui d’une contre-réforme idéologique face à l’ennemi que représente la démocratie occidentale. Il convient, selon lui, de revenir sur les erreurs de Hu Jintao et de son Premier ministre Wen Jiabao. On assiste en conséquence à une reprise en main des médias, à la répression de la société civile et au contrôle des réseaux sociaux. Dans le même temps, il assoit son contrôle sur le Parti et écarte ses rivaux au nom de la lutte anticorruption. Il en profite pour remettre en cause une règle, datant de Deng Xiaoping (homme fort du régime de 1978 à 1989), d’après laquelle ceux qui étaient passés par le cœur du pouvoir – donc les anciens membres du comité permanent du bureau politique – étaient intouchables. Il envoie l’un d’entre eux en prison, affirmant ainsi sa légitimité, notamment auprès de la population, sensible à la lutte contre les « pourris ». Cette croisade au nom de la morale est, pourrait-on dire, une sorte d’équivalent de la contre-réforme catholique dans la Chine du xxie siècle, avec des procès télévisés, une épuration spectaculaire des cercles politiques et économiques et une toute-puissance de la nouvelle inquisition représentée par la Commission de discipline chargée de nettoyer le Parti.
Xi est-il aujourd’hui le seul maître de Pékin ?
Non, il n’exerce pas un pouvoir solitaire – c’est d’ailleurs là que l’on voit à quel point il connaît les arcanes du Parti. À l’endroit de la population, il a relancé des campagnes idéologiques nourrissant le culte de la personnalité pour se mettre au centre du jeu, à l’égal de Mao et de Deng Xiaoping, allant jusqu’à inscrire sa propre pensée dans la Constitution. Mais, au sein du pouvoir, il a su placer des figures loyales à tous les postes clés et créer de petits groupes qui lui permettent de court-circuiter si besoin la bureaucratie du Parti pour accélérer les décisions. Mais il faut bien comprendre que la Chine est un pays immense dans lequel les pouvoirs locaux ont la capacité de s’opposer à ses politiques. Xi Jinping n’est pas un autocrate absolu qui peut décider du sort de la Chine en appuyant sur un bouton dans son bureau. Il est à la fois tributaire de l’énorme machine qu’est le Parti, en même temps qu’il s’en sert pour asseoir son pouvoir.
Existe-t-il encore des oppositions formelles ?
Non, il a réussi à tuer tous les contre-pouvoirs officiels, que ce soit au sein de la société civile ou du Parti. Mais ça ne veut pas dire qu’il n’est pas sensible aux mouvements qui animent la population : au moment de la pandémie, quand il a senti que sa politique zéro Covid allait déclencher une tempête sociale, toutes les mesures ont été levées en une semaine. En cela, il est à la fois idéologique et très pragmatique : s’il voit que la stabilité ou la légitimité du pouvoir peuvent être remises en cause, il est capable de revenir sur certaines décisions. Mais le fait qu’il n’y ait plus de contre-pouvoirs et que le Parti soit au centre de tout génère aussi ses propres contradictions. Récemment encore, Xi Jinping a été contraint de purger les institutions militaires, notamment un général qui était considéré comme l’un de ses fidèles. Sans contre-pouvoir, la corruption est systémique, et les purges au sein du Parti ne peuvent que se multiplier.
« Il n’est pas seulement l’héritier de Mao, mais aussi celui de la Chine impériale, du confucianisme et du taoïsme »
Quel est son logiciel politique ? Y a-t-il un « xiisme » ?
Je parlerais plutôt de bricolage idéologique. De nos jours, la Chine communiste emprunte au marxisme-léninisme, voire au stalinisme dans sa stratégie de conservation du pouvoir, sans pour autant tourner le dos à l’économie de marché – ce qui peut être résumé dans la formule en forme d’oxymore de « socialisme de marché ». En réalité, le régime est comparable au Vatican : c’est une structure de pouvoir qui adapte son discours idéologique aux mouvements de la société, quitte à faire preuve de contradictions. Quand Deng Xiaoping embrasse le capitalisme dans les années 1980, il tourne le dos aux années Mao, mais sans faire évoluer la structure du pouvoir. La particularité du discours de Xi Jinping, c’est qu’il essaie de mettre en scène un roman national qui engloberait l’ensemble de l’histoire de la Chine et dont il serait l’aboutissement. Il n’est pas seulement l’héritier de Mao, mais aussi celui de la Chine impériale, du confucianisme et du taoïsme. Les révolutionnaires de 1919 voulaient se débarrasser de la vieille boutique du confucianisme. Un siècle plus tard, lui l’intègre dans une grande synthèse historique : Mao a libéré la Chine d’un siècle d’humiliation coloniale ; Deng Xiaoping l’a engagée dans la voie de la modernisation économique ; Xi lui permet de renaître comme une grande puissance mondiale – peut-être même la première devant les États-Unis – avec pour horizon 2049, année du centenaire de la fondation de la République de Chine.
Quelles sont les fragilités du pays aujourd’hui ?
Elles tiennent essentiellement à la transformation de l’économie chinoise, d’une économie de production mise en place par Deng Xiaoping dans les années 1980, fondée sur l’exploitation d’une main-d’œuvre pas chère et l’apport de capitaux étrangers, vers une économie axée sur la consommation intérieure. Le développement économique lancé par Deng Xiaoping avait été le fruit d’une ouverture facilitée par le soutien des États-Unis, dans laquelle chacun des deux pays trouvait son compte, au fil d’une sorte d’alliance tacite à la fois économique, sociale et politique. Sous Obama déjà, cette stratégie a commencé à être discutée. Avec Trump, le paradigme est cette fois totalement remis en cause, et il est difficile de prévoir comment la Chine va s’en sortir économiquement parlant, car le découplage sera violent. Mais en attendant, Trump donne politiquement les armes à Pékin pour que le pays offre une image de stabilité et d’ouverture auprès d’un certain nombre de pays.
Si la Chine parvient « à conjuguer le néo-autoritarisme et l’innovation technologique », alors elle sera la « dictature parfaite du xxie siècle », écriviez-vous il y a huit ans. Où en est-on aujourd’hui ?
On a longtemps cru que le modèle dictatorial s’écroulerait sous le poids de ses contradictions, et notamment qu’il ne pouvait pas permettre à des créateurs, des innovateurs de prospérer. On pensait que c’était là l’apanage de sociétés démocratiques où régnait le débat d’idées. La Chine montre exactement le contraire, même s’il faut parfois se méfier des effets d’annonce du type de ceux qui ont entouré le lancement de l’IA générative Deepseek fin janvier. Reste que ce qui fait la force de la Chine aujourd’hui, c’est cette capacité de la société chinoise à innover même dans un cadre bureaucratique, totalitaire, voire tout à fait dystopique.
Quelles limites voyez-vous au pouvoir de Xi Jinping ?
Son âge, et la question de sa succession. Il a bien aboli la limite du nombre de mandats présidentiels, il n’en reste pas moins qu’il a plus de soixante-dix ans, et l’on a vu avec l’Union soviétique les problèmes qu’engendre une gérontocratie. Est-ce qu’il y aura une contestation en interne pour sa succession ? Des mouvements au sein de la société ? La période qui s’ouvre, de ce point de vue, va être passionnante.
Propos recueillis par JULIEN BISSON.
« Xi Jinping se veut l’héritier de Mao comme de la Chine impériale »
François Bougon
Ancien correspondant de presse à Pékin, François Bougon, l’auteur de Dans la tête de Xi Jinping évoque le parcours du président chinois, analyse la façon dont il conçoit et exerce le pouvoir, ainsi que le « rêve chinois » qu’il porte, inscrit dans un grand roman national dont Xi se voit,…
[Sosies]
Robert Solé
Ces dernières années, le célèbre baryton chinois Liu Keqing, lauréat de plusieurs prix internationaux, a été radié de TikTok à diverses reprises, au grand dam de ses admirateurs...
Portrait de la société chinoise
Une infographie permettant de dresser le portrait de la société chinoise.