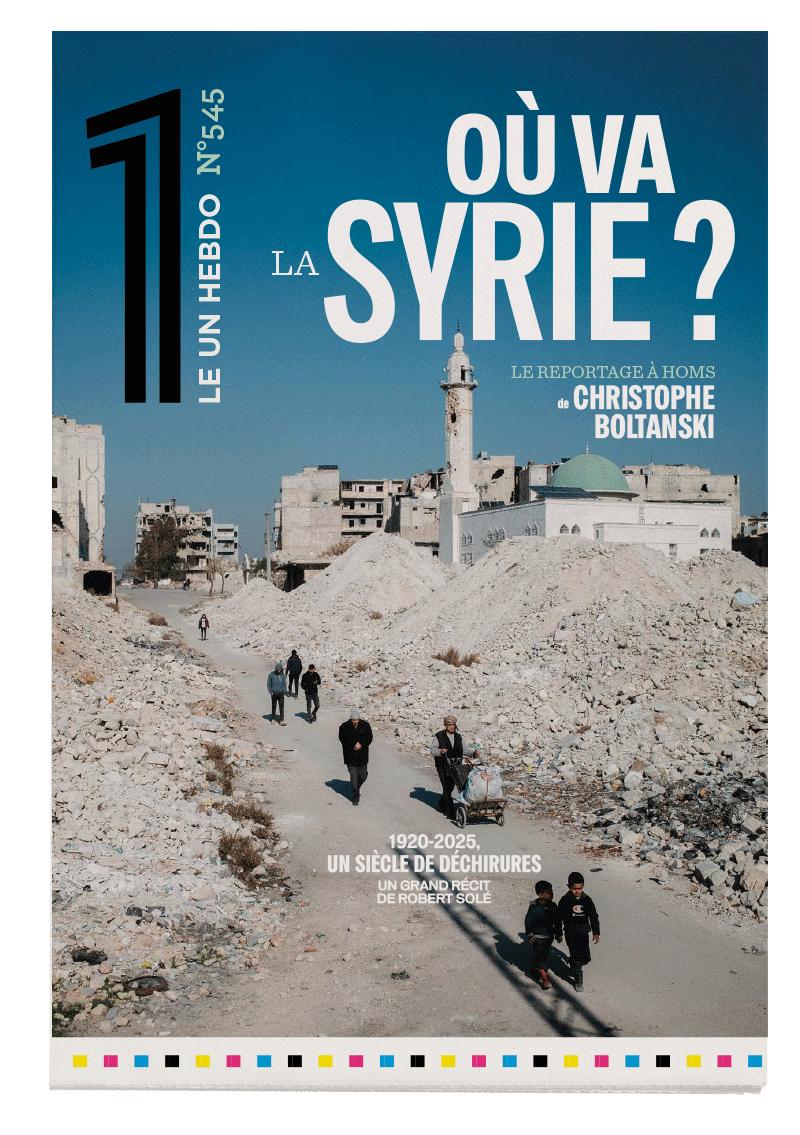La Chine de Xi Jinping est‑elle si puissante ?
Temps de lecture : 8 minutes
Dans Foreign Affairs, Michael Forman, président du think tank américain Council on Foreign Relations, affirme que le modèle chinois de « capitalisme d’État » domine désormais l’économie mondiale. Partagez-vous cette vision d’un monde où le capitalisme libéral et démocratique serait en train de devenir obsolète, au profit d’une nouvelle ère incarnée par Xi Jinping ?
Cette vision s’en tient aux apparences. Elle repose sur une lecture du monde fondée sur la compétition telle que défendue historiquement par les démocraties populaires : un système s’effondre, l’autre triomphe. Tourné vers un avenir forcément radieux et une mission de renaissance qu’il estime inéluctable, le Parti communiste chinois ne peut que se réjouir de ce type d’analyse chez ses adversaires. Cela relève d’une guerre psychologique que la Chine, depuis Sun Zi [philosophe et stratège du vie siècle av. J.-C.], a toujours su manier avec talent.
Mais le fait que l’Amérique de Donald Trump paraisse aujourd’hui en déclin – au moins temporairement – ne signifie pas que la Chine l’emporte. Oubliant sa diplomatie des « loups combattants », elle se fait agneau pour mieux séduire et diviser, avec un succès qu’il conviendra d’évaluer sur le long terme. Ce type de diagnostic néglige les faiblesses fondamentales d’un régime qui, malgré son apparente efficacité, demeure incapable de réformes fondamentales, les seules qui pourraient assurer les transformations nécessaires. Contrairement à ses proclamations, la Chine reste largement tributaire de ses exportations vers les économies les plus développées, seules à même d’absorber les excédents de sa surproduction systémique. Sans ces débouchés, la stabilité sociale – obsession centrale du régime – serait menacée.
Quels sont les grands enjeux internationaux aux yeux de Xi Jinping ?
La priorité, pour lui comme pour le Parti, demeure la croissance économique – un enjeu aux dimensions internationales. Il s’agit de convaincre les grands marchés, en particulier européens, de rester ouverts, et aussi de maintenir les transferts de technologies avancées, comme en témoigne la rencontre de mars 2025 entre les ministres des Affaires étrangères chinois, japonais et sud-coréen. Sur le plan géopolitique, Pékin tente de rallier l’Asie autour de l’idée d’un pôle régional dominé par la Chine, marginalisant les États-Unis dans une sorte de retour au modèle impérial « tributaire » traditionnel rêvé par Pékin [qui fait de la Chine le centre dominant]. Mais même si les incertitudes autour des États-Unis incitent les partenaires asiatiques à se rapprocher de la République populaire de Chine (RPC), les tensions de fond n’ont pas disparu.
Enfin, la Chine mise sur le Sud global, sans pour autant en avoir les moyens – ni la volonté – d’y jouer un rôle comparable à celui des États-Unis en matière d’aide au développement. En revanche, elle peut s’appuyer sur le soutien des élites des régimes les plus autoritaires et les moins transparents. L’objectif est donc de retrouver une marge de manœuvre et une influence très largement érodée depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012.
Quelles sont les ambitions, à long terme, de Xi vis-à-vis des Américains et des Européens ?
Face aux États-Unis, il entend tirer parti des opportunités offertes par les erreurs de l’administration Trump pour affaiblir les capacités d’influence et d’action de Washington. Pékin se positionne comme la puissance raisonnable du moment. Son objectif à long terme reste de rattraper puis de dépasser les États-Unis, dans une compétition entre deux systèmes dont l’un – selon Pékin – tire sa légitimité du « sens de l’Histoire ». Mais du début des années 2010 jusqu’à la réélection de Donald Trump, l’influence internationale de la RPC a décru, notamment du fait d’une croissance économique en deçà de ses ambitions. En ce qui concerne l’Union européenne, Pékin attend qu’elle accepte son rôle de marché de repli et de pion par rapport aux États-Unis. Des pays comme la France, membre permanent du Conseil de sécurité, ont longtemps eu une place particulière en raison de leur capacité potentielle à contrebalancer Washington. Mais un pôle européen émancipé de ce rôle prédéfini n’intéresse guère la Chine.
« La survie du régime demeurant sa priorité absolue »
La réintégration de Taïwan est-elle pour Xi une ambition impérative à court terme ? Peut-il se contenter d’un statu quo ?
Taïwan n’est pas un simple épouvantail destiné à effrayer le reste du monde, inquiet d’une guerre dans le détroit, c’est un défi fondamental pour le régime. Il s’agit d’une société chinoise démocratique qui fonctionne et qui empêche l’accomplissement du « grand rêve de renaissance » de la nation chinoise, pilier idéologique du régime sous Xi Jinping. Mais les stratèges chinois connaissent le coût militaire – et donc politique – d’une invasion. Ils ne peuvent être certains que les États-Unis resteraient passifs, et l’Armée populaire de libération n’est pas « prête au combat » face à la première puissance militaire mondiale, malgré les injonctions de Xi depuis plus de dix ans. La survie du régime demeurant sa priorité absolue, il est peu probable que Pékin prenne le risque d’une telle opération, surtout face à un président américain dont l’irrationalité imprévisible est une donnée centrale. Même l’échéance symbolique de 2049 – centenaire de la République populaire – ne garantit pas un passage à l’acte et, à ce terme, les incertitudes sont trop importantes.
Quelle relation Xi entretient-il avec Poutine ? À quel point ce dernier dépend-il de la Chine ?
Bien avant la guerre en Ukraine, Pékin et Moscou avaient compris l’intérêt de mettre en scène leur amitié, jusqu’à proclamer un « partenariat sans limites » peu avant l’offensive russe. Face à l’Occident, cette alliance offre l’image d’un front idéologique alternatif, susceptible de séduire le Sud global et les régimes autocratiques sous pression. L’isolement russe permet à la Chine de négocier au mieux ses approvisionnements en gaz. Grâce à sa puissance industrielle et technologique, Pékin permet à Moscou de maintenir ses chaînes d’approvisionnement, y compris en composants sensibles. Mais la relation reste déséquilibrée, avec une Chine dominante face à une Russie en demande. Cette asymétrie réveille d’anciennes rancœurs, et Moscou a cherché en vain à rééquilibrer les échanges pour ne pas rester un simple fournisseur d’énergie. Un éventuel rapprochement entre Trump et Poutine serait perçu très négativement à Pékin, qui ne tolère des relations qu’inégalitaires et à son avantage. La Chine rêvait d’un G2 avec Washington ; un nouveau duopole États-Unis-Russie desserrant la dépendance russe serait vécu comme un échec stratégique majeur par Pékin.
Quel type de relation la Chine cherche-t-elle à bâtir avec les pays dits « du Sud », particulièrement ceux d’Asie du Sud et d’Afrique ?
Les pays du Sud, notamment le continent africain, font l’objet d’une attention particulière. La RPC joue de son statut de pays « du tiers monde » contre l’Occident et les ex-puissances coloniales. Les États africains constituent une base de soutien importante à l’ONU sur des sujets sensibles pour Pékin comme les droits de l’homme ou Taïwan. La Chine s’intéresse à l’Afrique comme source de matières premières mais aussi comme marché pour les productions chinoises les moins sophistiquées. Enfin, avec le projet des routes de la soie, la Chine investit dans les infrastructures de connectivité, accentuant son influence régionale.
Mais les déceptions ne sont pas absentes de cette stratégie d’influence alors que les capacités d’investissement de la Chine sont réduites par le ralentissement économique. L’Asie du Sud-Est joue un rôle essentiel dans la stratégie de délocalisation des entreprises chinoises, mais Pékin n’a pu imposer son influence géopolitique à l’Asean (Association des nations d’Asie du Sud-Est) qui tente de suivre une stratégie d’équilibre face à la Chine, dont la stratégie agressive en mer de Chine méridionale a nui à son influence régionale. En Asie du Sud, le Pakistan reste un allié proche mais peu solide ; la relation avec l’autre géant asiatique, l’Inde, demeure méfiante, d’autant que sa croissance dépasse aujourd’hui celle de la Chine.
« La Chine n’a pas d’alliés, hormis la Corée du Nord et, dans une certaine mesure, le Pakistan »
Qui sont les alliés les plus évidents de Xi actuellement ?
La Chine n’a pas d’alliés, hormis la Corée du Nord et, dans une certaine mesure, le Pakistan. La Russie demeure un partenaire clé, mais la relation est fragile. Le Sud global peut appuyer ponctuellement les intérêts chinois, mais sans réelle valeur stratégique. Même le Laos et le Cambodge, pourtant très dépendants, ne suffisent pas à ancrer l’Asie du Sud-Est comme base stable. En Asie du Nord-Est, la volonté de répondre aux aberrations tarifaires de Donald Trump n’efface pas les fortes tensions qui subsistent entre Pékin et Tokyo. La RPC est loin de pouvoir – ou même de vouloir – édifier un réseau d’alliances militaires, et l’Organisation de coopération de Shanghai (SCO) n’a rien du pacte de Varsovie qui liait l’URSS et les autres pays du bloc de l’Est. Certes, les États-Unis de Trump affaiblissent l’Otan, mais la Chine n’a ni la capacité ni l’architecture pour diriger un bloc équivalent face à l’Occident. Entre le retrait possible des États-Unis et l’impuissance réelle de la Chine, c’est le vide et le chaos qui pourraient s’installer.
Pourquoi la Chine évite-t-elle de s’impliquer dans les grands conflits actuels, comme ceux en Ukraine ou au Proche-Orient ?
La RPC refuse tout engagement direct susceptible de compromettre ses intérêts. En Ukraine, elle soutient Moscou sans prendre de risques majeurs : ainsi, plusieurs entreprises et grandes banques d’État se sont retirées de projets dans l’Arctique russe, craignant les sanctions secondaires américaines. Au Proche-Orient, la Chine joue aussi la prudence : elle condamne Israël pour maintenir ses liens avec les États arabes et l’Iran, ses principaux fournisseurs d’énergie avec la Russie, tout en évitant une implication réelle. Première bénéficiaire du commerce mondial, elle reste à distance des attaques des houthistes yéménites en mer Rouge et continue de compter sur la Pax Americana… tout en la dénonçant. Sur ces grands sujets, elle garde ouvertes toutes les options. En Europe, elle pourrait se positionner comme futur acteur de la reconstruction de l’Ukraine, au profit de ses entreprises, dont le savoir-faire en la matière est reconnu. Un scénario très probable si Kiev sort de la guerre humilié par l’abandon de l’Occident. Et si l’UE, déçue par le refus américain de l’impliquer, se laissait séduire par le discours « inclusif » des Chinois.
À quoi pourrait ressembler la Chine de Xi dans dix ans ?
Il faut garder à l’esprit qu’au-delà de la puissance apparente, un régime comme celui-là ne peut durer indéfiniment en raison de ses faiblesses structurelles. Et ne pas oublier que, dans ces conditions, la surprise stratégique demeure la seule certitude.
Propos recueillis par SYLVAIN CYPEL
« Xi Jinping se veut l’héritier de Mao comme de la Chine impériale »
François Bougon
Ancien correspondant de presse à Pékin, François Bougon, l’auteur de Dans la tête de Xi Jinping évoque le parcours du président chinois, analyse la façon dont il conçoit et exerce le pouvoir, ainsi que le « rêve chinois » qu’il porte, inscrit dans un grand roman national dont Xi se voit,…
[Sosies]
Robert Solé
Ces dernières années, le célèbre baryton chinois Liu Keqing, lauréat de plusieurs prix internationaux, a été radié de TikTok à diverses reprises, au grand dam de ses admirateurs...
Portrait de la société chinoise
Une infographie permettant de dresser le portrait de la société chinoise.