Le noir Combarel
Temps de lecture : 3 minutes
Les yeux crevés du vieil hôpital sucent mon âme jusqu’à l’os. Leur fausse charité fait de ces fenêtres noires des tableaux morts. Neuf heures du soir, l’instant où la province balaie les derniers anges qui traînent les rues et les envoie au diable. Une main glacée me pousse rue Combarel. L’automne aux joues couperosées se hâte dans les rues de Rodez. On ferme. On est chez soi, calé entre un bloc de fatigue et un bloc de lumière blanche. Dieu, s’il y tient tant, repassera demain quand les boutiques rouvriront. La rue Combarel est la rue d’enfance de Soulages. Je la vois dans les meilleures conditions : dans le froid insinueux, en noir – en deuil. Je découvre le reste des os des artisans qui la peuplaient. La poitrine ouverte d’un ancien garage. Les voitures sont montées au ciel, le garagiste avec. Demeure l’enseigne. La rue du peintre avait deux visages. D’un côté une guirlande d’artisans, le chapelet à grains rudes du savoir-faire français. De l’autre les étranglements institutionnels de l’âme, le monde qui dévoile sa gueule torve – hôpital, prison, caserne, asile de fous, etc. D’un côté les mains usées jouaient avec le dieu de l’air, faisaient tinter marteaux et fers à ses oreilles. De l’autre les tables de la Loi d’État, tombées du ciel, réassemblées en silence humide et punitif. Rien ne vaut l’expérience muette des choses – ce coup de poing à l’estomac donné par un morceau de rue froide et sans appel, une nuit d’automne à Rodez. Des semaines après je sens encore les crachats de pierre de l’hôpital sur mon visage, cette pesanteur surnaturelle du monde, l’empêchement organisé de vivre.
Le soleil gît au fond du noir. Un seul va l’y chercher, le ramène, nous le donne
Sur la porte de la maison d’enfance de Soulages, face à l’hôpital, un heurtoir : une main de bronze cognant à la porte. C’est un dieu qui demande à entrer, qui n’est pas une chose, qui est l’événement de la vie triomphant de ce qui l’étrangle. Un signe d’élection : « Tu seras l’exceptionnel, les yeux d’or de nos manques. » À gauche comme à droite de la rue, l’inconnu n’est pas toléré. Les médecins tutoient la mort, c’est leur cousine. Les soldats sont de plomb dans leur obéissance. Les infirmiers psychiatriques lâchent le chien de la Raison sur ceux qui pensent et souffrent de penser. Quant aux artisans joyeux, fumeurs, buveurs, ils façonnent des merveilles ordinaires mais ne font qu’obéir à des géométries éternelles. Pas d’éclair de truite entre leurs mains savantes : on va du connu au connu, de même que sur le trottoir en face on va de l’Ordre à l’Ordre. Le génie c’est s’arracher au désert du monde, quitter liens et lois, empoigner la rue Combarel comme un serpent et la jeter dans un lac noir, dont la surface luit de départs de feu. « Tu écarteras couleurs et formes. Tu remonteras le cours des nuits – celle du monde, celle du cœur, celle des univers. Tu nous donneras à voir, à aimer et à manger la nourriture première d’un reflet, la trace d’un ongle sur la suie du temps. »

Enfant, le peintre voyait le boulanger apporter le pain noir aux prisonniers. Il rêvait de cette mie des ténèbres, la dévorait des yeux. Soulages est cet enfant d’une centaine d’années luttant à mains nues avec les chevaux de l’Apocalypse qui se cabrent devant chaque nouveau-né, son faire-part de décès imprimé à l’envers de l’avis de naissance. Decazeville n’est pas si loin de Rodez. C’est une terre de mineurs. Le soleil gît au fond du noir. Un seul va l’y chercher, le ramène, nous le donne.
Ce texte est issu du hors-série que le 1 a consacré à Pierre Soulages en 2019
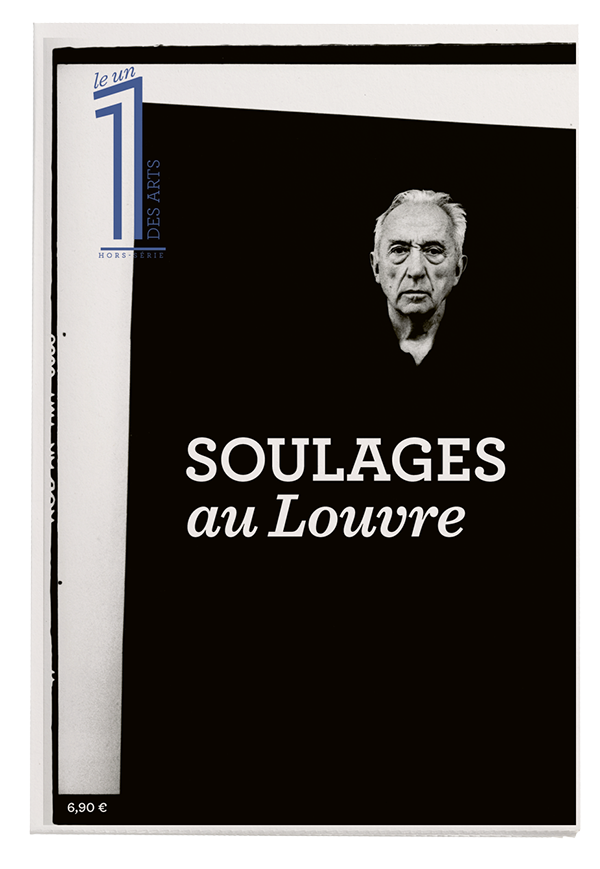
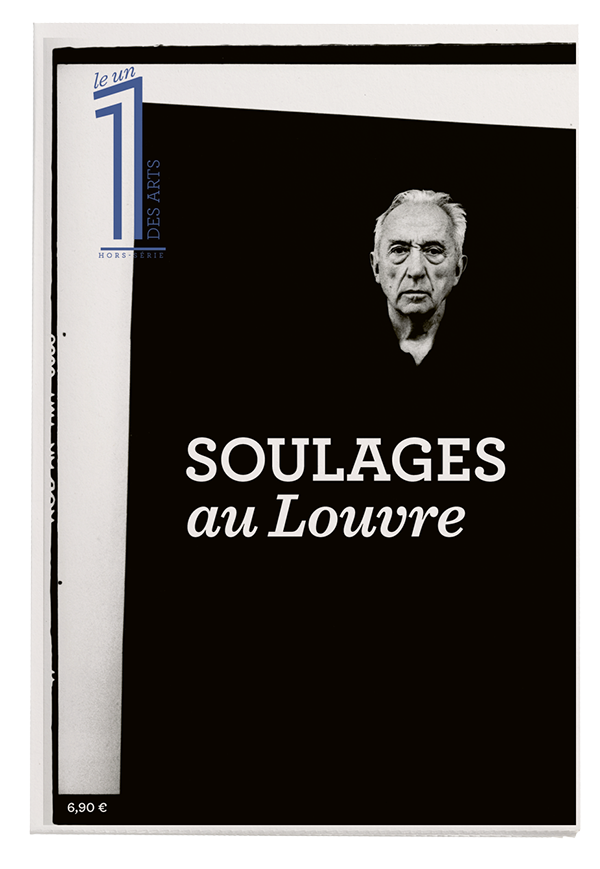
« Cette peinture contient le monde entier »
Alfred Pacquement
Son œuvre est d’une remarquable cohérence, mais on peut incontestablement y déceler des « phases ». La principale rupture se situe en 1979, lorsque commence cette période qu’il a appelée Outrenoir. On peut constater aujourd’hui qu’elle se poursuit.
La morsure de l’acide
Lou Héliot
Même si elle n’en constitue qu’une partie infime, la gravure illumine toute l’œuvre de Soulages. Passion cyclique et creuset d’expérimentation, l’ensemble de ses eaux-fortes, qui sont toutes c…
« Il crée des stèles arc-en-ciel »
Fabienne Verdier
Pierre Soulages a inventé ses outils de peintre. Vous aussi. A-t-il ouvert la voie ?
Il m’a enseigné cela. Il a eu l’audace de quitter les pinceaux traditionnels du peintre et de réinventer l’acte de peindre avec de nouveaux outils. Il s’est intéressé aux outils d’autres tec…







