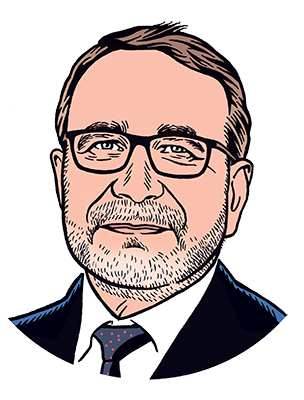Une humanité à protéger
Temps de lecture : 5 minutes
Depuis les années 1980, je suis intervenu sur de nombreuses zones de conflit, en ex-Yougoslavie, au Liban, pendant la guerre du Golfe, plus récemment en Syrie ou en Ukraine. Je porte en moi le souvenir de ceux que je n’ai pas réussi à sauver, ceux pour qui j’ai manqué de temps et de moyens, ceux que j’ai laissés mourir. Je pense à une petite vendeuse de bonbons de 8 ans qui eut la carotide tranchée dans un attentat à Djibouti. Il n’y avait pas assez de place au bloc, pas assez de chirurgiens. J’ai dû la sédater de manière définitive, elle n’a jamais quitté mon esprit.
Je viens de passer seize jours à Rafah et Khan Younès. En quarante années d’exercice, je n’avais jamais été témoin d’un tel chaos. Avoir conduit un million et demi de personnes dans une nasse où vivaient déjà plus de deux cent mille habitants, les laisser survivre dans des abris ou sur les trottoirs, les avoir privées de toute possibilité de se nourrir, de se soigner, d’avoir un minimum d’hygiène dans une ville dont tous les conduits d’évacuation sont bouchés et où les poubelles ne sont pas ramassées faute d’essence ; avoir ainsi concentré une population désœuvrée, encerclée et bombardée… je ne trouve pas d’autre mot que celui de « ghetto ». Il y a pire que de tuer un homme, c’est de lui enlever sa dignité.
« Il y a pire que tuer un homme, lui enlever sa dignité »
Si l’on voulait soigner les dizaines de milliers de blessés, il faudrait 6 000 lits d’hôpitaux, six fois plus qu’il n’en existe aujourd’hui, sans compter le matériel, les médicaments et les antidouleurs qui manquent. Aux blessés dus aux bombardements et aux tirs de snipers s’ajoutent ceux qui souffrent de pathologies aiguës ou chroniques, ceux qui sont menacés par les épidémies et la faim. Un souvenir me hante : une femme de 24 ans, gravement diabétique et enceinte de sept mois. Elle est arrivée à l’hôpital dans le coma, en état d’acidocétose, une complication grave liée au manque d’insuline. Elle a perdu son bébé dans son utérus avant de mourir le lendemain pour une raison toute bête : le laboratoire était incapable de nous fournir ses bilans toutes les heures. Cette femme n’avait pas mérité de mourir !
« Nous, les humanitaires, nous sommes les témoins impuissants de cette déshumanisation à l’œuvre. »
Nous, les humanitaires, nous sommes les témoins impuissants de cette déshumanisation à l’œuvre. Quand j’étais en Syrie ou ailleurs, les populations avaient la possibilité de fuir les zones de violence. Près de 5 millions de Syriens ont quitté leur pays, 6 millions d’autres se sont déplacés en Syrie. L’ONU avait réussi, avec l’appui d’Erdogan, à instituer quatre zones de désescalade de la violence. Les Israéliens auraient pu autoriser une telle zone à Rafah, en contrôlant qui y entrait pour éviter que leurs cibles du Hamas ne se mêlent à la population.
De nombreuses ONG internationales sont présentes à Gaza depuis au moins quarante ans.
« Nous vivons le massacre d’une population à guichets fermés. »
Des humanitaires, essentiellement palestiniens, travaillent pour Médecins sans frontières, Médecins du monde, Handicap International, mais ils ont de moins en moins de matériel et de moyens. Et tous les sièges de ces ONG internationales ont été visés par les bombardements. Peut-on sérieusement penser que ces organisations cachaient des combattants du Hamas dans leur sous-sol ?
Nous vivons le massacre d’une population à guichets fermés. On entend les présidents Biden, Macron et quelques autres demander à Israël de modérer son intervention tout en continuant, pour les États-Unis, à livrer des armes, c’est insupportable. Plutôt que de construire un port artificiel ou d’effectuer des largages parachutés qui ne peuvent excéder huit ou dix tonnes de nourriture, il faut d’urgence ouvrir un ou même deux points de passage pour l’aide humanitaire. Un seul camion, c’est soixante-dix, voire cent tonnes de vivres et de médicaments !
Nous vivons un moment de barbarie, cela concerne aussi bien l’attaque du 7 octobre par le Hamas que la riposte indiscriminée d’Israël. Comment l’Occident pourra-t-il continuer à donner des leçons de valeurs après cette catastrophe ? Il n’y a aucune raison que des innocents paient le prix de cette guerre, et c’est là que notre rôle d’humanitaire est essentiel, à condition de pouvoir l’exercer.
Nous vivons une profonde régression. Tous les progrès accomplis après la guerre de 1939-1945 avec la signature des conventions internationales sont comme effacés. Le XXIe siècle devrait être le siècle de la collaboration face aux urgences, notamment climatiques ; il est en fait celui des nationalismes et des populismes.
Jamais l’humanitaire n’est apparu aussi essentiel. Pour ma part, il constitue un engagement lié à ma foi chrétienne qui n’est pas une identité mais un chemin qui peut me permettre de trouver la vérité et la vie. Ce chemin, c’est la croyance absolue que l’autre est mon frère et qu’il faut donc agir pour qu’il soit considéré et traité comme tel, dans la paix, la justice et la dignité. Ces motivations trouvent leurs sources dans ma vie intérieure, mais d’autres développent les mêmes engagements à partir de valeurs laïques.
Dans tous les cas, il est question d’une préoccupation de l’autre qui nous enrichit mais qui ne va pas sans risque, je ne pense pas seulement à la mise en danger bien réelle de la vie des humanitaires, mais surtout au fait d’être bouleversé par l’autre et ce qu’il vit. Mes nombreuses interventions en Syrie m’ont conduit, en 2014, à démissionner de l’hôpital de Metz : comment pouvais-je continuer à prolonger, de manière très aléatoire, la vie de personnes âgées dont les familles nous demandaient d’éviter tout acharnement thérapeutique quand, en Syrie, nous manquions de tout pour sauver des jeunes gens dont l’existence avait à peine commencé ?
La lecture des écrits d’Etty Hillesum, jeune femme juive morte à Auschwitz, m’a conforté dans l’idée que si je voulais avoir une chance de rencontrer Dieu, c’était moins à travers la pratique religieuse que par mon attitude concrète dans la vie. Cette disposition à reconnaître en l’autre une humanité, à tenter de la protéger, voire à la sauver, a forgé ma vie d’humanitaire. Cet engagement est aujourd’hui attaqué de toutes parts et j’en suis profondément désespéré.
Conversation avec PATRICE TRAPIER
« Les financements ne sont, hélas, pas à la hauteur des besoins »
Philippe Ryfman
Spécialiste des questions humanitaires sur la scène internationale, politiste et avocat, Philippe Ryfman revient sur la façon dont ce secteur s’est constitué au cours du xixe siècle et sur les grandes évolutions qui ont marqué son histoire. Il présente également un bilan de sa situatio…
[Tout-terrain]
Robert Solé
« Chaque siècle a sa marotte ; le nôtre, qui ne plaisante pas, a la marotte humanitaire », écrivait Sainte-Beuve à la fin de la période romantique. L’adjectif avait été employé pour la première fois en 1835 par Lamartine, dans une correspondance, à propos de son « long poème humanitaire ». Ce qui…
Les principales zones d’intervention
Ces dernières années, l’augmentation de la fréquence, de la durée et de la complexité des crises humanitaires a été telle qu’en 2024, 363 millions de personnes – soit 4,5 % de la population mondiale – requièrent une aide humanitaire pour survivre.