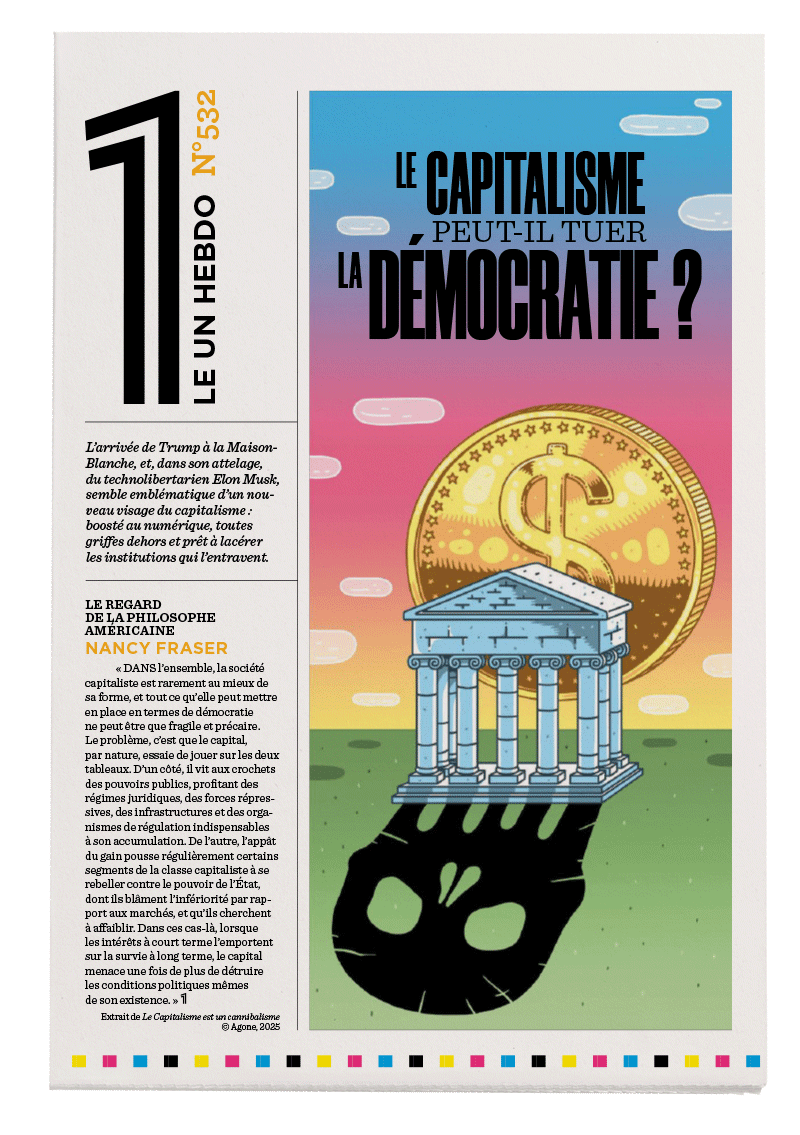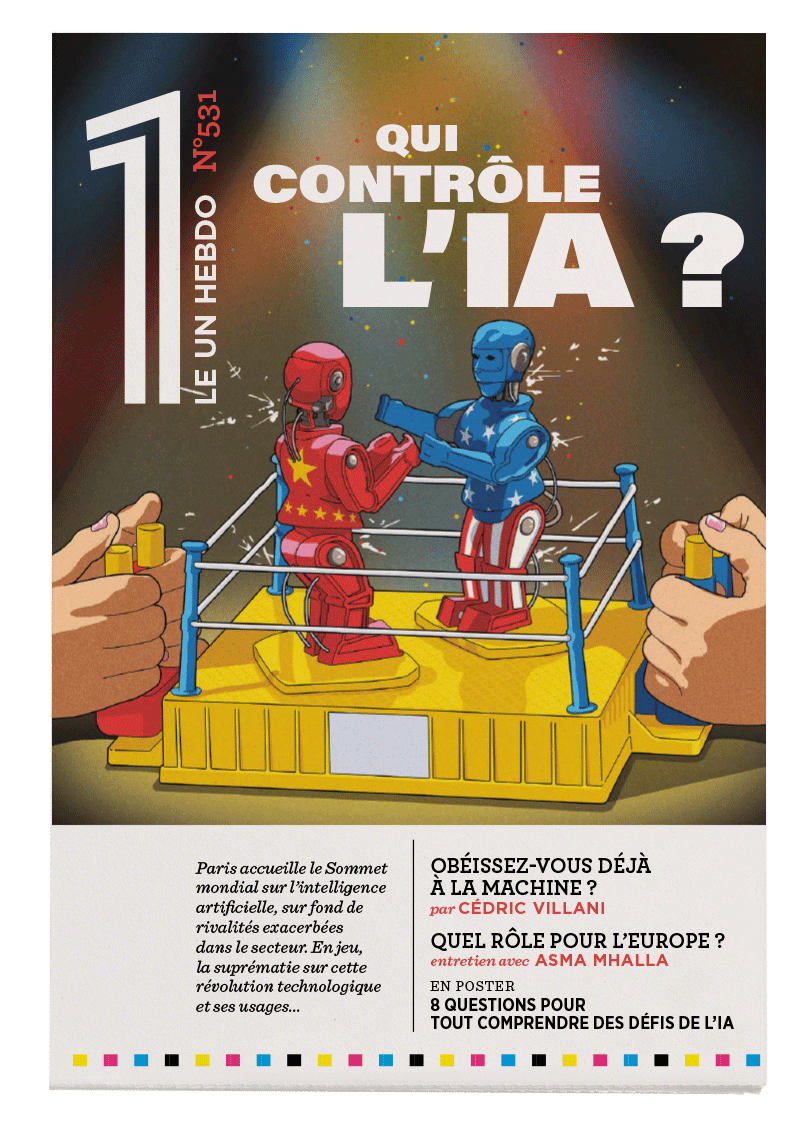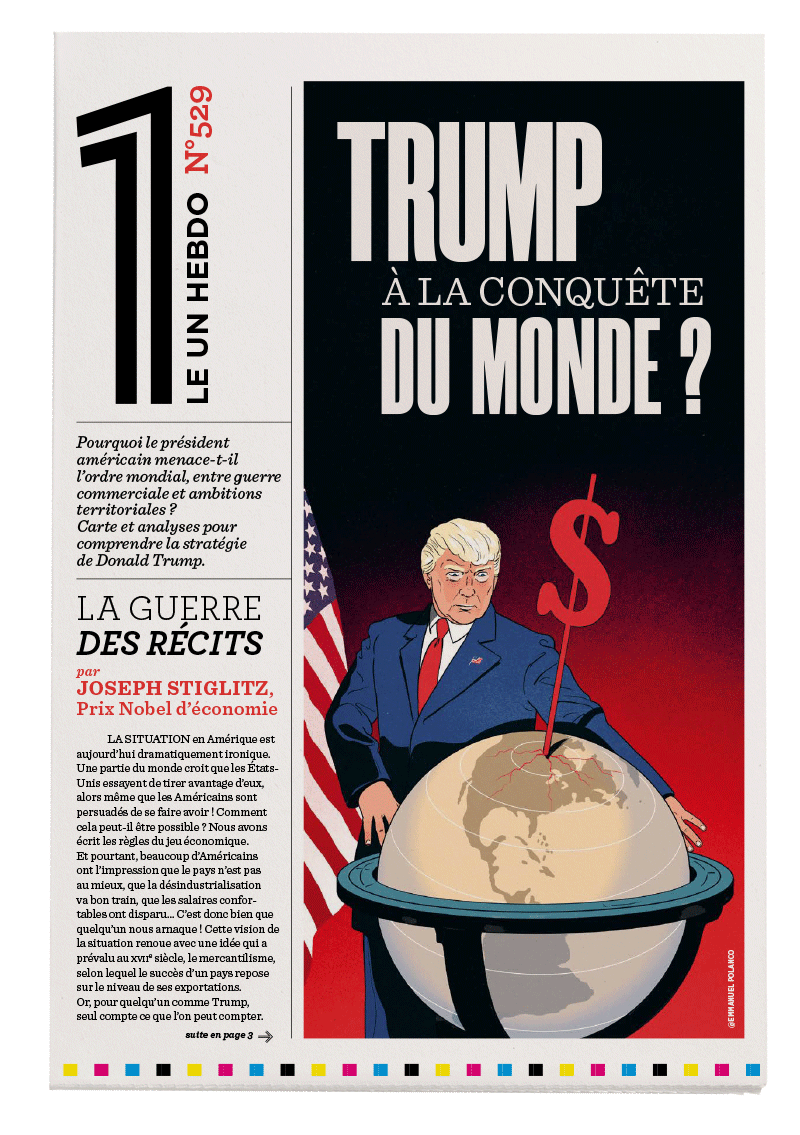De Colbert à la start-up nation
Temps de lecture : 7 minutes
« L’État ne peut pas tout. » Cette phrase lâchée par Lionel Jospin en 2000 pour dire l’impuissance de son gouvernement face à la décision d’une grande entreprise de fermer une usine à Vilvorde est restée dans l’histoire comme le signe de la fin d’une époque. Elle est la manifestation symbolique d’un déclin de la puissance publique entamé depuis plusieurs années, et qui éclatait à la face d’une population en colère. Dans des contextes différents, cette sentence devenue proverbiale est comme un boomerang qui revient, depuis près de vingt ans, au visage du personnel politique. Les Français lui reprochent, de manière paradoxale, à la fois son inaptitude à contrôler les finances publiques et son incapacité à maintenir la puissance de cet État tutélaire qui, en France plus qu’ailleurs, est considéré comme un élément central de l’identité nationale.
Pour comprendre ce phénomène, il convient de rappeler que la construction de l’État s’est, en France, effectuée parallèlement à la montée en puissance de l’autorité politique. Fidèle à cette histoire, le général de Gaulle a construit, bien avant son retour au pouvoir en 1958, sa conception d’une « certaine idée de la France » comme centrée sur l’État. La planification de l’économie a constitué le volant administratif d’un projet politique stato-centré, corollaire d’une méfiance vis-à-vis des forces du marché. « Pour nous, c’était Keynes et le plan », pouvait dire Yves Guéna, ancien ministre du Général devenu un proche de Jacques Chirac, en évoquant la première promotion de l’ENA à laquelle il appartenait. Jusque dans les années 1980, la gauche et la droite, en dépit d’oppositions de façade et avec le soutien des élites administratives et intellectuelles, ont partagé cette même conception : un État central chargé d’administrer le fonctionnement de la société, limitant le rôle d’une société civile considérée avec méfiance.
Les années 1980 ont eu raison de cet unanimisme. L’influence des théories libérales de la dérégulation inspirées par le Royaume-Uni de Margaret Thatcher et les États-Unis de Ronald Reagan ont conduit à l’émergence d’une pensée de la concurrence et d’une croyance plus vive dans le marché, qui ont progressivement contaminé les élites politiques puis administratives. Dominante en Europe, cette conception a conduit à considérer l’État comme un obstacle et l’équilibre des comptes publics comme une fin en soi. L’échec des nationalisations a mené, à partir de 1986, à un vaste programme de privatisations qui sera entrepris aussi bien par la droite au pouvoir à l’époque que par la gauche plurielle au gouvernement entre 1997 et 2002.
La décennie 2000 a commencé par prolonger ce mouvement. La privatisation des autoroutes sous les gouvernements Raffarin et Villepin entre 2002 et 2007 a constitué le point d’acmé du mouvement initié quinze ans auparavant. L’élection de Nicolas Sarkozy en 2007 sur un programme libéral de réduction du nombre de fonctionnaires et de mise en œuvre de critères de performance accrus pour les politiques publiques semblait promettre une accentuation du phénomène. La mise en vente du patrimoine de l’État, amorcée sous les gouvernements précédents, a connu d’abord une accélération, provoquant occasionnellement des remous. L’hôtel de la Marine, géré par le Centre des monuments nationaux, est alors pressenti pour passer sous pavillon privé, provoquant un scandale qui fera finalement capoter l’affaire.
La crise de 2008 a semblé inverser la tendance. Elle a rappelé l’importance des États pour réguler un marché devenu hors de contrôle. Nicolas Sarkozy a dû faire volte-face et complètement revoir son rapport à l’État, alors que l’opinion observait avec angoisse plusieurs de ses voisins européens dangereusement menacés de faillite, faute d’avoir su conserver des instruments robustes de la puissance publique.
Pour autant, le programme de libéralisation de l’économie, accentué par une politique favorable à l’entreprise – une constante de la vie politique française depuis au moins une décennie –, n’a pas été enterré. Il a constitué une tendance lourde à laquelle aucun des derniers gouvernements n’a dérogé. Aujourd’hui, ambassades et locaux appartenant à la puissance publique sont progressivement cédés, car trop coûteux à entretenir et sous-utilisés (ou mal). La mise en concurrence de la SNCF, prélude à sa privatisation, est un signe supplémentaire d’une volonté d’« alléger » l’État de certaines des entreprises dont il conserve le contrôle. La fermeture des services publics en milieu rural – hôpitaux, maternités, tribunaux, bureaux de poste… – est une autre manifestation du même phénomène.
L’État, « cette vieille godasse pourrie », comme l’appelle l’un des personnages de l’excellent film de Pierre Schoeller L’Exercice de l’État, prend aujourd’hui l’eau de toutes parts, alors même que les dépenses publiques continuent d’augmenter. Il est devenu un fantôme que l’on contemple avec nostalgie. La référence permanente et stérile à l’époque des Trente Glorieuses sert de lamento à une classe politique impuissante. Elle alimente la colère et le déclinisme des citoyens désarçonnés par ce changement de paradigme majeur, cette vérité qu’on leur a cachée – ou qu’ils ont refusé d’entendre. Elle nourrit les populismes qui promettent ce qu’ils ne pourront tenir : le retour à un passé évanoui de la grandeur de l’État.
Certes, l’État ne peut plus tout, mais renoncer à ses moyens d’action ne revient-il pas à abandonner toute idée de la politique comme transformation du réel ? Les élites politiques sont de plus en plus nombreuses à constater l’aporie de la situation. Comment prétendre améliorer le quotidien des Français tout en se privant des moyens de la puissance publique, affaiblie par des programmes d’économie permanents ? Comment combattre les partis anti-système qui prospèrent sur le regret de l’État-puissance tout en s’accrochant à des politiques de restriction budgétaire ?
Attachés aux symboles de la souveraineté nationale que sont les infrastructures publiques, soudés autour de leur État-providence, persuadés que les « véritables » économies ne sont pas effectuées aux bons endroits, beaucoup de Français envisagent le déclin de la puissance publique avec pessimisme et amertume, tout en lui demandant plus d’efficacité.
L’incapacité des gouvernements successifs à répondre à cette demande d’État les condamne. En refusant de considérer son affaissement autrement que comme une question d’économie, la majorité actuelle, comme avant elle la gauche et la droite, les voue à un divorce avec une opinion publique divisée sur la question du libéralisme. La demande d’efficacité des services publics s’accompagne d’une distance avec une conception uniquement entrepreneuriale de la vie sociale.
Le « nouveau monde » n’a pas, pour l’heure, réussi à dépasser cette ambivalence qui lui aliène la partie la plus fragile de la population, dont la dépendance à l’État est également la plus grande. Il incarne le décalage entre des élites globalement converties au libéralisme économique et à la nécessité d’un État plus souple, ou, dans les termes du technolibéralisme actuel, plus « agile », confrontées à une population qui se raidit face à ce qu’elle perçoit comme le signe d’une déréliction nationale. La crise des Gilets jaunes est le symptôme de ce fossé. Elle est venue sanctionner une erreur originelle, que le chef de l’État n’a pas fini de payer : au pays de Colbert, la start-up nation n’est toujours pas un programme.
« Les privatisations ne mettent pas la souveraineté nationale en jeu »
Jacques Lévy
Comment expliquez-vous l’opposition qui se manifeste à propos de la privatisation de la société ADP, anciennement Aéroports de Paris ?
Cette crispation est surtout le fait d’élus. C’est une &e…
[Bijoux]
Robert Solé
Depuis une trentaine d’années, chaque fois qu’une privatisation est envisagée par un gouvernement (de droite ou de gauche), l’opposition (de gauche ou de droite) accuse immanquablement le pouvoir de « brader les bijoux de famille &ra…
Retour sur un cliché
Barbara Stiegler
On associe couramment le néolibéralisme au désengagement de l’État et à son repli sur les fonctions régaliennes. Pourtant, si cet État minimal est bien celui des ultralibéraux et des libertariens, le programme du néolib&eac…