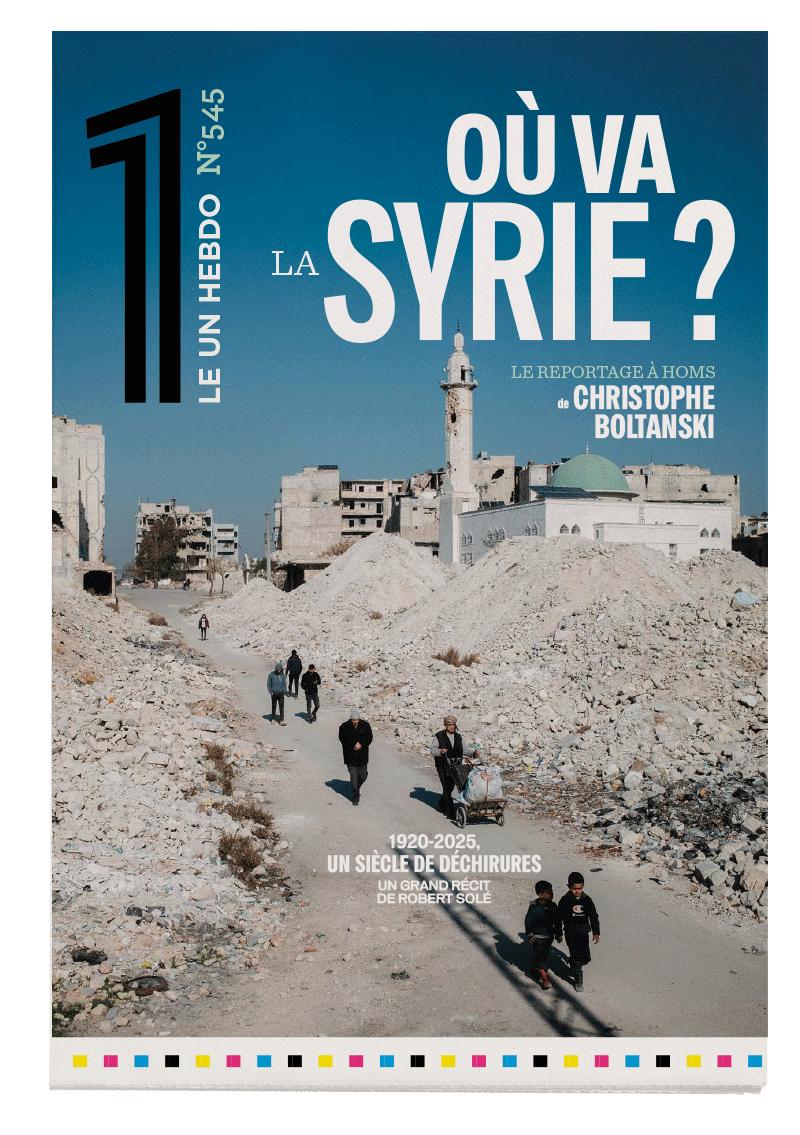À l’assaut des cimes
Temps de lecture : 15 minutes
Les alpinistes, quand on les somme de décrire leur passion, sont des as de l’esquive. Lionel Terray nous a légué ses fameux « conquérants de l’inutile » et l’Anglais George Leigh Mallory, une pirouette inoubliable. On lui demande, juste avant qu’il ne parte s’y perdre :« Pourquoi gravir l’Everest ? » « Because it’s there », répond-il. « Parce qu’il est là. » La passion a ses raisons que la raison doit ignorer. Mais l’exploration de l’Himalaya n’a pas été qu’une histoire de passion. Les plus hauts sommets du monde sont devenus, au milieu du XXe siècle, les dernières places fortes de la planète, que des armées d’alpinistes coiffés de masques à oxygène se sont disputées dans ce qui restera peut-être comme le dernier affrontement colonial de l’histoire.
Mallory, passionné par son Everest-Graal, est un éclaireur, un voltigeur ignorant sa propre cavalerie. Depuis le début du XIXe siècle, une armée de géomètres britanniques et d’assistants autochtones, les pundits, triangule l’Empire des Indes et mesure les pics qui ferment son horizon nord. Le plus haut sommet du monde est identifié et rebaptisé du nom de George Everest, responsable du Great Trigonometrical Survey of India, la plus grande opération cartographique de l’histoire avant Google Maps. Des officiers britanniques pénètrent au Tibet et approchent l’Everest par le nord. C’est ainsi qu’en 1921 et 1922, Mallory peut faire partie des premières expéditions à mettre le pied sur la montagne.
Si l’Everest est là, c’est bien parce que nous, Européens, l’y avons mis. L’Himalaya, le « pays des neiges », chapelet de sommets stratosphériques qui constituent la plus formidable échine de l’écorce terrestre, était là depuis des millénaires pour les montagnards qui cultivaient du riz sur ses versants fertiles, les caravanes de marchands qui traversaient ses hauts cols, les pèlerins qui marchaient inlassablement autour de ses sommets sacrés, sans chercher à mettre un chiffre (et encore moins un pied) sur leur cime. L’Everest était Chomolungma, la « déesse mère des vents », et aucun Européen n’avait entendu le nom d’Annapurna, la « pourvoyeuse d’abondance ».
Vu depuis le Vieux Continent au milieu du XIXe siècle, l’Himalaya est une terra incognita, le royaume des altitudes inimaginables, la terre de mission impossible attendant ses jésuites téméraires, laissée à main droite en partant vers l’Orient par les marchands de la route de la soie. Mais dans les Alpes, des savants friands d’expériences scientifiques et des gentlemen anglais en vacances d’été inventent l’alpinisme. Science, exploration de terres inconnues, épreuve initiatique, dépassement de soi… L’alpinisme offre la possibilité d’être le premier à poser le pied sur un sommet, et cette perspective devient assez excitante pour qu’on parle de « conquête ».
Dans les Alpes, cette phase est menée tambour battant. En quinze ans, de 1850 à 1865, tous les sommets du Vieux Continent sont gravis. Dans l’Himalaya, c’est une autre affaire. Avant la Première Guerre mondiale, quelques explorateurs audacieux prennent la mesure de la démesure de ces montagnes, des obstacles formidables qu’elles opposent, physiologiques, physiques, météorologiques… Le génial Albert F. Mummery disparaît sur les pentes du Nanga Parbat, premier d’une très longue série de victimes de l’altitude. L’improbable couple d’un médecin suisse et d’un occultiste anglais, Jules Jacot-Guillarmod et Aleister Crowley, lance une première tentative sur le K2 en 1902 et une seconde trois ans plus tard sur le Kangchenjunga, à l’extrémité orientale de la chaîne. En 1909, le duc des Abruzzes est le premier à dépasser l’altitude de 7 500 mètres. Mais de sommet majeur, point.
L’Himalaya, d’autant plus excitant qu’il résiste à toutes les tentatives, se fiche dans la tête de l’alpiniste comme l’épine d’oursin dans le pied du baigneur. Au cœur du plus grand des continents, la plus haute chaîne de montagnes du monde offre les derniers arpents de notre planète où l’homme n’arrive pas à mettre le pied, les dernières terres de « conquête » depuis que les deux pôles ont été atteints. L’Everest est donc « le troisième pôle » et l’Himalaya, le dernier mystère. On sait que quatorze sommets dépassent l’altitude de 8 000 mètres. Dix sont en Himalaya et quatre dans le massif qui prolonge la chaîne au nord-ouest, au-delà de l’Indus, le Karakoram. L’esprit européen s’empare du mystère Himalaya, le code en chiffres. Il y projette aussi des fantasmes et des idées plus ou moins funestes.
*
La Grande-Bretagne ouvre le bal himalayen des grandes nations européennes après la Première Guerre mondiale. En 1921, le gouvernement tibétain autorise une expédition à approcher la montagne par le nord – le Népal, dirigé par l’orgueilleuse dynastie des Rana, est alors totalement fermé aux étrangers. La troupe, avec sa cohorte de porteurs, est conduite par un militaire, le général Charles Bruce, mais c’est un homme à l’air juvénile et aux oreilles décollées – un Botticelli, dira un de ses amis poètes – qui donne un visage à la passion pour le Toit du monde : George Leigh Mallory. Mallory fait vibrer ses compatriotes avec son obsession pour l’Everest. Mobilisé sur le front de la Somme, il trouve le temps d’écrire le récit d’une de ses ascensions dans les Alpes et conclut : « Avons-nous vaincu un ennemi ? Aucun, sinon nous-même. » Plusieurs membres de cette première expédition de reconnaissance se sont battus dans les tranchées.
À l’Everest, Mallory va toujours devant. Il est le premier à voir le sommet de près, perçant les nuages « plus haut que dans le plus sauvage des rêves ». Il découvre l’accès à la montagne et s’élève sur ses pentes, jusqu’au col nord, à plus de 7 000 mètres d’altitude. En 1922, lors d’une seconde expédition, Mallory refuse d’utiliser les nouveaux appareils à oxygène, ce qui ne l’empêche pas d’être le premier à passer l’altitude symbolique (pour ceux qui comptent en mètres) de 26 247 pieds, soit 8 000 mètres. Lors de la descente dans la neige profonde, il échappe à une avalanche qui ensevelit sept sherpas – autre triste première. Pour le siècle à venir, les « tigres », comme on surnomme ces guides et porteurs autochtones, paieront un lourd tribut aux rêves de sommets de leurs employeurs occidentaux.
De retour de l’Himalaya, Mallory se retrouve en position d’accusé. C’est lors d’une tournée de conférences aux États-Unis, où il recueille des fonds pour une troisième expédition, qu’un journaliste du New York Times lui pose la fameuse question et transcrit la non moins fameuse réponse. George « Parce-qu’il-est-là » Mallory repart pour l’Everest et y disparaît, en route pour le sommet. Son corps momifié sera retrouvé soixante-quinze ans plus tard, à 8 100 mètres d’altitude – savoir s’il a pu ou non atteindre le sommet avec son compagnon Sandy Irvine est une question, cette fois sans réponse, qui fait les délices des amateurs d’énigmes. Après des funérailles nationales et des années d’abstinence, la danse reprend.
En 1938, les Britanniques en sont à leur septième tentative sur le Toit du monde, qui résiste encore et toujours à l’envahisseur. L’homme qui dirige cette dernière tentative de l’entre-deux-guerres s’appelle Harold William Tilman. Le style « expédition lourde » n’est pas sa tasse de thé. Il préfère sillonner l’Himalaya en franc-tireur, se vantant de faire tenir ses projets d’expédition au dos d’une enveloppe et partageant pendant des mois le quotidien de ses compagnons sherpas. En 1936, Bill Tilman conduit un petit groupe anglo-américain à la Nanda Devi, 7 816 mètres d’altitude. C’est alors le plus haut sommet gravi jusqu’à la cime. Une simple et belle histoire d’alpinistes explorateurs. Au sommet, Tilman profite du soleil et de la vue, oublie les gestes de victoire, ne pense même pas à serrer la main de son compagnon. Il ne parle pas de conquête, il préfère jouer à la chasse au yéti (voir page 3).
*
C’est une autre histoire qui s’écrit loin à l’ouest, sur les pentes du Nanga Parbat, le colosse solitaire qui domine la vallée de l’Indus et signale l’entrée dans l’Himalaya. Après une première expédition de reconnaissance en 1932, les alpinistes allemands s’acharnent sur cette montagne comme les Anglais sur l’Everest. En 1934, Willy Merkl dirige une grosse expédition financée par le nouveau régime nazi. Deux alpinistes atteignent une antécime, soit la cime précédant le sommet, à plus de 7 900 mètres d’altitude, mais la tempête frappe alors que le gros de l’expédition se trouve à 7 500 mètres. Piégés, épuisés, gelés, les alpinistes succombent les uns après les autres. Neuf morts, dont six sherpas et le chef d’expédition, Merkl. En 1937, nouvelle expédition allemande, nouveau drame : un camp d’altitude est enseveli par une avalanche avec tous ses occupants. Seize morts. Pour la presse du IIIe Reich, le Nanga Parbat devient la « Montagne du destin allemand ».
La confrontation violente avec l’Himalaya est l’écho de ce qui se déroule au même moment dans les Alpes. Une compétition à la vie, à la mort oppose les meilleurs alpinistes des deux régimes fascistes, de part et d’autre des Alpes. Les grimpeurs italiens virtuoses du « sixième degré » brillent dans les parois verticales des Dolomites ; les Allemands se lancent avec une témérité inlassable dans la face nord de l’Eiger, la plus haute paroi du massif européen, la dernière qui résiste aux alpinistes. En 1936, cinq grimpeurs allemands y sont piégés par la tempête et meurent les uns après les autres en tentant de regagner le pied de la face. Le dernier, Toni Kurz, bloqué sur sa corde de rappel, expire à quelques mètres des sauveteurs. Mais l’image de son corps désarticulé, pendu en plein vide, ne dissuade pas les prétendants. En juillet 1938, quatre alpinistes, deux Allemands et deux Autrichiens, viennent à bout de ce « dernier problème des Alpes ». Quatre mois après l’Anschluss, le symbole est parfait. Hitler a suivi l’ascension heure par heure au téléphone ; il reçoit les vainqueurs en personne, les alpinistes sont médaillés, fêtés en héros. On parle de récupération par la propagande nazie. C’est mieux que cela : les deux alpinistes autrichiens, Fritz Kasparek et Heinrich Harrer, sont des militants de la première heure, membres du Parti national-socialiste et engagés dans la Waffen-SS. Sur leur tente au pied de la paroi, ils avaient déployé un drapeau à croix gammée.
L’année suivante, Heinrich Harrer se joint à la cinquième expédition allemande au Nanga Parbat, dirigée par un autre SS, Peter Aufschnaiter. Le groupe, qui explore un versant inconnu de la montagne, est vite repoussé par la météo et regagne Karachi (sous occupation britannique), où la déclaration de guerre le surprend. Les alpinistes sont arrêtés et internés dans un camp britannique.
L’entre-deux guerres aura vu près de vingt tentatives échouer sur les 8 000, principalement l’Everest et le Nanga Parbat. Les Américains ont frôlé le sommet du K2, les Français ont été repoussés au Hidden Peak.
Rideau sur le premier acte.
*
L’Himalaya ressemble à un décor qui ne montrerait qu’une seule de ses faces à la fois. Dans la première moitié du XXe siècle, le Népal est inaccessible et c’est par le Tibet, au nord, qu’ont lieu les tentatives d’ascension de l’Everest. En 1950-1951, par un soudain mouvement de bascule, le Népal s’ouvre aux étrangers et la Chine met la main sur le Tibet, qui se referme.
Au Népal, toute une jungle de sommets inconnus se révèle au monde du jour au lendemain, dont huit dépassent l’altitude de 8 000 mètres. Trois de ces géants n’ont jamais été approchés par des Européens car ils se trouvent entièrement en territoire népalais. C’est le cas de l’Annapurna et du Dhaulagiri, pour lesquels les Français obtiennent un permis d’ascension en 1950. Maurice Herzog réussit l’exploit de conduire une reconnaissance éclair des deux sommets et de gravir à la hussarde celui de l’Annapurna avec Louis Lachenal, le 3 juin 1950. Le retentissement de cette ascension, qui ouvre l’ère de la « conquête » des 8 000, est considérable, et pas seulement en France. Annapurna, premier 8 000, dans lequel Herzog raconte longuement le calvaire des trois semaines de descente sous la mousson, pieds et mains gelés, est un succès de librairie dans le monde entier.
Quelques mois plus tard, un autre best-seller achève de familiariser le grand public (occidental) avec l’Himalaya : Sept ans d’aventures au Tibet. L’auteur est Heinrich Harrer, que nous avions laissé en 1939 dans un camp de prisonniers en Inde. Harrer raconte son aventure rocambolesque : évasion en 1944, traversée de l’Himalaya pour gagner le Tibet, entrée clandestine à Lhassa, longue immersion dans un pays mystérieux, sa culture médiévale. L’histoire s’achève par la fuite de Harrer à l’arrivée du colonisateur chinois.
Ressurgissant de nulle part au bout de sept ans, Harrer accrédite un peu plus l’idée d’un Himalaya mystérieux et inaccessible, où l’Occidental peut faire retraite pour revenir régénéré, lavé de tout passé. Il raconte son Himalaya sans mentionner qu’il a laissé en Europe un fils, des exploits d’alpiniste, un engagement de jeunesse. Il faudra l’apothéose annoncée d’un biopic hollywoodien – Sept ans au Tibet, réalisé en 1997 par Jean-Jacques Annaud – pour que ce passé remonte à la surface. L’explorateur couvert d’honneurs avait été un SS et c’est à ce titre qu’il avait pu partir en Himalaya. Sa fuite vers le Tibet, en compagnie d’un autre ancien SS, devait beaucoup moins au hasard qu’aux liens noués auparavant à Lhassa par d’autres visiteurs du IIIe Reich : au début de 1939, une expédition ethnographique de SS mandatés par Heinrich Himmler avait passé plusieurs mois à rechercher des espèces animales inconnues et des cousins raciaux des Aryens sur les hauts plateaux tibétains. Heinrich Harrer nia toute filiation avec ces délires racialistes, comme il oublia, puis nia jusqu’au bout l’engagement nazi de sa jeunesse.
Mais revenons à nos sommets. L’ascension de l’Annapurna est la première fusée d’un feu d’artifice nourri où les nations viennent cueillir les fruits de leurs efforts passés : le 29 mai 1953, l’Everest s’offre aux Britanniques pour le couronnement de la reine Élisabeth II. Un mois plus tard, le Nanga Parbat se réconcilie avec son destin allemand grâce à l’exploit solitaire d’un Autrichien du Tyrol, Hermann Buhl. Au K2, un ancien hiérarque fasciste conduit une squadra azzurra un demi-siècle après les premières explorations du duc des Abruzzes.
Les appareils à oxygène bénéficient des progrès de l’aéronautique, la logistique de l’« assaut » des 8 000 est désormais au point, avec ses chapelets de camps d’altitude approvisionnés par des porteurs et reliés par des cordes fixes. En 1955, l’ascension du Makalu par des Français marque l’apothéose et le paradoxe de ce dernier sursaut de conquêtes coloniales, au moment où la colonisation s’achève. Les Anglais ont gagné l’Everest après avoir perdu l’Inde, les Français réussissent au Makalu l’ascension parfaite, sans drame, un an après la défaite cinglante de Diên Biên Phu.
En 1960, tous les 8 000 sont gravis sauf le Shishapangma, au Tibet, que les Chinois se réservent en guise de dessert, en 1964. Sur le versant nord de l’Himalaya, le film semble se dérouler à l’envers. Ici, les sommets dominent deux provinces chinoises, le Xinjiang et le Tibet – les deux plus grandes « colonies » du monde.
Quant à l’Everest, il est entré depuis quelques années dans l’ère de la consommation de masse. Plusieurs milliers de clients déboursent chacun plusieurs dizaines de milliers de dollars pour se faire conduire au sommet par des sherpas. Pourquoi gravir l’Everest ? Parce qu’on peut se le payer.
« Tibétains et chinois n’ont jamais voulu conquérir les sommets »
Peter Frankopan
Le « Toit du monde » a-t-il attiré les conquérants au cours de l’histoire ?
Les Européens pensent toujours en termes de conquête. Même quand notre approche est pacifique, il nous faut …
[Pureté]
Robert Solé
On ne fait pas l’ascension de l’Himalaya avec n’importe qui. Trop difficile, trop dangereux. Pour secourir son ami Tchang, dont l’avion s’est écrasé dans le massif du Gosainthan, il n’était pas question que Tintin emm&e…
Mal des montagnes
Sophie Gherardi
Il faut du courage pour aborder l’Everest. Il faut de l’endurance, de l’entraînement, de la préparation. Il faut de l’argent aussi, entre 55 000 et 70 000 dollars selon les agences, dont 11 000 dollars pour le perm…