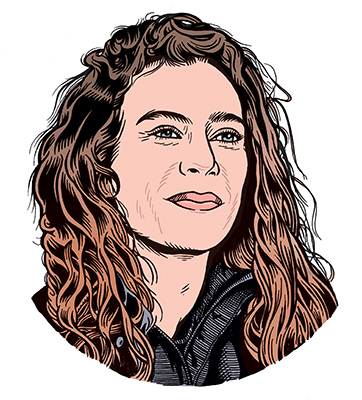Les petites mains invisibles du numérique
Temps de lecture : 5 minutes
J’ignorais tout de l’existence de travailleurs derrière l’intelligence artificielle avant de me lancer dans ce documentaire. Je croisais des livreurs et des chauffeurs dans la rue, bien sûr, mais je ne me doutais pas que, derrière les applications les plus intuitives, pouvaient se cacher de petites mains invisibles chargées d’entraîner des programmes que nous utilisons tous les jours – Spotify, Google, Siri ou Amazon. Je ne pensais pas que la sophistication qu’on nous vendait dissimulait en réalité des conditions de travail proches de celles du XIXe siècle.
Il est très difficile pour un journaliste ou pour un chercheur de rencontrer ces « microtravailleurs ». Il n’y a pas de regroupement géographique, pas d’usine en bas de laquelle on pourrait les attendre, pas d’instance représentative qui pourrait les fédérer. Ce sont des gens isolés et généralement très méfiants. Il faut les comprendre : ils passent leur journée entière devant leur écran, bien souvent sous de faux comptes et de fausses identités créés à la demande de certains employeurs. Ce sont donc les mieux placés pour savoir que n’importe qui peut se cacher derrière un écran. Alors pour les rencontrer, je suis allée jusqu’à poster moi-même des tâches sur les sites de microtravail – des questionnaires à remplir –, rémunérées quelques dollars, avec mes coordonnées. Grâce à cela, j’ai pu entrer en contact avec quelques-uns d’entre eux.
Dans les pays en développement, le microtravail attire des gens diplômés, car il faut le plus souvent pouvoir parler anglais. En Inde, il finit d’ailleurs par détourner une partie de la population diplômée de tâches productives ou intellectuelles. Aux États-Unis ou en Europe, le microtravail peut attirer des gens qui n’ont pas la possibilité de travailler en dehors de chez eux, des femmes au foyer, des personnes souffrant de handicap. Mais, là encore, ce sont des gens qui doivent être capables de réaliser des tâches avec des consignes spécifiques et parfois complexes : entourer des piétons sur des photos pour entraîner des voitures autonomes, retranscrire des discussions pour qu’un robot puisse mieux comprendre des intonations, évaluer des réponses pour aider un moteur de recherche à proposer les plus pertinentes… Une microtravailleuse que j’ai rencontrée aux États-Unis affectionnait ainsi une tâche qui consistait à trouver le meilleur argument juridique pour défendre une thèse. Quel genre d’intelligence d’artificielle pouvait-elle ainsi entraîner ? Je l’ignore encore. Elle aussi.
Car c’est là l’un des premiers problèmes de ces plateformes : l’absurdité apparente de ces tâches. Je m’y suis moi-même essayée : il fallait que je me filme en train d’enlever et de remettre mes lunettes de soleil, ou de faire un salut avec le bras. J’imagine que cela devait entraîner des robots à interagir avec des humains. Mais passé quelques minutes d’amusement, la tâche devient très vite rébarbative et sans intérêt. Devant votre téléphone, vous essayez de respecter les consignes, vous répétez les mêmes gestes absurdes. Et tout cela pour une paie ridicule, quelques centimes seulement.
L’Organisation internationale du travail a calculé que les microtravailleurs gagnent un salaire moyen de 3,31 dollars de l’heure. Mais pour décrocher les tâches les plus lucratives, il faut être connecté en permanence, garder une vigilance sans faille, sans quoi vous n’aurez que des tâches extrêmement mal payées, qui ne vous feront pas gagner plus d’un dollar de l’heure. Une microtravailleuse que j’ai rencontrée me confiait se connecter dès le réveil, ou poursuivait tard dans la nuit, en espérant décrocher la timbale. D’autres veillent à toujours travailler pour certains employeurs en qui ils ont confiance, car il n’est pas rare qu’ils ne soient pas payés du tout, sans aucune possibilité de protestation. Il suffit, pour les employeurs, de dire qu’ils n’ont pas exactement respecté les consignes demandées.
Certains ne le vivent pas si mal. Une mère de famille, qui faisait cela à temps plein depuis trois ans, trouvait même une certaine noblesse dans le microtravail, le jugeait intellectuellement plus satisfaisant que d’être caissière dans un supermarché. Elle avait aussi le sentiment qu’elle était utile à la société, qu’elle apportait un peu d’humanité à ces robots. D’autres ont connu une expérience inverse : une femme m’a confié qu’elle s’était trouvée face à des images prises dans le désert, de nuit, sur lesquelles elle devait repérer les déplacements d’une personne. Elle n’a compris que plus tard qu’elle avait probablement entraîné des drones à frapper des individus. Cette même femme avait aussi dû reconnaître des visages sur des images de vidéosurveillance. On lui avait alors dit qu’ils appartenaient à des pédophiles. Mais qui pouvait l’en assurer ? N’était-elle pas en train d’identifier des opposants politiques pour le compte d’une dictature ? Elle est sortie traumatisée de cette expérience, de ce travail de l’ombre sans commanditaire reconnu ni finalité déclarée.
Le microtravail apporte à ceux qui le pratiquent une illusion initiale de liberté – des horaires libres, sans règles ni contraintes. Mais c’est un leurre : ceux qui s’y livrent se retrouvent bien souvent enfermés dans une existence de pauvreté et de solitude, en concurrence avec le reste du monde. La seule chose qui les unit, c’est leur condition, comme me l’a confié Jared, un microtravailleur que j’ai rencontré dans l’Oregon, celle d’un nouveau prolétariat, à la fois invisible et globalisé.
Conversation avec Julien Bisson
« Des entreprises aux structures de profit hyperpyramidales »
Sarah Abdelnour
Qu’est-ce que le « capitalisme de plateforme » ?
L’expression désigne le système économique qui repose sur l’innovation technique que représentent les plateformes numériques, et qui cherche à tirer profit de travailleurs souvent faussement à leur com…
[Emploi]
Robert Solé
Docteur en pharmacie devenu patron d’une agence de communication, Jacques Séguéla avait amusé la galerie, en 1979, avec un livre joliment titré Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la publicité… elle&nb…
La pédale joyeuse !
Jean Viard
La Pédale joyeuse était un club de vélo de Marseille où mes copains de lycée s’échinaient à grimper la Gineste, puis à redescendre, en coupant les virages, sur Cassis. La pente est raide, mais la vue sur la mer et le cap Can…