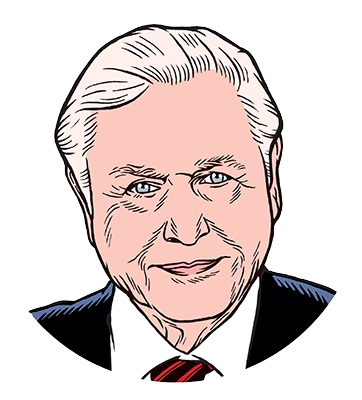L’infini fragile du Serengeti
Temps de lecture : 4 minutes
S’il existe une réalité sauvage dont chacun possède en lui nettement l’image, ce sont les grandes plaines de l’Afrique avec leurs éléphants, leurs rhinocéros, leurs girafes et leurs lions. Je m’y suis rendu pour la première fois en 1960. La faune et la flore que je découvrais étaient certes merveilleuses, mais c’est l’immensité de ces paysages illimités qui m’a fasciné. Le mot masaï « Serengeti » signifie : « plaines sans fin ». Il décrit parfaitement cette région du globe. Dans le Serengeti, on peut se retrouver dans un endroit d’où les animaux paraissent entièrement absents. Après quoi, le lendemain matin, on y voit un million de gnous, deux cent cinquante mille zèbres, un demi-million de gazelles. Quelques jours plus tard, tous ont disparu, il n’y a plus rien à l’horizon. Il était pardonnable d’imaginer que ces plaines n’aient pas de fin, puisqu’elles étaient capables d’engloutir des troupeaux aussi gigantesques.
À cette époque, il semblait inconcevable que l’espèce humaine ait un jour à elle seule le pouvoir de menacer une réalité aussi énorme que ces espaces sauvages. C’était pourtant précisément ce que redoutait un scientifique visionnaire, Bernhard Grzimek. Directeur du zoo de Francfort, il l’avait fait renaître alors qu’il n’était plus qu’un amas de cages fracassées et de cratères de bombes après la guerre. Durant les années 1950, il était devenu un visage familier de la télévision allemande, en présentant des films sur la faune sauvage. Le plus célèbre, Serengeti ne doit pas mourir, avait obtenu l’Oscar du meilleur documentaire en 1959. Le film retraçait ses efforts pour inventorier les migrations des troupeaux de gnous. Lui et son fils Michael, qui avait son brevet de pilote, s’étaient servis d’un petit avion pour suivre les troupeaux à l’horizon. Ils en dressèrent l’inventaire tandis qu’ils traversaient les rivières, les régions boisées et les frontières des États. De cette façon, ils commencèrent à comprendre le fonctionnement global de l’écosystème du Serengeti. Il apparut qu’étonnamment l’herbe avait autant besoin des herbivores que les herbivores avaient besoin de l’herbe. Sans les animaux qui la broutaient, elle aurait perdu sa prééminence. Elle avait évolué pour résister à ces millions de mâchoires voraces. Quand les dents des herbivores la coupaient jusqu’au ras du sol, les plantes recouraient à des réserves de nourriture juste au-dessous de la surface pour repousser. Quand les sabots des troupeaux labouraient la terre et que les plantes répandaient leurs graines, la nouvelle génération de l’herbe était assurée. Quand les troupeaux s’éloignaient, les plantes repoussaient rapidement, sustentées par les monceaux de fumier laissés par les animaux. Les ravages apparemment causés par le passage des troupeaux constituaient en fait une étape cruciale dans le cycle vital de l’herbe. S’il n’y avait pas assez d’herbivores, l’herbe disparaîtrait, éclipsée par des plantes plus hautes qui prendraient l’avantage en l’absence des troupeaux.
C’était une histoire d’interdépendance, typique des découvertes que faisait alors une science naissante, l’écologie. Au cours des années 1950, ces écologistes commençaient à clarifier le chaos apparent du monde extérieur et à comprendre comment toute vie était interconnectée en un réseau d’une variété infinie, dont chaque composante était reliée aux autres. Plantes et animaux entretenaient des relations proches ou même intimes. Toutefois, malgré l’étroitesse de leurs liens, ces écosystèmes n’étaient pas nécessairement solides. Le moindre choc à un endroit sensible pouvait déséquilibrer la communauté entière.
Grzimek savait que c’était sans doute vrai même pour un écosystème aussi vaste que le Serengeti. Ses vols d’étude révélèrent bientôt que c’était en fait l’immensité même des plaines qui empêchait cet écosystème de s’effondrer. Sans cet espace sans borne, les troupeaux n’auraient pas pu parcourir de longues distances et donner aux différentes zones de pâturage sauvage le répit dont elles avaient besoin entre deux agressions. Les herbivores auraient broyé les brins jusqu’à la racine, après quoi ils seraient eux-mêmes morts de faim. Les prédateurs auraient peut-être tiré profit à court terme de l’état de faiblesse de leurs proies, mais pour finir eux aussi auraient péri. Si le Serengeti n’avait pas été aussi immense, son écosystème aurait perdu son équilibre et se serait effondré.
Grzimek était conscient que la Tanzanie et le Kenya allaient bientôt demander leur indépendance et céderaient peut-être aux voix réclamant la mise en culture des plaines. À travers ses films et ses autres activités, il conforta les esprits désireux de protéger les savanes et de préserver l’espace dont la nature avait besoin. Les États africains, de leur propre chef, entreprirent des actions visionnaires. La Tanzanie interdit les installations humaines dans la zone du Serengeti située à l’intérieur de ses frontières – une décision qui souleva beaucoup de controverses. Au Kenya, on créa de nouvelles réserves dans la région de la rivière Mara, afin de sauvegarder intégralement le parcours des migrations du Serengeti.
La démonstration était faite. La nature est loin d’être illimitée. Le monde sauvage n’est pas infini. Quelques années plus tard, cette notion est devenue une évidence pour tous.
Une vie sur notre planète, traduction Philippe Giraudon © Flammarion, 2021
« Si les forêts meurent, c’est probablement la fin pour nous »
Jane Goodall
« Nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que nous avons besoin d’une nouvelle relation avec le monde naturel.» Ayant consacré une grande partie de sa vie à l’étude des primates en Tanzanie, l’éthologue milite aujourd’hui en faveur de la protection de la faune et de la flore sauvag…
[Agrizoophobie]
Robert Solé
TOUT le monde ne partage pas la passion des enfants pour les diplodocus et les tyrannosaures. En général, on remercie le ciel d’être né quelques années après la disparition de ces monstres qui semaient la terreur sur terre.
Keiko, l’orque qui a ému le monde
Lou Héliot
Portland, 1993. Jeune orphelin difficile, Jesse doit effectuer des travaux d’intérêt général dans un parc d’attractions. Il y rencontre Willy, une orque en captivité avec qui il va développer un lien unique. Sensible à la douleur de l’animal, Jesse parvient à libérer l’orque, qu…